GLOSSAIRE
Origines et sources de chaque évènement
GLOSSAIRE
Pour faciliter la lecture, les lieux marqués par le symbole ‘◊’ sont définis dans la section du livre intitulée ‘Les lieux cités’.
- 1ÈRE CLASSE
- 2ÈME CLASSE
- ABRIS
- ADJUDANT
- ARTILLEURS
- ARTILLERIE
- ARTILLERIE (ARMES)
- ARTISANAT
- AVIATION
- BAÏONNETTE (CHARGE OU ATTAQUE À LA)
- BAGUES
- BAPTÊME DU FEU
- BATAILLON
- BATTERIE (D'ARTILLERIE)
- BISMUTH
- BIVOUAC
- BLESSÉS
- BLEU
- BLOCKHAUS
- BOCHE
- BOÎTE À MITRAILLE
- BOUCLIER DE REMPART
- BOUCLIER PORTATIF
- BOULES DE NEIGE - BATAILLE À COUPS DE BOULES DE NEIGE
- BOYAUX
- BRIGADE
- CANTONNEMENT
- CAPITAINE
- CAPORAL
- CAPOTE
- CARAPACE
- CASQUE ADRIAN
- CASQUETTE
- CIE
- CITÉ / CITATION
- COLONEL
- COLONIES
- COMITÉ FRANÇAIS DE LIBÉRATION NATIONALE
- COMPAGNIE
- COMPAGNIE HORS RANG (CHR) OUR (HR)
- CONSIGNÉ
- CONTREMANDE
- CORVÉE DE PIQUET
- CORVÉE DE SALUBRITÉ
- CORVÉE DES MORTS
- CRÉNEAU
- CROIX DE GUERRE
- DEVOIR
- DÉFENSE PASSIVE
- DIRIGEABLE
- DISPONIBILITÉ
- DIVISION DES CORPS D'ARMÉE EN 1914
- DIVISION D'INFANTERIE
- ÉCAILLE
- EFFORT DE GUERRE
- ESCOUADE
- FACTION
- FANTASSIN
- FEUILLÉES/FEUILLE
- FIÈVRE TYPHOÏDE
- FLEURS À NOS FUSILS
- FOOTBALL
- FOUGASSE
- FUSANT
- FUSÉE
- GABARIT
- GÉNÉRAL
- GOURBI
- GOUVERNEUR
- GRADE
- GRAND-GARDE
- GRENADES
- GUEULES CASSÉES
- HIÉRARCHIE DU CORPS ARMÉ FRANÇAIS
- HR (HORS RANG)
- JEU
- JOURNAUX
- JUS
- KÉPI
- KOLOSSAL
- LÉGION D'HONNEUR
- LETTRES
- LIEUTENANT
- LOUPS DU BOIS-LE-PRÊTRE
- MARENNES
- MARMITES
- MÉDAILLE DE MILITAIRE
- MESS
- MINES
- MITRAILLE - VOIR BOÎTE À MITRAILLE
- MITRAILLEURS
- MOBILISATION GÉNÉRALE
- MUSETTE
- NETTOYAGE DES TRANCHÉES
- OBSERVATOIRE
- OBUS
- OFFICIER
- PARADOS
- PARAPET
- PATELIN
- PATROUILLE
- PAYS
- PERCUTANTS
- PÉRISCOPE
- PETIT POSTE
- PIÈCES
- PIQUETS
- PITANCE
- PLANTON
- POILU
- POMPES
- POMPIERS
- POSTE
- PRESSE
- PRISONNIERS
- PROPAGANDE
- PROVISION DE BOUCHE
- QUART
- RAQUETTES
- RAVITAILLEURS
- RATIONNEMENT
- RÉGIMENT D’INFANTERIE
- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE
- REMPLILÉSI
- RÉTROGRADATION
- RIMAILHO
- SAPE
- SCHRAPNELL
- SCIEUR DE LONG
- SECTION
- SECTION DE PIQUET
- SERGENT-CHEF (SERGENT)
- SERRE-FIL
- SINGE
- SOLDATS DU GÉNIE (SAPEURS)
- SOUS-OFFICIERS
- ST-CYRIEN
- STRATÉGIE
- SUICIDE
- TENUE DE CAMPAGNE
- TIRAILLEURS
- TOPOGRAPHIQUE
- TORPILLE
- TRANCHÉES DE FLANQUEMENT
- TROUS DE LOUP
1ÈRE CLASSE
(Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
2ÈME CLASSE
(Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
ABRIS (ABRI)
L’abri est un endroit où les soldats peuvent se protéger des dangers et/ou des intempéries. Les abris sont généralement creusés en contrebas, dans l’embrasure des tranchées*. Ils sont souvent trop petits pour accueillir tous les soldats d’une section*. Les sous-officiers* et les officiers* possèdent habituellement leur propre abri, soit personnel soit partagé, qui offre un niveau de confort supérieur à celui des soldats.1

Bois-Le-Prêtre - Date inconnue
Abris de mitrailleurs* en première ligne

Lieu inconnu - Octobre 1915
Soldats dans un abris
ADJUDANT
L’adjudant est un sous-officier* qui, dans la hiérarchie des grades*, vient au-dessus du sergent-chef*. En 1914, l’adjudant peut commander une section*.2 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
ARTILLEURS
Militaire servant dans l’artillerie.3 (Cf: Artillerie (Armée) / Artillerie (Arme) / Batterie)
ARTILLERIE (ARMÉE)
Un régiment d’artillerie constitue une unité militaire spécialisée dans l’emploi de canons, d’obusiers, de lance-roquettes et d’autres armes à feu de gros calibre. (Cf: Artillerie (Armes))
L’artillerie française se développe considérablement pendant la Première Guerre mondiale, en vue de rattraper son retard face à l’ennemi allemand. Elle passe de 11 000 officiers* d’artillerie en 1914 à 26 000 en 1918. (Cf : Effort de guerre)
Le recrutement du personnel pose moins de problèmes que dans l’Infanterie*, l’attrition des troupes étant beaucoup moins forte. Mais dès le mois de janvier 1915, le commandement de l’Armée prend conscience des pertes parmi les cadres des unités d’artillerie existantes et de la nécessité de former de nouveaux officiers*.
En temps de guerre, la formation des aspirants officiers est accélérée, avec une réduction de la durée des cours. Les candidats sont promus plus rapidement au grade* supérieur et l’appellation d’élève-officier de réserve est supprimée, simplifiant ainsi les procédures militaires pour une mobilisation plus rapide des forces de l’armée active en temps de conflit.
Entre janvier 1915 et décembre 1917, 6 000 officiers* sont nommés par le général* commandant en chef. Les sous-officiers* ayant dix mois de grade* et au moins douze mois de service actif aux armées, sont envoyés en cours de perfectionnement à l’école de Fontainebleau. Cette voie de recrutement permet de former 4 000 sous-lieutenants* et 800 sous-lieutenants* spécialisés dans l’artillerie de tranchée* entre janvier 1915 et décembre 1917. En parallèle, une autre méthode de recrutement est mise en place pour les sous-officiers* de moins de huit mois d’ancienneté: ils sont sélectionnés par le Grand Quartier général pour rejoindre les cours d’élève-aspirants sans avoir à passer de concours d’entrée. Par cette approche, 3 500 sous-officiers*
et 5 000 appelés obtiennent le grade* d’élève-aspirant.4 (Cf : Division des Corps d’Armée en 1914)
En conséquence, les effectifs passent de 422 000 artilleurs* en 1914, à 1 100 000 à la signature de l’armistice.5

Lieu inconnu - 1914
L’artillerie* lourde, la curiosité de la Revue de 1914. (Légende d’origine)
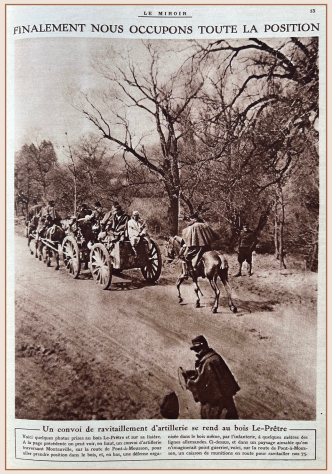
Journal Le Miroir - 30 mai 1915
Transcription
« FINALEMENT NOUS OCCUPONS TOUTE LA POSITION »
« Un convoi de ravitaillement d’artillerie* se rend au bois Le-Prêtre »
« ….Ci-dessus, et dans un paysage aimable qu’on n’imaginerait point guerrier,
voici, sur la route de Pont-à-Mousson◊, un caisson de munitions en route
pour ravitailler nos 75. »
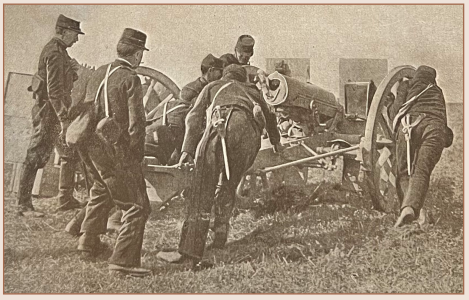
Journal Le Miroir - 30 aôut 1914
Artilleurs* mettant en place une pièce de 75 qui va ouvrir le feu.
ARTILLERIE (ARMES)
La Première Guerre mondiale a été un tournant historique marquant pour l’artillerie française, qui a vu ses stratégies et capacités logistiques subir une transformation profonde.
En 1914, au déclenchement du conflit, la France adopte une approche axée sur une guerre de mouvement rapide, anticipant une victoire prompte. Pour cela, près de 8 millions de soldats sont mobilisés, avec un million d’entre eux avançant à pied. Cette stratégie initiale reflète l’espoir d’un conflit bref et décisif.
Cependant, la réalité du champ de bataille vient rapidement contredire ces espoirs. Dès les premiers mois du conflit, en août 1914, les pertes françaises sont considérables : 80 000 soldats tués et 300 000 blessés, en grande partie sous le feu de l’artillerie allemande. L’efficacité de cette dernière révèle une faiblesse cruciale dans la préparation française, notamment en raison de la supériorité de la portée des canons allemands. Alors que la France s’appuie sur le canon de 75mm, reconnu pour sa légèreté et sa précision jusqu’à 7 kilomètres, l’Allemagne utilise des pièces d’artillerie avec une portée atteignant les 15 kilomètres.
Néanmoins, la bataille de la Marne de septembre 1914 marque un tournant dans la progression allemande. Malgré la puissance de leur artillerie, la France parvient à remporter cette victoire cruciale au prix de plus de 80% de ses munitions. Ce moment charnière démontre la nécessité vitale pour la France d’optimiser ses capacités logistiques, révélant l’importance stratégique de l’effort de guerre* dans la conduite et l’issue du conflit.6
Face à l’inefficacité de l’artillerie de campagne contre les fortifications ennemies, l’armée française a dû innover avec la création d’une artillerie de tranchées spécifique pour des tirs à courte distance, incluant des engins improvisés comme le célèbre crapouillot de 58 millimètres utilisé vers la fin de 1916.7 (Cf: Tranchées)
Mais la transformation majeure de l’armée française survient essentiellement avec le développement de l’artillerie lourde. Capable de frapper au-delà de 20 kilomètres, avec des calibres allant jusqu’à 420 millimètres, elle inverse la dynamique des combats sur le front occidental.8 En 1916, l’artillerie cause environ 75% des pertes militaires.9 (Cf : Batterie / Obus)
Cette nouvelle artillerie conduit à la création d’organisations, telles que la logistique automobile pour alimenter les pièces* d’artillerie sur le terrain et la chasse aérienne pour protéger les appareils d’observation. Le repérage d’objectifs lointains et cachés est un défi majeur qui conduit à des avancées dans la planification des tirs, la préparation scientifique et l’utilisation croissante de l’aviation* pour l’observation. L’observation et la communication sont également modernisées grâce à la photographie aérienne, le téléphone et la télégraphie sans fil.10

Bois-le-Prêtre - 1915
Artilleurs* et pièce de 155 en batterie* (Légende d’origine)
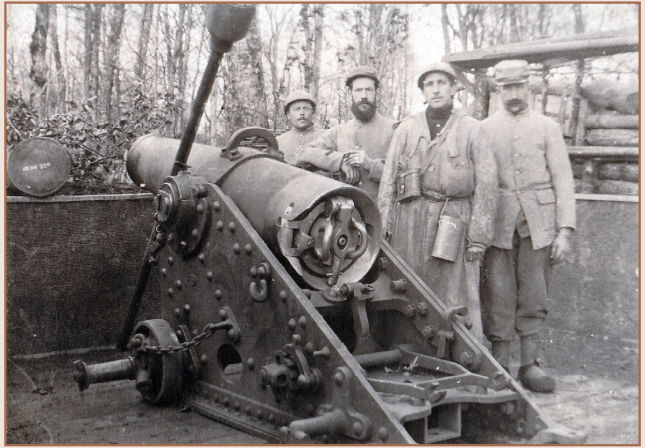
Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Mortier de 270 mm
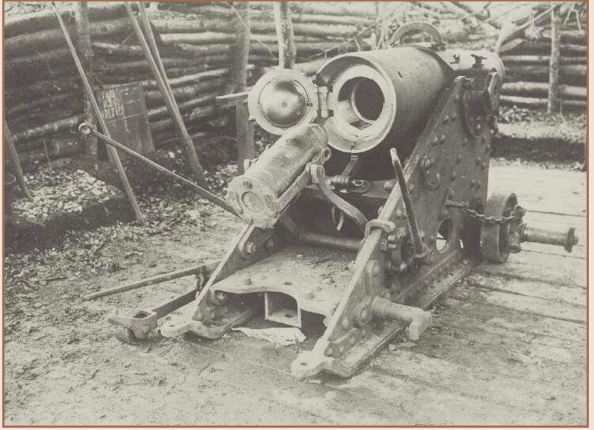
Bois-le-Prêtre◊ - Décembre 1915
Mortier de 220 mm (Légende d’origine)

Montauville◊, Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1916
Mise en place d’une torpille* dans un crapouillot (Légende d’origine)

Lieu Inconnu - 1914
Déplacement d’une pièce française de 75 (Légende d’origine)
ARTISANAT
Certains soldats sont d’habiles artisans très qualifiés dans la vie civile. Orfèvres, graveurs, ferblantiers, mécaniciens de précision ou paysans faisant preuve d’une grande dextérité manuelle dans la création d’objets d’art populaire, tous redécouvrent les techniques de leurs métiers d’avant-guerre pour préserver leur humanité au milieu du conflit.
Les soldats conçoivent de leur main de nombreux objets du quotidien (Cf: Journaux) en utilisant des matériaux bruts trouvés sur place. Briquets, couteaux mais aussi pièces décoratives telles que des boîtes à bijoux ou des figurines militaires, sont créés à partir de matériaux provenant des projectiles de guerre ou des équipements militaires.
Malgré une forte présence du laiton, du cuivre ou encore de l’aluminium, le bois est le matériau privilégié au vu de son accessibilité. Il facilite la création de nombreux objets tels que des étuis à plume, tabatières, boîtes à bijoux, jouets et bien d’autres.11 (Cf: Bagues)

Bois-le-Prêtre◊- 2023
Encrier de 1915
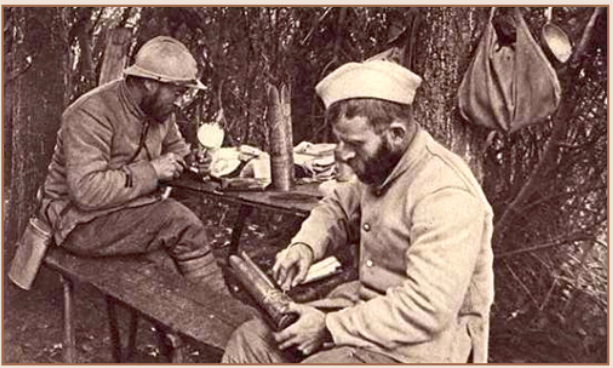
Lieu inconnu - Date inconnue
Poilus* décorant des douilles d’obus*.

Bois-le-Prêtre - 1915
Coupe-papier fabriqué à partir d’une douille d’obus*

Fricourt - 1916
Stock de douilles d’obus* : matière première de l’artisanat de tranchée*.

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024
Vases à décor réalisés dans des douilles d’obus

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024
Vases à décor réalisés dans des douilles d’obus
AVIATION
La Première Guerre mondiale laisse place à de nombreuses évolutions d’ordre technologique, dont celle de l’aviation. (Cf : Artillerie (armes))
Malgré les hésitations initiales quant à son efficacité en raison de la simplicité de ses équipements, le général* Joffre reconnaît son potentiel et confie, en 1914, la supervision du service aéronautique au commandant Barès. L’aviation est structurée en différentes spécialités, comprenant la chasse, le bombardement et la reconnaissance.12
Toutefois, les raids stratégiques de jour sont interrompus en 1915 en raison des vulnérabilités des bombardiers face aux avions allemands. L’aviation de bombardement se divise alors entre une composante tactique de champ de bataille et une composante stratégique opérant à plus grande échelle. Cette dernière se concentre notamment sur la destruction de sites clés : centres de production industrielle, axes de communication, usines dédiées à la fabrication de munitions…
La chasse se déploie quant à elle plus tardivement. Le débat émerge de manière significative à Verdun◊ en 1916. Lors de cette bataille, plus de 270 avions allemands réussissent à neutraliser les 70 avions français de la région fortifiée. La nécessité de reconquérir la maîtrise du ciel devient évidente et le commandant Barès doit trancher les controverses sur l’emploi de l’aviation de chasse†. Avec son aval, Charles de Rose, chargé de l’aviation à Verdun, crée le premier groupement de chasse autonome pour mener une offensive à outrance. Le déploiement de l’aviation suit alors un objectif clair : la « maîtrise de l’air »†† : le contrôle total de l’espace aérien par les forces combattantes françaises.
De ces évènements, découle un phénomène de généralisation d’avions monoplaces dans l’espace aérien, au détriment de l’aviation de Ce changement stratégique est notamment visible lors de la bataille de la Somme du 1er juillet au 18 novembre 1916.
Néanmoins, l’arrivée du général Pétain comme généralissime des armées du Nord et Nord-Est au mois de mai 1917 oriente la doctrine d’emploi de l’aéronautique dans une nouvelle direction. Bien que convaincu du rôle crucial de l’aviation dans l’atteinte de la victoire, il veut en infléchir l’emploi en accord avec sa vision stratégique. Dans ce but, il signe une note sur l’emploi de l’aviation le 19 juillet 1917, qui réaffirme la doctrine offensive de la chasse mais en corrige les excès. Elle assure l’interdiction du territoire, la protection de l’aviation d’observation et la progression de l’infanterie*.
En 1918, la création de la 1ére division* aérienne, avec ses groupements de combat, concrétise cette évolution doctrinale, marquant la pleine maturité de l’aviation militaire française à la fin de la guerre.13
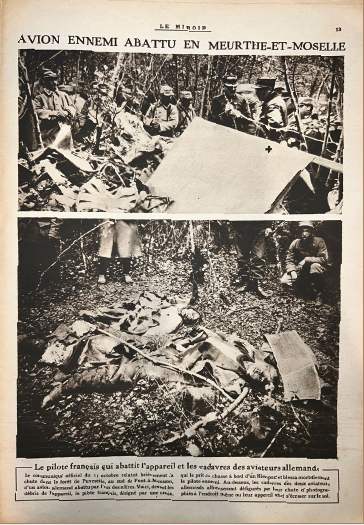
Journal Le Miroir - 31 octobre 1915
Transcription
photo 17
« AVION ENNEMIE ABATTU EN MEURTHE-ET-MOSELLE »
« Le pilote français qui abattit l’appareil et les cadavres des aviateurs allemands »

Journal Le Miroir - 20 septembre 1914
Transcription
« UN ÉPISODE DE LA CHASSE AU TAUBE††† AUX ENVIRONS DE PARIS »
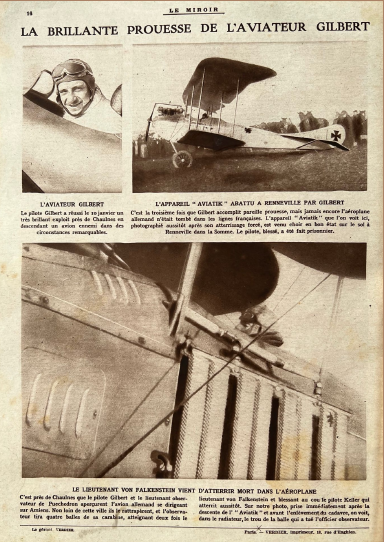
Journal le Miroir - 31 janvier 1915
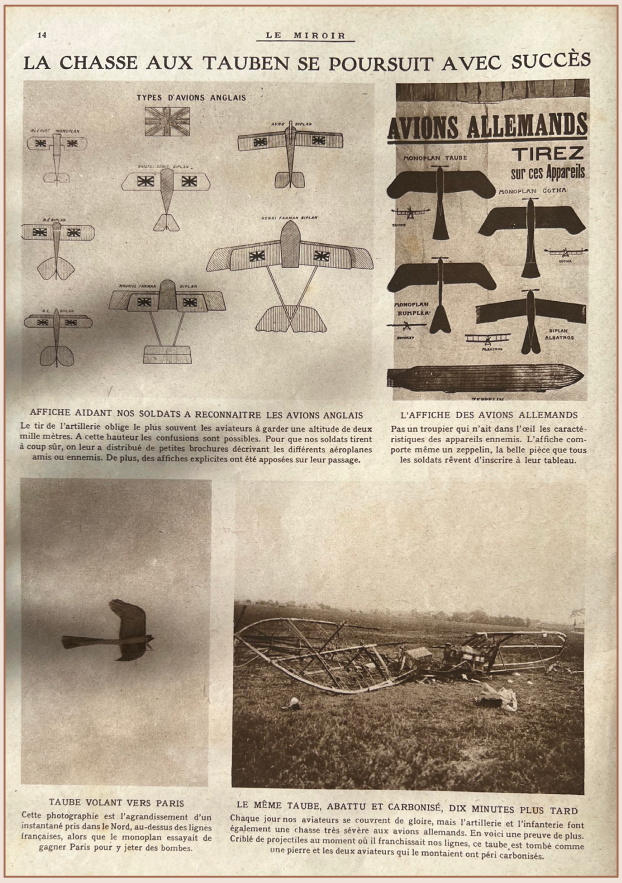
Journal Le Miroir - 15 novembre 1914
Transcription
photo 19
(de gauche à droite, de haut en bas)
« LA BRILLANTE PROUESSE DE L’AVIATEUR GILBERT »
« L’aviateur Gilbert »
« Le pilote Gilbert a réussi le 10 janvier un très brillant exploit près
de Chaulnes en descendant un avion ennemi dans des circonstances
remarquables. »
« L’appareil “Aviatik” abattu à Renneville par Gilbert »
« C’est la troisième fois que Gilbert accomplit pareille prouesse, mais
jamais encore l’aéroplane allemand n’était tombé dans les lignes françaises.
L’appareil « aviatik » que l’on voit ici, photographié aussitôt après son
atterrissage forcé, est venu choir en bon état sur le sol à Renneville dans le
Somme. Le pilote, blessé*, a été fait prisonnier*. »
« Le lieutenant Von Falkenstein vient d’atterrir mort dans l’aéroplane »
« C’est près de Chaulnes que le pilote Gilbert et le lieutenant observateur de
Puechedron aperçurent l’avion allemand se dirigeant sur Amiens. Non loin de
cette ville, ils le rattrapèrent et l’observateur tira quatre balles de sa carabine,
atteignant deux fois le lieutenant von Falkenstein et blessant au cou le pilote
Keller qui atterrit aussitôt. Sur notre photo, prise immédiatement après
la descente de “l’aviatik” et avant l’enlèvement du cadavre, on voit dans le
radiateur, le trou de la balle qui a tué l’officier* observateur. »

Journal Le Miroir - 31 octobre 1915
Forêt de Puvenelle◊ - Dimanche 10 octobre 1915
Avion boche* abattu dans les lignes françaises (Légende d’origine)

Journal Le Miroir - 31 octobre 1915
Forêt de Puvenelle◊ - Dimanche 10 octobre 1915
Cadavres d’aviateurs boche* abattu dans les lignes françaises (Légende d’origine)
BAÏONNETTE (CHARGE OU ATTAQUE À LA)
La baïonnette, surnommée Rosalie, est un accessoire étroitement lié au soldat français de la Première Guerre mondiale. C’est un modèle unique et révolutionnaire pour son époque, fortement promu par la propagande* française.14
En 1914, la doctrine militaire met l’accent sur le combat au corps à corps, dont la maîtrise est essentielle lors des affrontements dans les tranchées*.
Cette approche se reflète dans l’utilisation de l’épée-baïonnette qui est montée sur l’ensemble des 2 800 000 fusils Lebel pendant la guerre. Ce fusil, capable d’effectuer des tirs répétés et avec une portée de tir atteignant 450 mètres, devient une arme particulièrement redoutable et d’autant plus meurtrière lorsqu’elle est associée à l’arme blanche.15
La Baïonnette est, dans ce sens, un des symboles du soldat français de la Première Guerre mondiale. En témoigne, la parution du journal La Baïonnette, un des nombreux journaux* de tranchées* nés de ce conflit.
Contrairement aux baïonnettes anglaises ou allemandes, la Rosalie n’est pas une lame, mais une pique cruciforme extrêmement pointue. Sa conception ergonomique permet au soldat de tourner l’arme d’un quart de tour à l’intérieur du corps de son adversaire, provoquant immédiatement une hémorragie interne.16
En raison de l’étroitesse des tranchées*, la Rosalie s’avère difficile à manier et ses limites apparaissent rapidement. Son rôle dans les combats diminue alors au fil du conflit. Les soldats, lors des opérations de nettoyage* des tranchées*, la remplace
par des couteaux ou des armes en bois renforcé que l’on surnomme les massues de tranchées*.18

Lieu inconnu - env. 1914
Carte postale « Chasseur à pied, l’escrime à la baïonnette » (Légende d’origine)
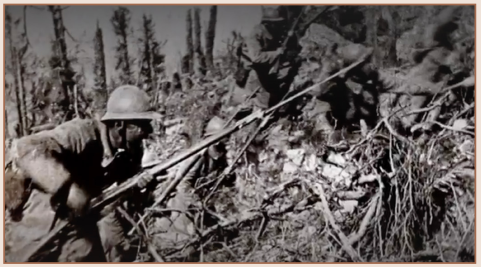
Forêt d’Argonne - 1915
Charge à la Baïonnette*

Journal Le Miroir - 23 août 1914
Transcription
photo 25
« LES ALLEMANDS REDOUTENT NOS BAÏONNETTES* »
« La balle est une folle, la baionnette* une brave compagne. Cette maxime,
vieille autant que la baïonnette* elle-même, vient une fois de plus d’être
confirmée d’éclatante façon. Dans presque tous les engagements que les
troupes alliées ont eus avec les soldats allemands, c’est l’arme blanche qui
a décidé de la victoire des nôtres. Malgré la portée des canons modernes,
l’infanterie, particulièrement dans l’armée française, reste la « Reine des
batailles ». C’est que le petit pioupiou de chez nous fait preuve d’un courage,
d’une souplesse, d’un mordant qui manquent totalement au lourd fantassin*
allemand. En Alsace, notamment, les officiers* signalent qu’ils ont toutes
les peines du monde à retenir leurs hommes. Nos alliés montrent le même
entrain. Le célèbre général russe Dragomiroff se plaisait à répéter: « La balle
trahit, la baionnette* jamais ». Et dans les armées du tsar, l’infanterie a
toujours la baïonnette* au canon, même pendant le tir. »
BAGUES
Les bagues aux formes créatives, fréquemment confectionnées par les poilus*, sont un objet très populaire dans les tranchées*.
Malgré des ressources limitées, les soldats tirent le meilleur parti des matériaux à leur disposition.
Ils utilisent le plus souvent l’aluminium provenant d’obus* de roquettes : une matière première abondante disponible sur les lignes de front. Une fois fondu, ils le versent dans des moules qu’ils ont également conçus, afin de lui donner la forme désirée. Puis, à l’aide d’un couteau aiguisé, les poilus * travaillent le matériau en l’agrandissant, le polissant et surtout en le décorant.
La bague sigillaire est la plus courante en raison de sa production simple : le dessus du bijou porte souvent les initiales du soldat ou des motifs tels que des cœurs ainsi que des trèfles et des fers à cheval, pour apporter une touche de chance lors des combats. (Cf : Artisanat).19

Institut du Grenat - 2011
Bague* de tranchée*faite d’aluminium et de cuivre.

Musée de Toul◊ - 2018
Bague* de tranchée*faite d' aluminium et de cuivre.
BAPTÊME DU FEU
Le baptême du feu désigne une initiation à un premier combat ou une expérience formatrice dans l’apprentissage militaire 20 (Cf : Bleu)
« C’est que dans l’intervalle j’avais reçu le baptême du feu. Quelle expression
signifiante, et qui n’a pu être imaginée que par un baptisé du feu! Ce
sentiment d’être «aguerri» ne devait plus m’abandonner. J’étais voué, parmi
des hommes voués. Mais peut-être me suis-je mépris moi-même, ce jour-là,
en pensant à un acquis une fois pour toutes assimilé. Être marqué, brûlé ne
sauve pas des brûlures nouvelles. L’initiation n’est jamais achevée. La mort est
ingénieuse inépuisablement à varier les rites du baptême. »
Maurice Genevoix, La mort de près, Paris, Omnibus, 1998 (1972), p. 1029-1030.21
Maurice Genevoix, est écrivain français rendu célèbre pour ses récits de guerre, notamment son cycle de romans «Ceux de 14», qui dépeint de manière poignante les horreurs et les réalités du conflit. Son expérience personnelle dans les tranchées* a profondément marqué sa vie et son œuvre littéraire. Envoyé sur le front occidental, il a participé à certains des combats les plus féroces de la guerre, notamment la bataille de la Marne en 1914 et la bataille de Verdun en 1916. Pendant son service, il a vécu l’horreur des tranchées*, les bombardements incessants, la peur constante de la mort et la camaraderie avec ses compagnons d’armes. Il a également été blessé* à plusieurs reprises au cours de la guerre.22
BATAILLON
Le bataillon est une subdivision d’un régiment* composé de plusieurs compagnies*. Il est généralement dirigé par un capitaine* ou un commandant.23 En 1915, le bataillon d’un régiment* est constitué d’un étatmajor, d’un petit état-major et de quatre compagnies*, regroupant environ mille hommes au total. Un régiment* compte généralement deux ou trois bataillons selon les cas. Dans certains cas, le bataillon est une unité autonome qui n’est pas rattachée à un régiment* spécifique, mais directement placée sous le commandement du chef de brigade* ou de division*. Les bataillons de chasseurs ou ceux des tirailleurs* sénégalais sont un exemple de cette particularité.24 (Cf : Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
BATTERIE (D’ARTILLERIE)
Une batterie d’artillerie* se compose de quatre canons, trois officiers*, 170 soldats, 150 chevaux et environ vingt véhicules.25 Elle dépend d’un approvisionnement régulier en munitions, exigeant une organisation logistique complexe. Cette dernière évolue durant la guerre, reflétant des changements dans les méthodes de ravitaillement. Au début du conflit, les chevaux sont largement utilisés pour transporter les fournitures, notamment parce qu’il n’y a pas d’autres moyens disponibles et que les troupes sont souvent loin des réseaux ferroviaires. Mais avec les changements dans les tactiques et les conditions de guerre (Cf: Stratégie), le ravitaillement s’oriente progressivement vers le transport ferroviaire, particulièrement
pour l’artillerie*. Cette évolution logistique, malgré des défis comme la crise des obus* de 1915, marque un changement crucial dans la logistique de guerre. Elle permet de soutenir efficacement les troupes sur un front devenu statique, mettant en lumière l’importance de services logistiques spécialisés et leur rôle crucial dans l’efficacité des opérations militaires.26
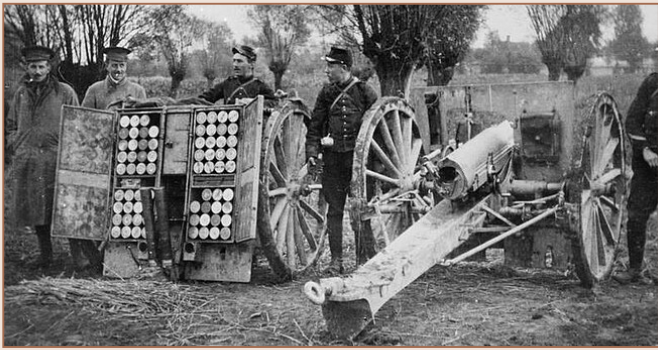
Bas Mesnil - Octobre 1914
Canon de 75 mm modèle 1897 et son caisson à munitions (Légende d’origine)
BISMUTH
Le bismuth est un élément chimique métallique présent naturellement dans divers minerais. Il dispose de propriétés antimicrobiennes et anti- inflammatoires, ce qui en fait un choix populaire pour traiter les troubles gastro-intestinaux, notamment la diarrhée, à cette époque. Aujourd’hui, le bismuth subsalicylate est l’ingrédient principal dans Pepto-Bismol.27
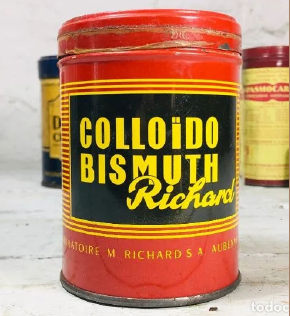
Bismuth*
BIVOUAC
Un bivouac désigne l’action d’établir temporairement un campement à l’extérieur et, par extension, de passer une nuit ou prendre un repas à l’extérieur.
L’établissement de bivouacs est un acte principalement associée aux débuts de la guerre, avant que les tranchées* ne soient aménagées. Mais il intervient également lors des déplacements entre différents secteurs.
Les troupes optent tout de même plus généralement pour le cantonnement* plutôt que le bivouac, en raison de son confort accru, de son caractère plus salubre et de la discrétion qu’il offre quant à la disposition des troupes à l’ennemi.28

Bois-le-Prêtre◊ - 1914
Établissement d’un bivouac* (Légende d’origine)
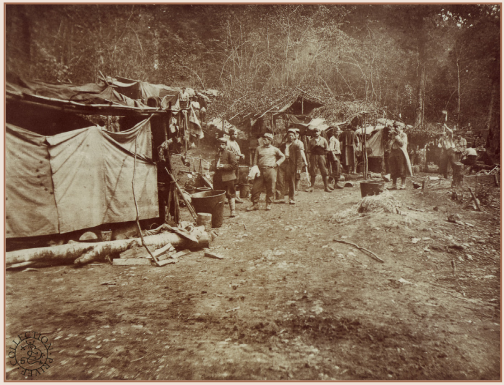
Bois-le-Prêtre◊ - 1914
Bivouac* - Ravin des carrières
BLESSÉ
Au cœur d’un conflit sans égal, la France mobilise huit millions de soldats. Les statistiques révèlent l’ampleur de la tragédie: sur les hommes mobilisés, un million et demi perdent la vie et trois millions sont blessés, dont la moitié sont déclarés invalides à la fin de la guerre.
Les combattants défigurés sont utilisés à des fins politiques par l’État français. Ils deviennent l’un des nombreux supports de la propagande*, qui vise alors à diaboliser les forces ennemies et glorifier l’engagement patriotique. Dès les premiers mois de la guerre, plusieurs associations d’entraide voient le jour pour soutenir ces soldats : elles produisent notamment des affiches pour sensibiliser la population sur le sacrifice des soldats et demander des dons monétaires.
Malgré la solidarité nationale envers les gueules cassées*, celles qui travaillaient dans des emplois manuels avant la guerre s’inquiètent pour leur avenir professionnel. La loi de 1924 sur l’emploi obligatoire représente un changement important pour ces victimes, en établissant un cadre légal pour leurs droits à des compensations de guerre. L’acte est le résultat d’un compromis entre la protection offerte par l’État à ses soldats handicapés et le fonctionnement de l’économie libre. Il garantit l’emploi obligatoire comme moyen de fournir du travail aux hommes invalides.29
L’intérêt du gouvernement pour les soldats gravement blessés stimule l’innovation médicale. La radiologie, notamment, devient très populaire durant la Première Guerre mondiale. Des pionniers comme Marie Curie démontrent comment les rayons X, découverts en 1895, peuvent être utilisés au front pour détecter l’origine interne des blessures causées par les armes modernes.
Au début de la guerre, la France constate son retard par rapport à l’Allemagne, qui possédait déjà des unités mobiles de radiologie, et modifie sa stratégie*.
Elle réorganise son système de soins en envoyant des chirurgiens et des véhicules équipés de matériel radiologique et chirurgical au front. Cette démarche vise à améliorer significativement la qualité et la quantité des soins médicaux offerts aux blessés.
L’arrivée en France des voitures chirurgicales, des véhicules conçus spécifiquement pour les opérations d’urgence, permet de transformer rapidement des bâtiments en hôpitaux temporaires. Cela joue un rôle crucial dans l’effort de guerre* collectif et est essentiel pour sauver de nombreuses vies (Cf : Lieux Cités – Auberge Saint Pierre).30

Bois-le-Prêtre◊ - 10 septembre 1916
Lieu-dit « Le Mouchoir », chargement d’un blessé par l’ambulance américaine (Légende d’origine)

Lieu et date inconnus
Auto chirurgicale de la croix rouge autrichienne (Légende d’origine)
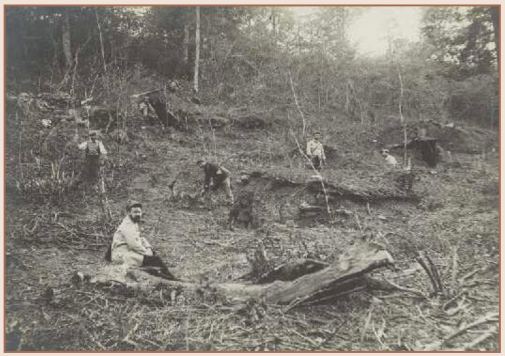
Bois-le-Prêtre - Mars 1915
Le bois bombardé. Brancardiers au repos après la bataille (Légende d’origine)
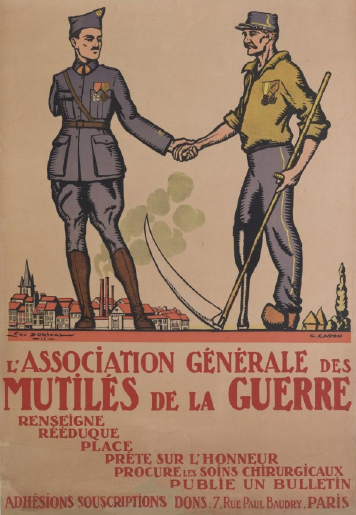
1917
Affiche d’appel au don : Association Générale des Mutilés de La Guerre
BLEU
Dans le jargon militaire, le bleu désigne un soldat novice, qui n’a pas encore fait ses preuves sur le champ de bataille, ou qui a très peu d’expérience en situation de combat.31 (Cf : Baptême du Feu)
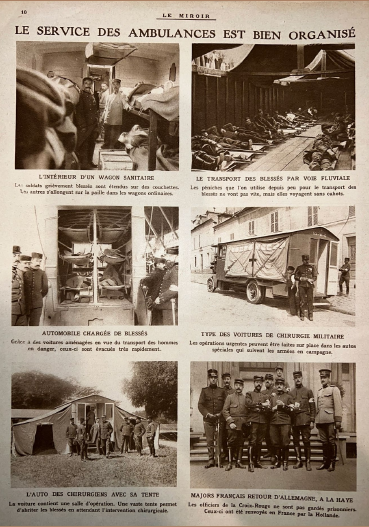
Journal Le Miroir - 4 octobre 1914
Transcription
photo 36
(de gauche à droite, de haute en bas)
« LE SERVICE DES AMBULANCES EST BIEN ORGANISÉ »
« L’intérieur d’un wagon sanitaire »
« Les soldats grièvement blessés* sont étendus sur des couchettes. Les autres
s’allongent sur la paille dans les wagons ordinaires. »
« Le transport des blessés* par voie fluviale »
« Les péniches que l’on utilise depuis peu pour le transport des blessés* ne
vont pas vite, mais elles voyagent sans cahots. »
« Automobile chargée de blessés* »
« Grâce à des voitures aménagées en vue du transport des hommes en danger,
ceux-ci sont évacués très rapidement. »
« Type des voitures de chirurgie militaire »
« Les opérations urgentes peuvent être faites sur place dans les autos
spéciales qui suivent les armées en campagne. »
« L’auto des chirurgiens avec sa tente »
« La voiture contient une salle d’opération. Une vaste tente permet d’abriter
les blessés* en attendant l’intervention chirurgicale. »
« Majors Français retour d’allemagne, à la Haye »
« Les officiers* de la Croix-Rouge ne sont pas gardés prisonniers*. Ceux-ci
ont été renvoyés en France par la Hollande. »
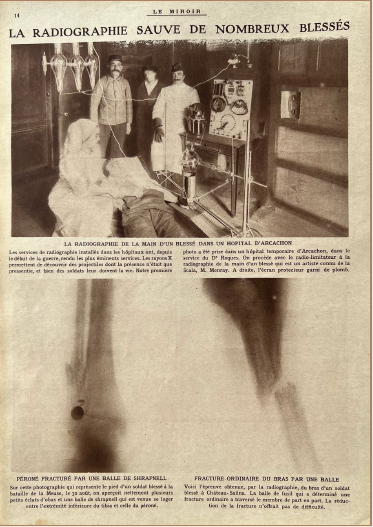
Journal Le Miroir - 24 janvier 1915
Transcription
photo 37
(de gauche à droite, de haute en bas)
« LA RADIOGRAPHIE SAUVE DE NOMBREUX BLESSÉS*»
« La radiographie de la main d’un blessé* dans un hôpital d’Arcachon »
« Les services de radiographie installés dans les hôpitaux ont, depuis
le début de la guerre, rendu les plus éminents services. Les rayons X
permettent de découvrir des projectiles dont la présence n’était que
pressentie, et bien des soldats leur doivent la vie. Notre première photo
a été prise dans un hôpital temporaire d’Arcachon, dans le service du Dr
Roques. On procède avec le radio-limitateur à la radiographie de la main
d’un blessé* qui est un artiste connu de la Scala†, M. Monray. À droite,
l’écran protecteur est garni de plomb. »
« Péroné fracturé par une balle de shrapnell »
« Sur cette photographie qui représente le pied d’un soldat blessé* à la
bataille de la Meuse, le 30 août, on aperçoit nettement plusieurs petits
éclats d’obus* et une balle de shrapnell qui est venue se loger entre
l’extrémité inférieure du tibia et celle du péroné. »
« Fracture ordinaire du bras par une balle »
« Voici l’épreuve obtenue, par la radiographie, du bras d’un soldat blessé*
à Château-Salins. La balle de fusil qui a déterminé une fracture ordinaire a
traversé le membre de part en part. La réduction de la fracture n’offrait pas
de difficulté. »
BLOCKHAUS
Un abri* pour tireur (fusil, mitrailleuse ou canon) est désigné dans le langage militaire comme un blockhaus. Construit à l’origine à l’aide de madriers, d’épaisses planches en bois, il est renforcé avec du béton à partir de mars 1915. L’équivalent français de ce terme d’origine allemande est « fortin ».32

Bois-le-Prêtre◊, Le Quart en réserve - Juin 1915
Blockhaus* en ruines (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 2022
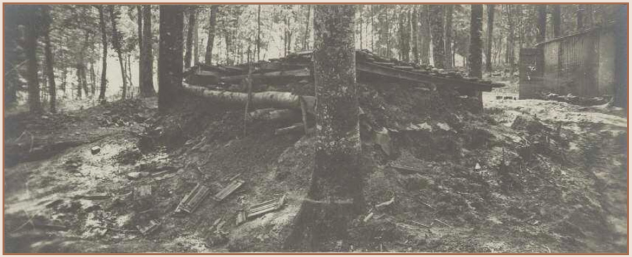
Bois-le-Prêtre◊ - 15 juillet 1916
Ancien blockhaus* d’une pièce de 90 lors de l’attaque de décembre 1914 (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre - 2022
BOCHE
Les Français utilisent le terme « Boche » pour désigner les Allemands. Cette désignation, qu’elle soit utilisée comme substantif ou adjectif, s’est largement
répandue tant parmi les civils que parmi les combattants.33

Friesland - date inconnue
56ème régiment d’infanterie

Lieu inconnu-1914
Mitrailleuse allemande. Modèle Maxim†††††
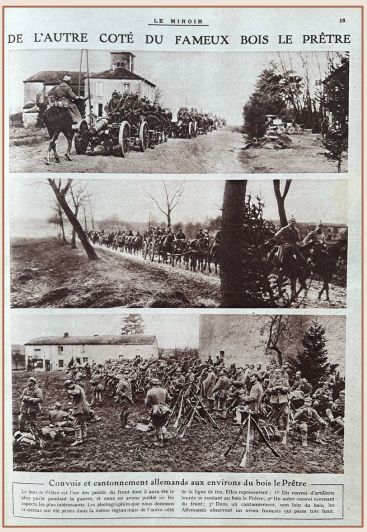
Le Miroir - 24 janvier 1915
Transcription
« DE L’AUTRE CÔTÉ DU FAMEUX BOIS LE PRÊTRE »
« Convois et cantonnement allemands aux environs du bois le Prêtre »
Le bois le Prêtre est l’un des points du front dont il aura été le plus parlé
pendant la guerre, et nous en avons publié ici les aspects les plus intéressants.
Les photographies que nous donnons ci-dessus ont été prises dans la même
région mais de l’autre côté de la ligne de feu. Elles représentent: 1o Un convoi
d’artillerie lourde se rendant au bois le Prêtre; 2o Un autre convoi revenant du
front; 3o Dans un cantonnement, non loin du bois, les Allemands observent un
avion français qui passe très haut. »
BOÎTE À MITRAILLE
La boîte à mitraille est un dispositif cylindrique rempli de balles de plomb que l’artilleur* insère dans le canon de l’arme à feu.
Lors du tir, les balles sont expulsées violemment et se projettent, causant des pertes considérables parmi les troupes ciblées. (Cf: Artillerie (Armes))
L’utilisation de la boîte à mitraille est limitée à courte portée, ce qui augmente les risques de perdre le canon lors des combats de tranchées*.34 (Cf: Stratégie)

Date inconnue
Obus* à balle de 75 mm
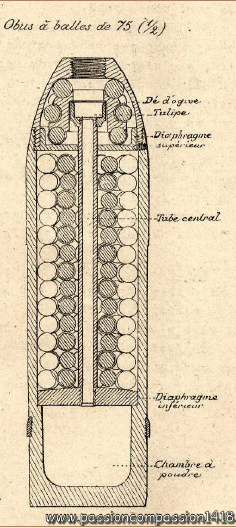
Date inconnue
Coupe d’un obus* à balle de 75 mm
BOUCLIER DE REMPART
Le bouclier de rempart est une plaque de métal ou de bois de grande taille, utilisée pour protéger les soldats dans les tranchées* des tirs ennemis.35 (Cf : Bouclier portatif)
BOUCLIER PORTATIF
Le bouclier portatif, conçu pour un seul soldat, se fixe sur le bord de la tranchée*. Des emplacements de tir sont créés avec des sacs remplis de terre et les boucliers y sont disposés pour que les soldats puissent observer et surveiller le terrain devant eux.36 (Cf : Bouclier de rempart)
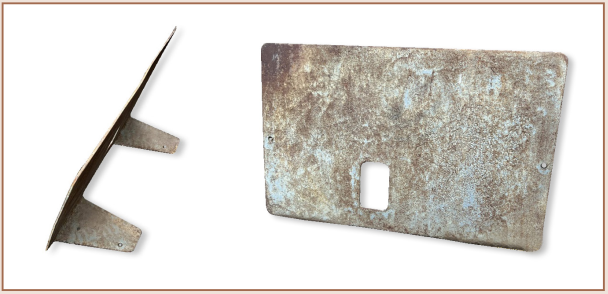
Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024
Bouclier* portatif individuel français de la Première Guerre Mondiale
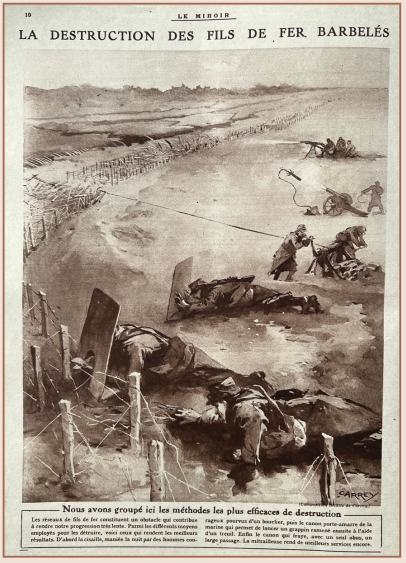
Journal Le Miroir - 17 janvier 1915
Transcription
« LA DESTRUCTION DES FILS DE FER BARBELÉS »
« Nous avons groupé ici les méthodes les plus efficaces de destruction »
« Les réseaux de fils de fer constituent un obstacle qui contribue à rendre notre
progression très lente. Parmi les différents moyens employés pour les détruire, voici ceux
qui rendent les meilleurs résultats. D’abord la cisaille, maniée la nuit par des hommes
courageux pourvus d’un bouclier*, puis le canon porte-amarre de la marine qui permet
de lancer un grappin ramené ensuite à l’aide d’un treuil. Enfin le canon qui fraye, avec
un seul obus, un large passage. La mitrailleuse rend de meilleurs services encore. »
BOULES DE NEIGE (BATAILLE À COUPS DE BOULES DE NEIGE)
Les horreurs liées au contexte de guerre, pèsent sur les soldats qui cherchent du réconfort à la moindre occasion. Ils n’hésitent pas à faire preuve d’imagination et trouvent des sources de distraction pour s’extraire de ce conflit sinistre le temps d’un instant.37 (Cf: Artisanat / Bagues / Football)
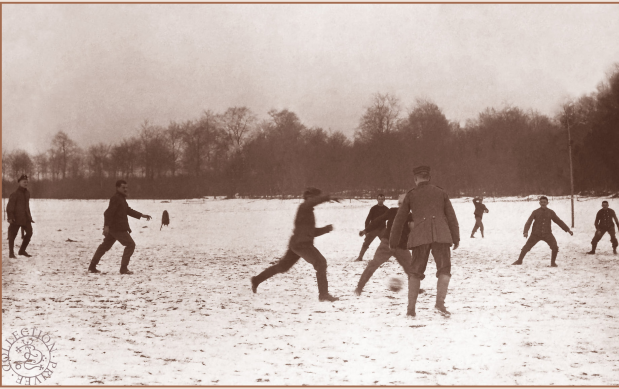
Bois-le-Prêtre◊ - Hiver 1914/1915
Au camp de repos
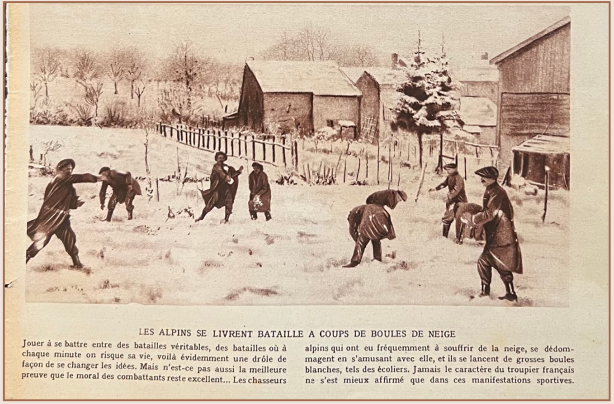
Journal Le Miroir - dimanche 21 février 1915
Transcription
« Les Alpins se livrent bataille à coups de boules* de neige »
« Jouer à se battre entre des véritables batailles, des batailles où à chaque
minute on risque sa vie, voilà évidemment une drôle de façon de se changer
les idées. Mais n’est-ce pas aussi la meilleure preuve que le moral des
combattants reste excellent… Les chasseurs alpins qui ont eu fréquemment à
souffrir de la neige, se dédommageant en s’amusant avec elle, et ils se lancent
de grosses boules* blanches, des des écoliers. Jamais le caractères du troupiers
français ne s’est mieux affirmé que dans ces manifestations sportives. »
BOYAUX
Le boyau est une galerie étroite qui relie les tranchées* de première ligne à celles de deuxième et troisième ligne. Le boyau est généralement perpendiculaire à la ligne de front.38
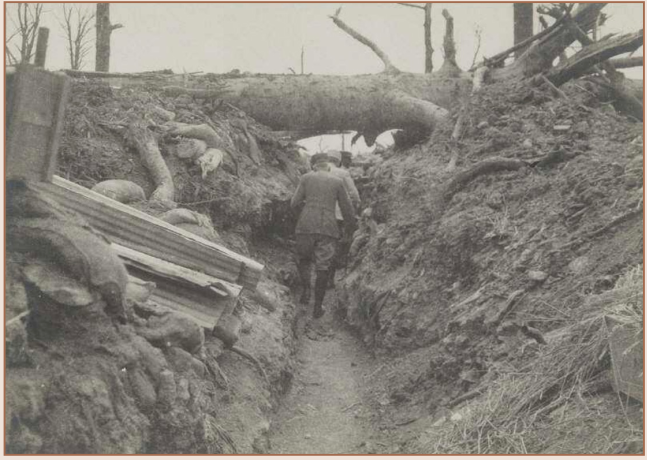
Bois-le-Prêtre◊, Le Quart en réserve - Juin 1915
Boyau en première ligne. (Légende d’origine)
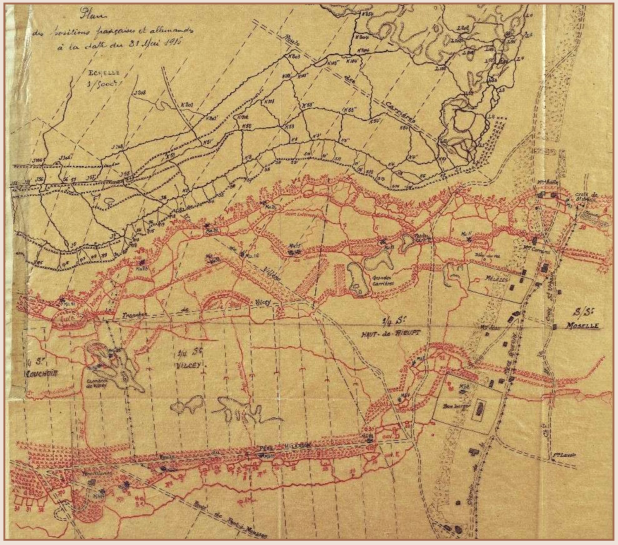
Carte des tranchées* du Bois-le-Prêtre◊
provenant du JMO du 356 régiment d’infanterie - Mai 1915
Les plans directeurs affichent les réseaux
de défense ennemis en bleu et les réseaux alliés en rouge. Ils incluent également des noms de tranchées* et de boyaux* qui sont
de la même couleur que les réseaux, le tout sur un fond noir, avec une indication
de la toponymie du cadastre.
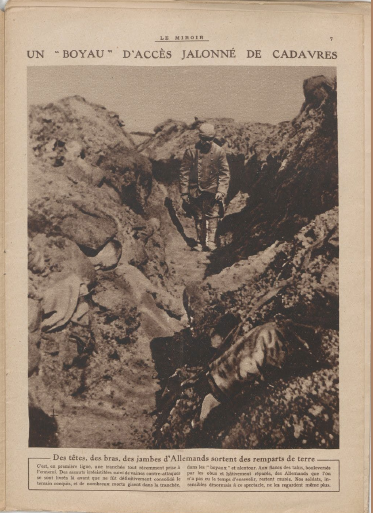
Journal Le Miroir - 11 avril 1915
Transcription
photo 53
« UN BOYAU D’ACCÈS JALONNÉ DE CADAVRES »
« Des têtes, des bras, des jambes d’Allemands sortent des remparts de terre. »
« C’est, en première ligne, une tranchée* tout récemment prise à l’ennemi.
Des assauts irrésistibles suivis de vaines contre-attaques se sont livrés là
avant que ne fût définitivement consolidé le terrain conquis, et de nombreux
morts gisent dans la tranchée*, dans les boyaux* et alentours. Au flanc des
talus, bouleversés par les obus* et hâtivement réparés, des Allemands que
l’on n’a pas eu le temps d’ensevelir, restent murés. Nos soldats, insensibles
désormais à ce spectacle ne les regardent même plus. »
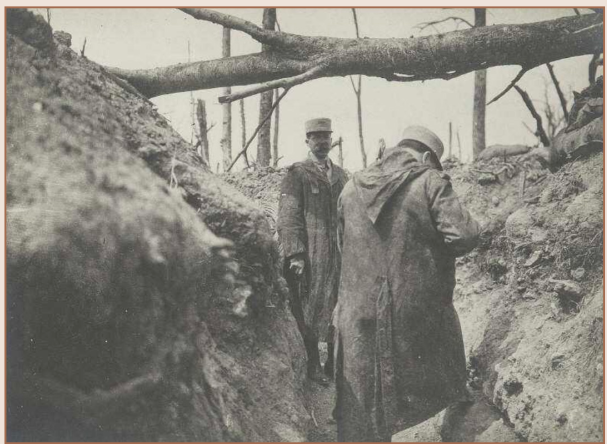
Bois-le-Prêtre◊, Le Quart en réserve - Mai 1915
Boyau de communication (Légende d’origine)
BRIGADE
Une brigade est la réunion de deux à trois régiments d’infanterie*. En principe, elle est placée sous les ordres d’un général* de brigade. Mais à partir de l’été 1914, il n’est pas rare de voir des colonels* en attente de promotion les commander : la perte de généraux*, la rapidité des promotions et la nécessité d’adaptation sont les moteurs de cette mutation hiérarchique.
Le 26 septembre 1914, la brigade mixte de Toul, qui sera par la suite surnommée la « Division* des Loups », est créée. Elle comprend, entre autres, les 167e, 168e et 169e régiments d’infanterie* et est incorporée jusqu’en juillet 1915 dans la 73e division d’infanterie*. Elle évolue ensuite pour former la 128e division d’infanterie*.39
(Cf : Division des Corps armées en 1914 / Loups du Bois-le Prêtre)
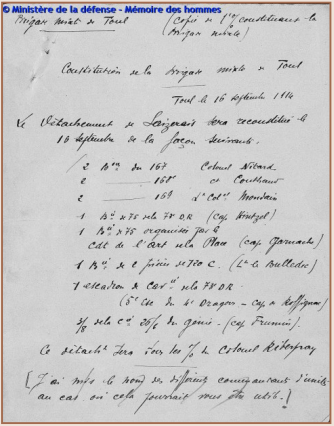
Toul - 16 septembre 1914
Constitution de la Brigade Mixte de Toul
Transcription
Brigade mixte de Toul◊ (copie de l’op† constituant la Brigade mixte)
Constitution de la Brigade mixte de Toul
Toul le 16 septembre 1914
Le détachement de Saizerais sera reconstitué le 16 septembre de la façon
suivante :
Le détachement de Saizerais sera reconstitué le 16 septembre de la façon
suivante :
2 Bies† du 167
Colonel* Nitard
1 Bie de 75 de la 73e DR
1 Bie de 75 organisée par le
Cdt†† de l’Art de la Place
1 Bie de 2 pièces de 120 C.
1 escadron de Cavie†††† de la 73e DR
(5e Esc du 4e Dragons – Cap de Roffignac)
3/8 de la Cie††††† 26/6 du Génie
Colonel* Nitard
Ct Couthaud
Lt Colel Mondain
(Cap Kintzel)
(Cap††† Garnache)
(Lt le Bulledec)
(Cap Frumin)
CALVAIRE : (CF : LIEUX – CROIX DES CARMES)
CANTONNEMENT
Le terme fait référence à la fois à l’endroit où les troupes sont stationnées en dehors des zones de combats et à la situation dans laquelle elles se trouvent. Dans ce sens, il est partiellement synonyme de repos.
Les cantonnements sont généralement des villages situés en retrait du front. Moins rudimentaires, ils offrent plus de confort que les bivouacs*.40

Montauville◊ - 28 octobre 1915
Cantonnement* dans le secteur de Montauville◊ (Légende d’origine)

Esnes - 13 janvier 1916
Soldats au cantonnement* (Légende d’origine)
CAPITAINE
Le capitaine est un officier* spécifiquement chargé dans un bataillon* de l’instruction de la troupe. Il est directement rattaché au chef de bataillon*.41 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
CAPORAL
Le caporal, en tant que commandant d’une escouade*, occupe le premier échelon de la hiérarchie militaire. Son insigne se distingue par ses deux galons de laine rouges.42 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
CAPOTE
La capote est un vêtement chaud et couvrant qui fait partie de l’uniforme français. Elle est conçue pour protéger les soldats des intempéries. Au cours de la guerre, la capote à connu plusieurs modèles, tant droits que croisés.
En quelques mois, plusieurs variantes sont successivement produites. Sur la capote dite du « 2ème type » la poche poitrine gauche est supprimée. Les soldats percevant ce second modèle dépourvu de poches utiles, se confectionnent eux même des poches artisanales à la poitrine ou aux hanches.43 (Cf: Tenue de Campagne / Képi / Musette / Casque Adrian / Baïonnette)
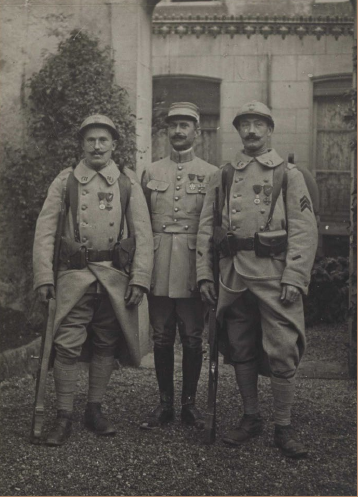
Ligny-en-Barrois, Novembre 1916
Aux extrémités : Soldats revêtant une capote de 2ème type. Poches supprimées et boutonnage
croisé. Au centre : Capote de modèle original, poches et boutonnage droit.
CARAPACE
Comme la tortue* ou encore l’écaille, la carapace désigne une position défensive. Les soldats se couchent, se recroquevillent et se protègent avec leurs boucliers* pour se protéger des éclats d’obus* lors d’une attaque.44
CASQUE ADRIAN
Le casque Adrian M 1915, est le casque standard des forces militaires françaises pendant la Première Guerre mondiale.
Sa conception est précipitée en réponse à l’urgence créée par le nombre exponentiel de blessures à la tête sur le champ de bataille. Elles sont devenues une cause majeure de pertes et la principale menace qui guette les soldats.45
L’usine Japy, connue pour sa production de casseroles, joue un rôle essentiel pendant la guerre, en concevant et fabriquant le casque Adrian. Ce casque, commandé pour la première fois par le sous-intendant militaire Louis Adrian le 21 mai 1915, est produit à hauteur de 1,6 million d’exemplaires par les usines Japy frères, basées à Paris et à Beaucourt. La conception du casque est réalisée en coopération avec Louis Kuhn, responsable de l’atelier d’agrafage mécanique au sein de l’entreprise.46 (Cf: Effort de Guerre)
La conception et la qualité du casque Adrian sont saluées pour leur efficacité et leur protection accrue par rapport aux casques précédemment utilisés par les soldats français. Avant l’adoption du casque Adrian, 77% des blessures des poilus* sont situées à la tête, un chiffre qui tombe à 22 % en 1916.47

Usine Japy - 1915
Soudage des visières et des couvre-nuques.

Casque Adrian* de Jules Henri Colliot
Ce casque est certainement d'après guerre. Probablement
utilisé par Henri lors de son service dans la Défense Passive de Paris en 1939.
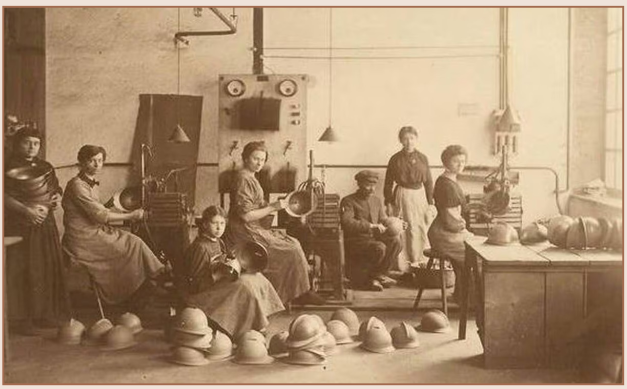
Usine Japy - 1915
Les ouvriers de l’usine vernissaient les casques de la couleur bleu horizon,
avant de les faire sécher au four.
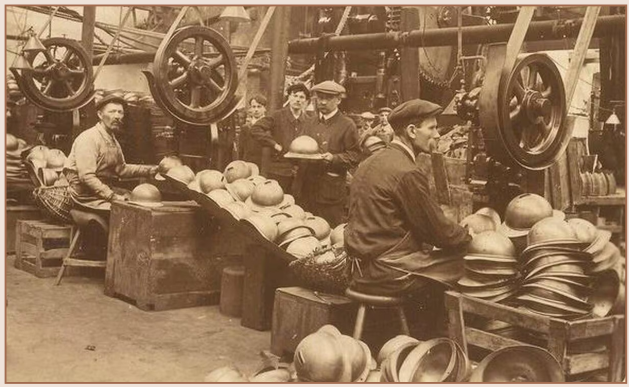
Usine Japy - 1915
Perçage des trous d’aération sur le sommet du casque Adrian.
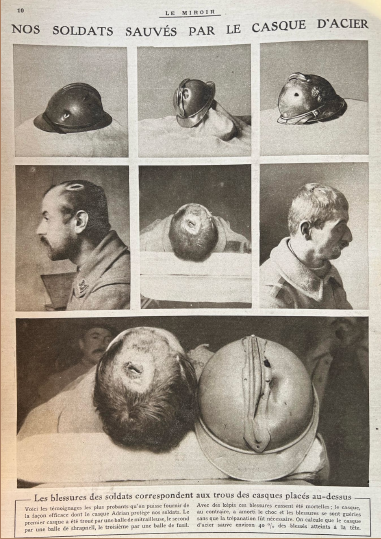
Journal Le Miroir - 30 janvier 1916
Transcription
photo 63
« NOS SOLDATS SAUVÉS PAR LES CASQUE* D’ACIER »
« Les blessures des soldats correspondent aux trous des casques* placés au-dessus »
« Voici les témoignages les plus probants qu’on puisse fournir de la façon efficace dont le casque* Adrian protège nos soldats. Le premier casque* a été troué par une balle de mitrailleuse, le second par une balle de shrapnell, le troisième par une balle de fusil. Avec des képis* ces blessures eussent été mortelles ; le casque*, au contraire, a amorti le choc et les blessures se sont guéries sans que la trépanatio6† fût nécessaire. On calcule que le casque* d’acier sauve environ 40% des blessés* atteints à la tête. »
CASQUETTE
Une casquette est une structure de protection construite au-dessus des tranchées* pour abriter les soldats des tirs ennemis, des éclats d’obus* et des intempéries (Cf: Pompes). Elle améliore leur sécurité en tant qu’objet défensif crucial. (Cf: Bouclier de rempart / Créneau / Parados / Parapet) 48
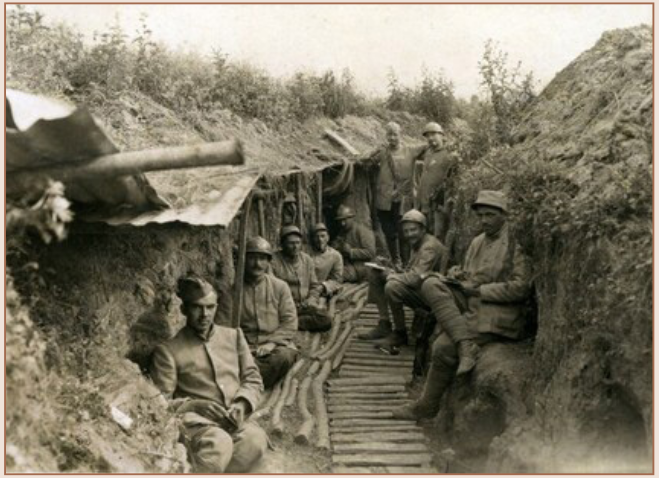
Lieu Inconnu - 1915
Tranchée* française avec casquette
CIE / COMPAGNIE
La compagnie est un groupe de militaires regroupant 250 hommes en moyenne, le plus souvent commandé par un capitaine* . Les effectifs d’une compagnie varient à l’échelle du territoire et en fonction du contexte. Le plus souvent, la compagnie est une subdivision d’un bataillon* mais tel n’est pas toujours le cas: la compagnie est alors dite hors-rang*. La compagnie se divise en deux pelotons placés chacun sous le commandement d’un lieutenant* ou d’un sous-lieutenant*.49 (Cf: Division d’Infanterie / Compagnie Hors Rang (CHR) our (HR) / Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
CITÉ / CITATION
Signaler un acte valorisé par l’armée, tel qu’un comportement valeureux, une attaque réussie ou la repousse d’une attaque ennemie, est un acte appelé la citation. Elle rappelle l’action et met le ou les récipiendaires à l’honneur.
Une citation peut être individuelle ou collective et peut être effectuée à différents niveaux hiérarchiques: on la retrouve à l’ordre du régiment*, de la division*, du corps d’armée, de l’armée ou du Grand Quartier Général (Cf: Division des Corps d’Armée en 1914).
Elle est publiée, lue dans toutes les formations de la grande unité concernée et inscrite au registre d’ordre du corps d’appartenance. La citation, en étant inscrites au Journal officiel de la République Française, est portée à la connaissance de la Nation et de la troupe.50
Au 1er mars 1920, on dénombre environ 2 055 000 citations attribuées. Ce chiffre inclut les citations attribuées lors de la remise de la Légion d’honneur* et de la Médaille militaire*, ainsi que les citations décernées à titre posthume. 51 (Cf: Croix de Guerre / Légion d’Honneur)
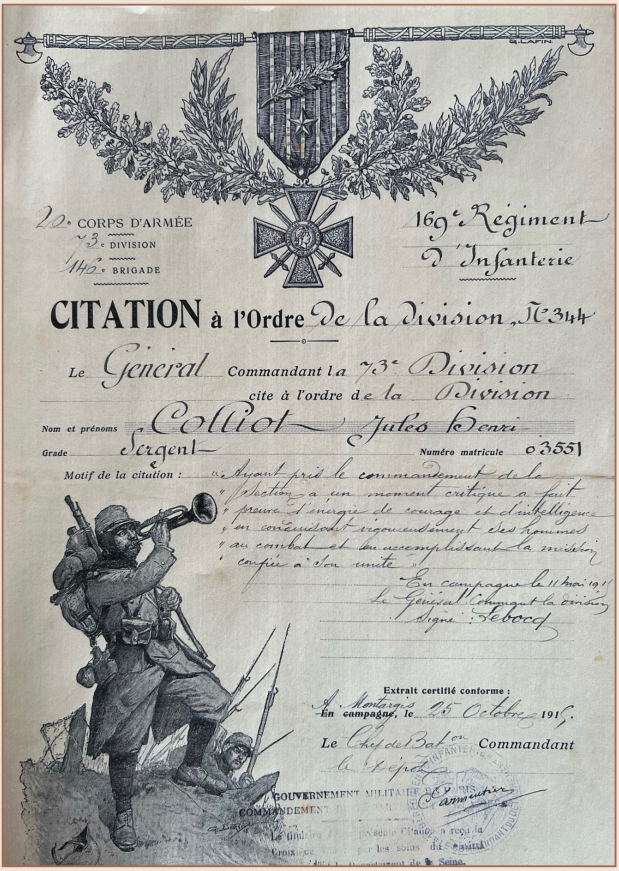
Montargis - 25 octobre 1915
Citation* à l’Ordre de la Division* de Jules Henri Colliot
COLONEL
Le colonel désigne un grade* militaire de haut rang au sein des forces armées. Les colonels ont la responsabilité de commander des régiments* ou des unités importantes sur le terrain.52 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
COLONIES
Durant la guerre, la France intensifie l’utilisation de ses colonies pour faire face à la crise des effectifs, ce qui se traduit par une augmentation notable de la présence des unités d’outre-mer dans son armée. Parmi les 8,5 millions d’hommes mobilisés pour ce conflit, 600 000 soldats sont originaires des colonies d’outre mer. 53
Les taux de mortalité de la Grande Guerre sont comparables, que ce soit pour les Français originaires de métropole (17%), les Français originaires de l’Empire (16%), les enrôlés originaires d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie (16%) ou les enrôlés originaires d’Afrique Noire (entre 15 et 18%).54
Officiellement composées de «volontaires», ces troupes sont souvent désignées à l’administration par des chefs indigènes locaux en échange d’avantages tels que des terres, des primes, des bourses scolaires pour leurs enfants, etc. Face à la difficulté du recrutement, des formes de conscription sont décidées dans certaines colonies. À partir de 1915, cette décision provoque une véritable guerre en Afrique Occidental Française (AOC), mobilisant 800 000 à 900 000 personnes, soit 8% de la population totale de la colonie. Les résistances, alimentées par la rumeur d’une défaite française face à l’Allemagne, entraînent une répression mobilisant toutes les troupes encore disponibles en AOF et faisant environ 30 000 morts. Des résistances similaires, bien que de moindre envergure, sont présentes en Algérie en
1916-1917 et en Indochine en 1916.55 (Cf: Tirailleurs)
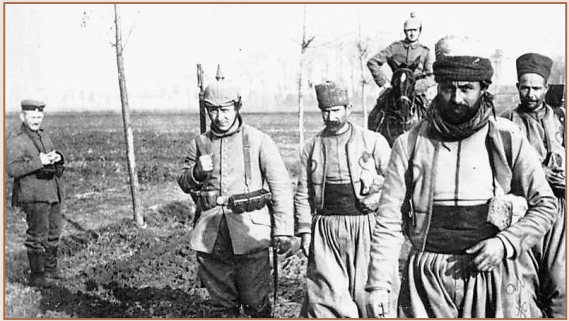
Lieu inconnu - 1914
Tirailleurs* algériens prisonniers* de l’armée allemande
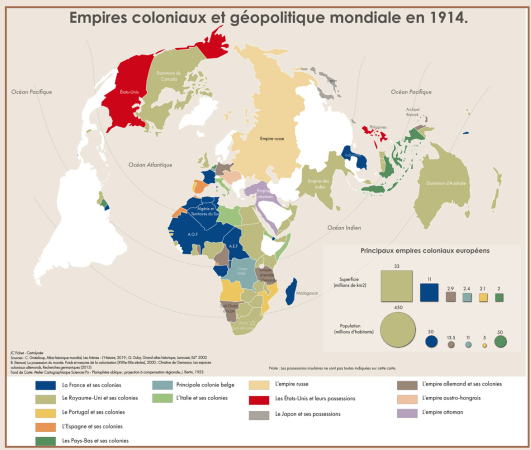
Empire coloniaux et état de la géopolitique mondiale en 1914
COMITÉ FRANÇAIS DE LIBÉRATION NATIONALE
Le 3 juin 1943 marque, à Alger, la naissance du Comité français de Libération nationale (CFLN). Il est présidé conjointement par le général de Gaulle, représentant les Français de Londres et le général Giraud, représentant ceux d’Alger. Cette fusion des autorités françaises engagées dans la guerre vise à unifier l’effort de guerre et à préparer la Libération.56 Les membres de la France Libre, des résistants unis par des idéaux républicains, collaborent étroitement avec le CFLN. Après le débarquement de Normandie, la France Libre parvient à rétablir l’autorité française en nommant des représentants locaux dès lors que les communes sont libérées. La libération de Paris conduit à la formation du Gouvernement provisoire de la République française par le CFLN, rétablissant les libertés républicaines et lançant des réformes de fond tout au long des années 1944 et 1945.57
COMPAGNIE HORS RANG (CHR) OUR (HR)
La compagnie hors rang s’occupe de toute l’intendance du régiment*. Elle se charge de tout ce qui touche au fonctionnement administratif et logistique et veille également à l’approvisionnement en matériel, habillement, nourriture, brancardiers et aux travaux de protection. On compte une compagnie par régiment*.58 (Cf : Cie ou Compagnie / Division d’Infanterie / Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
CONSIGNÉ
Un quartier consigné est une zone placée sous le contrôle de l’armée et soumise à des règles et réglementations strictes.59
CONTREMANDE
L’acte de contremander revient à annuler une prérogative antérieure, c’est une contre-commande.60
CONTEXTE HISTORIQUE
(Voir site internet www.cestmoche.com/contexte-historique)
CORVÉE DE PIQUET
La corvée de piquet est une mission réalisée par les soldats sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Elle implique la réalisation de travaux de fortification et la mise en place d’obstacles défensifs pour renforcer les positions et décourager les attaques ennemies. (Cf : Section de Piquet)
Les soldats en corvée de piquet ont pour responsabilité d’installer des piquets, des fils de fer barbelés, des chevaux de frise et d’autres éléments de défense le long des lignes de front. (Cf : Bouclier).
Le fil de fer barbelé, avec ses pointes acérées et sa configuration, sert à créer des obstacles infranchissables pour les troupes ennemies. Les chevaux de frise forment une barrière de pointes métalliques, capables d’entraver les mouvements de l’infanterie et des véhicules adverses. (Cf : Régiment d’Infanterie / Batterie)
Cette mission est périlleuse : les soldats doivent s’aventurer hors des tranchées*, dans des zones potentiellement en proie aux tirs ennemis ; les travaux de fortification les exposent non seulement aux balles, mais aussi aux éclats d’obus* et aux autres dangers inhérents au champ de bataille. Lorsque la visibilité est réduite, la nuit ou par mauvais temps, les troupes sont d’autant plus vulnérables aux attaques surprises.61
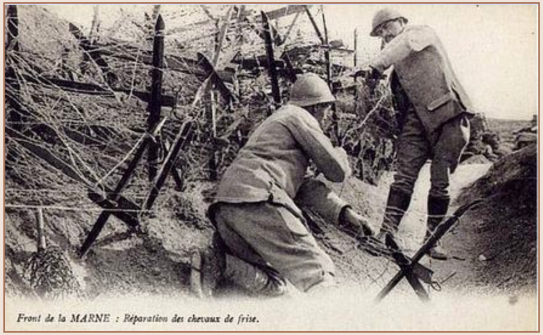
Marne - Mai 1917
Réparation de chevaux de frise (Légende d’origine)
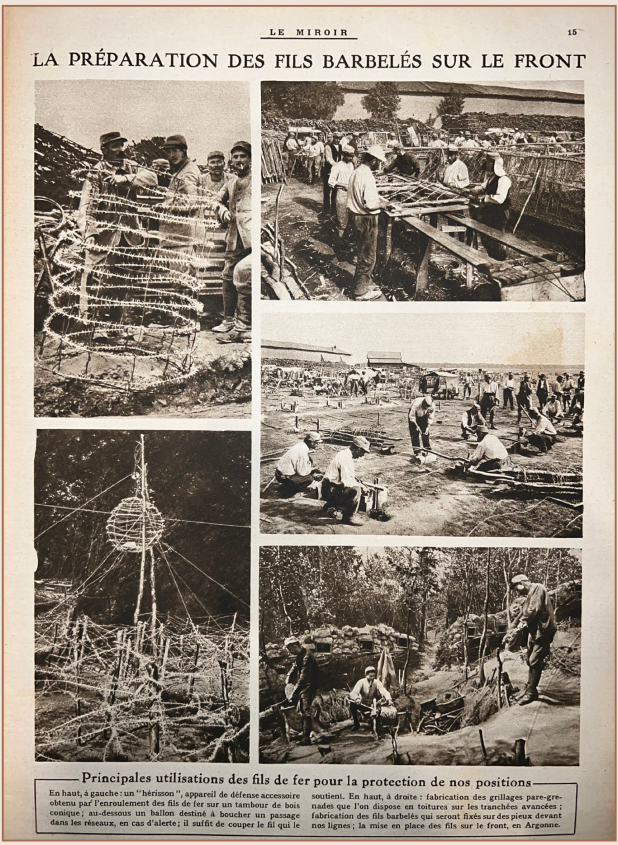
Journal Le Miroir - 12 décembre 1915
Transcription
« LA PRÉPARATION DE FILS BARBELÉS SUR LE FRONT »
« Principales utilisations des fils de fer pour la protection de nos positions »
« En haut, à gauche : un « hérisson », appareil de défense accessoire obtenu
par l’enroulement des fils de fer sur un tambour de bois conique ; au-
dessous un ballon destiné à boucher un passage dans les réseaux, en cas
d’alerte ; il suffit de couper le fil qui le soutient. En haut, à droite : fabrication
des grillages pare-grenades que l’on dispose en toitures sur les tranchées*
avancées ; fabrication des fils barbelés qui seront fixés sur des pieux devant
nos lignes ; la mise en place des fils sur le front, en Argonne. »

Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Tranchée* clayonnée et fils de fer barbelés (Légende d’origine)
CORVÉE DE SALUBRITÉ
Pendant la Première Guerre mondiale, les corvées de salubrité sont des missions entreprises pour améliorer les conditions sanitaires dans les zones de combat.
Ces obligations comprennent diverses tâches visant à maintenir l’hygiène et la propreté dans les environnements difficiles des tranchées* et des zones de vie des soldats (Cf : Bivouac). Parmi les corvées prioritaires figurent la construction de latrines (Cf : Feuillées), la mise en place de puits et de points d’eau potable, ainsi que la collecte et l’élimination des déchets.
Ces travaux sont essentiels pour prévenir la propagation de maladies infectieuses et maintenir les troupes dans un bon état de santé malgré les circonstances difficiles.62
La situation dans les tranchées est loin d’être idéale : l’accumulation de déchets et de cadavres non enterrés crée un environnement propice à la prolifération des maladies et des rats. Ces rongeurs, attirés par la nourriture et les déchets, se multiplient rapidement et vivent aux côtés des soldats.63
(Cf : Fièvre Typhoïde/ Corvée des morts)

Lieu Inconnu - 1915
Après une chasse au rat dans une tranchée* de 2ème ligne (Légende d’origine)
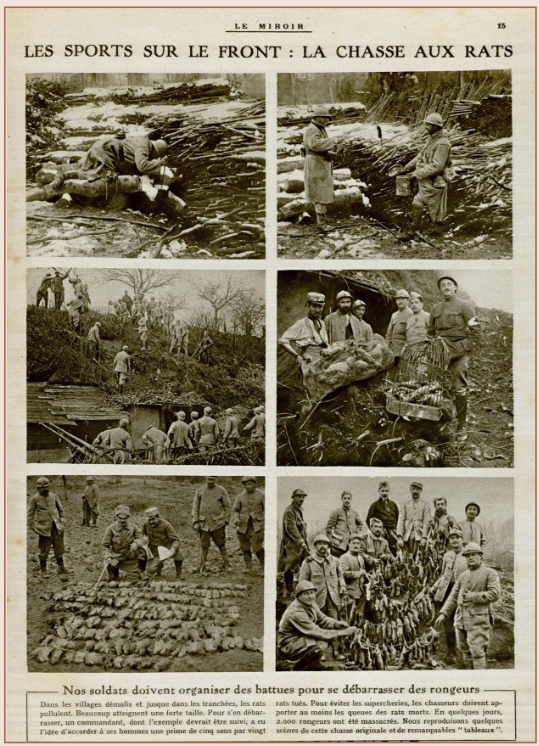
Journal Le Miroir - 26 décembre 1915
Transcription
« LES SPORT SUR LE FRONT : LA CHASSE AUX RATS »
« Nos soldats doivent organiser des battues pour se débarrasser des rongeurs. »
« Dans les villages démolis, et jusque dans les tranchées*, les rats pullulent.
Beaucoup atteignent une forte taille. Pour s’en débarrasser, un commandant,
dont l’exemple devrait être suivi, a eu l’idée d’accorder à ses hommes une
prime de cinq sous pour vingt rats tués. Pour éviter les supercheries, les
chasseurs doivent apporter au moins les queues des rats morts. En quelques
jours, 2.000 rongeurs ont été massacrés. Nous reproduisons quelques scènes
de cette chasse originale et des remarquables « tableaux ». »
CORVÉE DES MORTS
La corvée des morts, également connue sous le nom de corvée funèbre, est une pratique impliquant la récupération des cadavres de soldats tombés au combat ainsi que leur enterrement. Le début du conflit marque la généralisation de ce procédé, qui devient pratique courante pour de multiples raisons.
La décomposition des dépouilles crée un environnement propice à la propagation de maladies dévastatrices. Un exemple célèbre de ce phénomène est la maladie dénommée la « fièvre* des tranchées* » : une pathologie transmise par les poux et causant de la fièvre*, des maux de tête, des douleurs aux jambes et des problèmes cardiaques majeurs. On estime ses ravages à plus d’un million de têtes entre 1914 et 1918.64
Outre les effets sur la santé physique, les séquelles psychologiques se révèlent profondes. L’odeur nauséabonde et la vision des corps en décomposition hantent les soldats et contribuent à l’apparition du syndrome de stress post-traumatique. Vivre au milieu des morts sape* le moral des troupes : les soldats, constamment confrontés à l’horreur, perdent souvent leur détermination et leur volonté de combattre.65
Sur le plan logistique, les corps abandonnés entravent les mouvements des troupes et des approvisionnements, compliquant ainsi les opérations militaires déjà difficiles. (Cf : Artillerie (Armes))
En conséquence , les exhumations et transferts de corps depuis les zones de combat sont interdits dès l’été 1914. Les cadavres doivent dorénavant être enterrés sur le lieu du décès, dans des fosses communes qui comptent une centaine d’hommes.66
Mais laisser les morts sans sépulture appropriée va à l’encontre des normes humanitaires et des conventions internationales, comme les conventions de Genève, qui préconisent le traitement respectueux des morts, même en temps de guerre La pratique des fosses communes devient rapidement scandaleuse pour des raisons sanitaires et morales et une réaction populaire émerge en France et en Allemagne avec des milliers de lettres* demandant le droit de récupérer les corps de défunts ou une inhumation individuelle respectueuse.66
En réponse à cette préoccupation, les états-majors français et allemands interdisent les exhumations hâtives pour permettre une identification ultérieure. Les soldats sont généralement reconnus grâce à des plaques d’identités en cuivre qu’ils portent autour de leur cou durant les combats. Ce moyen d’identification, introduit en Allemagne en 1869 et en France en 1881, est en service jusqu’à la fin de l’année 1940.

Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Le Col de Cygne après l'attaque. Relève de cadavres allemands que l'on enterre sur place.
(Légende d’origine)
En France, la loi du 29 décembre 1915 garantit le droit à une tombe individuelle identifiée et établit une nouvelle pratique funéraire basée sur l’identification des défunts, l’inhumation dans un cercueil, l’information des familles, des funérailles conformes à la religion de l’individu et la gestion et l’entretien des tombes, ainsi que le regroupement des corps dans des nécropoles.
En plus de représenter une avancée sanitaire cruciale , ce processus impacte considérablement sur la psychologie des soldats, qui peuvent enfin rendre un dernier hommage à leurs camarades défunts.68

Bois-le-Prêtre◊ - Mai 1915
Transport de cadavres relevés sur le champ de bataille (Légende d’origine)
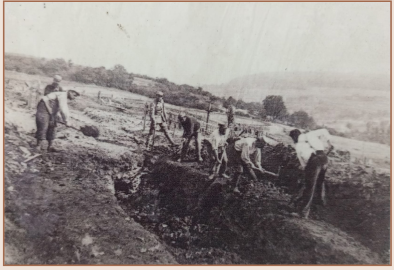
Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1915
Creusement d’une fose commune (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1915
Entre le Quart en réserve et le Gros chêne.
Relève de cadavres allemands que l’on enterre sur place (Légende d’origine)
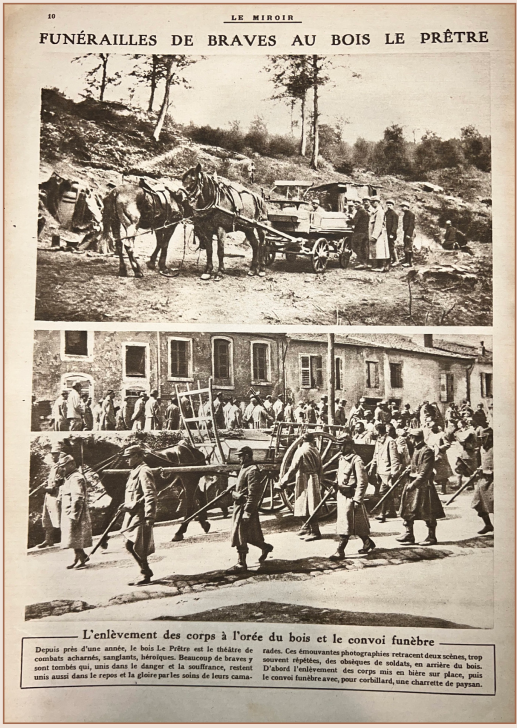
Journal Le Miroir - 26 septembre 1915
Transcription
photo 77
« FUNÉRAILLES DES BRAVES AU BOIS LE PRÊTRE »
« L’enlèvement des corps à l’orée du bois et le convoi funèbre » « Depuis près d’une année, le bois le Prêtre est le théâtre de combats acharnés, sanglants, héroïques. Beaucoup de braves y sont tombés qui, unis dans le danger et la souffrance, restent unis aussi dans le repos et la gloire par les soins de leurs camarades. Ces émouvantes photographies retracent deux scènes, trop souvent répétées, des obsèques de soldats, en arrière du bois. D’abord l’enlèvement des corps mis en bière7† sur place, puis le convoi funèbre avec, pour corbillard, une charrette de paysan. »

Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Transport d’un mort
CRÉNEAU
Un créneau est une ouverture dans le mur de terre d’une tranchée* de première ligne, utilisée pour observer ou tirer.69

Bois-le-Prêtre◊ - Février 1916
La maison forestière du père Hilarion◊ vue d'une tranchée*
avec créneaux* (Légende d’origine)
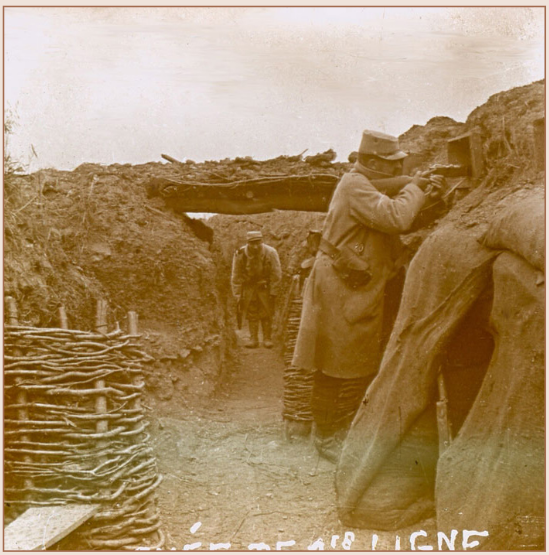
Lieu inconnu - 1914
Soldat dans une tranchée*, derrière un créneau*
CROIX DE GUERRE
Au début de la guerre, certains soldats, sous-officiers* et officiers* sont cités* à l’ordre de leurs unités et reçoivent des mentions honorifiques. Les citations* apparaissent également à échelle collective, quelques régiments* se voyant attribuer des citations mettant en avant leurs actions remarquables.
Néanmoins, ces actes demeurent peu répandus et génèrent un sentiment de manque de reconnaissance au sein du corps armé. L’observation de soldats étrangers et alliés portant des décorations incite, dès le début de la guerre, à des initiatives personnelles, où certains chefs de corps choisissent de décorer leurs soldats avec des médailles non réglementaires.70
Face à cette problématique plusieurs personnalités, qu’elles soient politiques ou des officiers, tels que Driant, député de Nancy◊ et commandant de bataillon*, ont l’idée de créer un nouvel insigne visible pour récompenser les actes de courage des combattants. C’est ainsi que la croix de guerre est instituée par la loi du 8 avril 1915. Cette nouvelle décoration vient compléter la médaille militaire* et la Légion d’honneur* pour récompenser les actes d’héroïsme et de bravoure pendant la guerre.
Son objectif est de « commémorer, depuis le début des hostilités, les citations individuelles pour faits de guerre à l’ordre des armées de terre et de mer, des corps d’armée, des divisions*, des brigades* et des régiments. »7†
La croix de guerre se décline en différents modèles : avec des palmes ou des étoiles, en fonction de la valeur de la citation accordée. Sa popularité est telle que plus de deux millions de croix de guerre individuelles sont attribuées entre 1914 et 1918. Cette mention honorifique est progressivement élargie aux unités, puis à des villes , telles que Dunkerque en octobre 1917.

Mars 2024
Croix de guerre en bronze avec deux étoiles à
l’Ordre de l’Armée, attribuée à Henri Colliot le 25 octobre 1915
DEVOIR
Au cours de la Première Guerre mondiale, l’autorité militaire subit des changements significatifs.
En 1913, le Code de Justice Militaire est promulgué, donnant aux officiers* et sous-officiers* le devoir de maintenir la discipline et de contraindre lessoldats à l’obéissance par tous les moyens nécessaires.
« Les officiers* et les sous-officiers* ont le devoir de s’employer avec énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur place, par tous les moyens, les militaires sous leurs ordres ; au besoin, ils forcent leur obéissance. »†
Bien que l’expression d’exécution sommaire ne soit pas explicitement utilisée, cette disposition laisse peu de place au doute. Contraindre à l’obéissance à tout prix suggère que les officiers* et sous-officiers* ont l’autorité de prendre des mesures drastiques pour maintenir la discipline et l’ordre au sein des forces armées, quitte à aller jusqu’à l’exécution.72
Mais avec le déclenchement du conflit et la mutation des corps d’armée une transformation majeure a lieu. Une autorité individuelle devient
prépondérante au sein des troupes, en grande partie en raison de la spécialisation croissante des unités, dorénavant plus restreintes en termes d’effectif. Cette évolution conduit les soldats à obéir davantage à leur chef de section*, plus proche d’eux que le chef de compagnie*. Elle favorise ainsi une décentralisation de l’autorité et une proximité entre les donneurs d’ordre et les soldats.
Contrairement à l’obéissance totale traditionnelle, les soldats commencent à conditionner leur obéissance à la justification des ordres, en particulier en dehors du champ de bataille. La brutalité excessive est limitée, car elle peut rompre le lien de confiance et l’autorité évolue vers une dimension plus maternelle, contrairement à la vision traditionnelle d’avant la guerre.73
Pourtant, des actes de rébellion perdurent. Le refus de monter au front demeure l’acte de désobéissance le plus courant pendant la Grande Guerre. Dès le mois de septembre 1914, le général Joffre**, confronté à de nombreux cas de paniques et de mutilations volontaires parmi les troupes, prend la décision de mettre en place des conseils de guerre spéciaux. Ils ont pour mission de juger rapidement les soldats accusés de désertion, de refus d’obéissance et d’abandon de poste* en présence de l’ennemi. Face à un commandement préoccupé par la propagation de l’indiscipline, la réponse est univoque : la répression stricte envers toute forme de défaillance, même en cas de simples soupçons.74
La base de données répertoriant les personnes exécutées pendant la Première Guerre mondiale‡ compte 835 soldats et 174 civils, pour un total de 1 009 exécutions. La désertion en présence de l’ennemi constitue de loin l’accusation la plus fréquente, présente dans plus de 68,1 % des dossiers individuels. D’autres accusations courantes incluent la désertion (13,9%), le refus d’obéissance (17,3%) et les voies de fait ou insultes envers un supérieur (11,2%).75
DEVOIR* ET EXÉCUTIONS MILITAIRES :
QUELQUES EXEMPLES DES MARTYRES DE LA GRANDE GUERRE
▶ JEAN-MARIE JUQUEL
Le soldat Jean-Marie Juquel du 36ème régiment d’infanterie* Coloniale est exécuté le 29 août 1914 à Gerbéviller, en Meurthe-et-Moselle. A l’âge de 28 ans, il devient le premier poilu* exécuté du conflit.74

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle - 29 août 1914
Jean-Marie Juquel, premier fusillé.
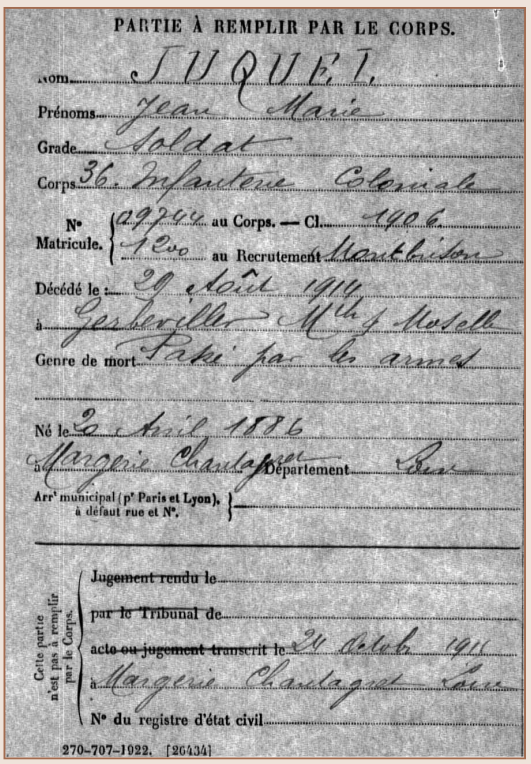
Margerie Chantagret - 24 octobre 1914
Fiche de décès de Jean-Marie Juquel
▶ FRÉDÉRIC HENRI WOLFF
Le 1er septembre 1914, à Remenoville◊, Frédéric Henri Wolff, commandant de bataillon* du 36ème régiment d’infanterie* coloniale, est accusé d’avoir tenté de capituler et incité ses troupes à la fuite devant l’ennemi.
Quatre témoignages dans le dossier de procédure de 1914 accusent le commandant d’avoir agité un mouchoir blanc attaché à la baïonnette* d’un fusil. Wolff, qui avait initialement avoué sa tentative de reddition au général* Durupt, nie ces accusations. Malgré sa tentative de défense, il est exécuté à l’issue de son jugement.
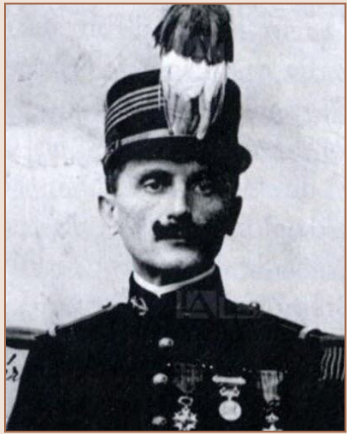
Date et lieu inconnus
Frédéric Henri Wolff
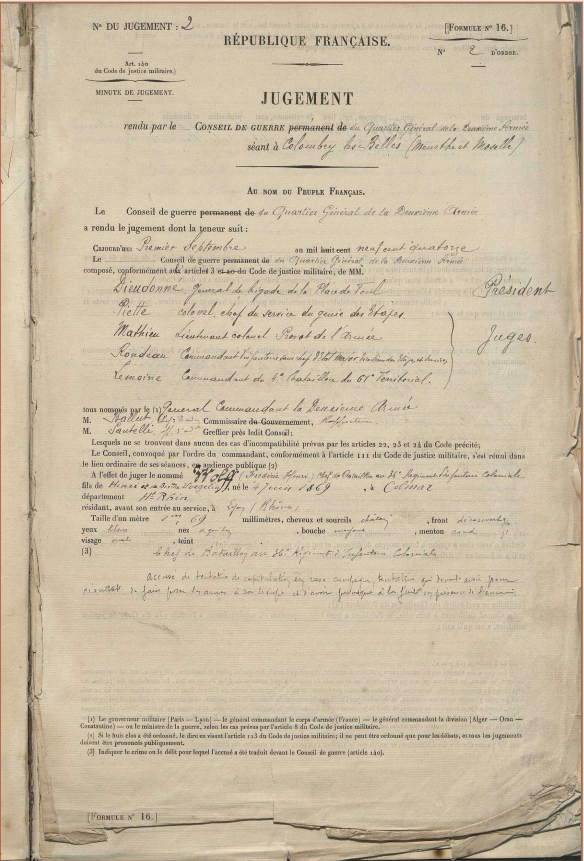
Colombey-Les-Belles - 1er septembre 1914
Fiche de jugement du Conseil de Guerre de Henri Wolff
▶ JEAN BAPTISTE EUGÈNE BOURET
Jean Baptiste Eugène Bouret, soldat dans le 48e régiment d’artillerie*, est gravement blessé* par l’explosion d’un obus* allemand le 29 août 1914. Il perd connaissance à côté d’un camarade décédé et se révèle hébété en raison de la commotion.
Il est amené au poste* de secours mais le médecin ordonne une évacuation à l’arrière. Désorienté, Eugène Bouret s’éloigne et se perd dans la nature. Il erre jusqu’au 3 septembre où un capitaine* le découvre dans une grange à Taintrux. Méfiant face à ses réponses incohérentes, il l’arrête pour désertion.
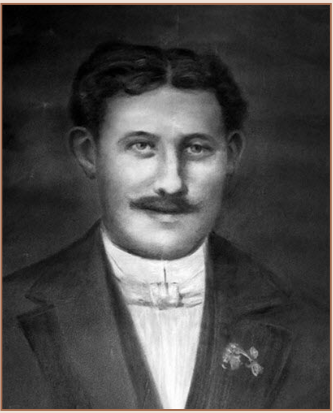
Date et lieu inconnus
Jean Baptiste Eugène Bouret
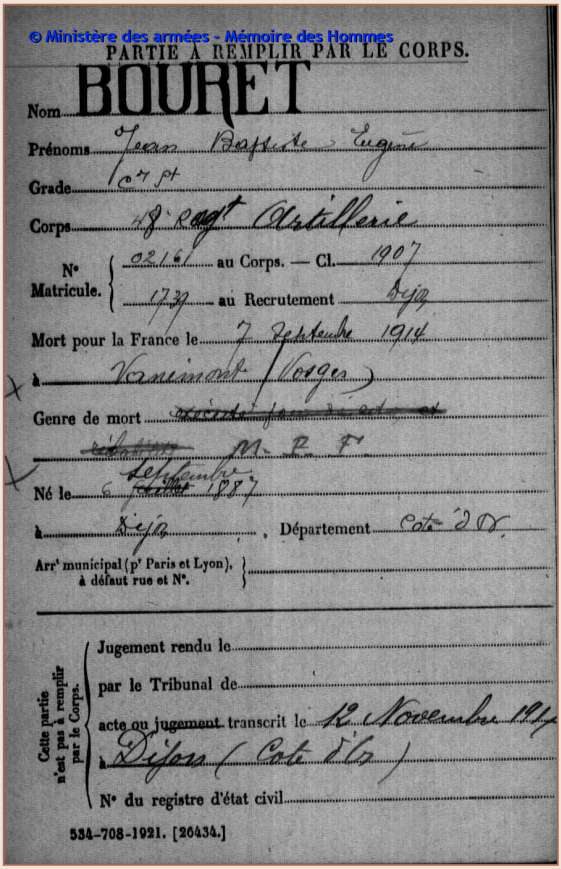
Dijon - 12 novembre 1914
Fiche de décès de Jean Baptiste Eugène Bouret
▶ LES SIX MARTYRES DE VINGRÉ
Le 27 novembre 1914, à Vingré, dans l’Aisne, les Allemands attaquent une tranchée* française de première ligne. Les Français, pris au dépourvu, reçoivent l’ordre de se replier par le sous-lieutenant Paulaud, mais sont ensuite sommés de reprendre leurs positions par le lieutenant* Paupier.
Le commandement français reproche un manque de vigilance et de discipline. Le général* de Villaret saisit cette occasion pour faire un exemple: 24 soldats sont traduits en conseil de guerre, accusés d’abandon de poste* devant l’ennemi.
Six d’entre eux sont condamnés à mort. Les soldats Jean Blanchard, Francisque Durantet, Pierre Gay, Claude Pettelet, Jean Quinault et le caporal* Paul Floch sont fusillés à Vingré le 4 décembre 1914. Les dix huit autres sont acquittés mais le général de Villaret leur inflige une punition de 60 jours de prison (Cf : prisonniers).

Les six martyrs de Vingré. De gauche à droite et de haut en bas : Henri Floch
, Pierre Gay, Jean Quinault, Francisque Durantet, Claude Petellet, Jean Blanchard.
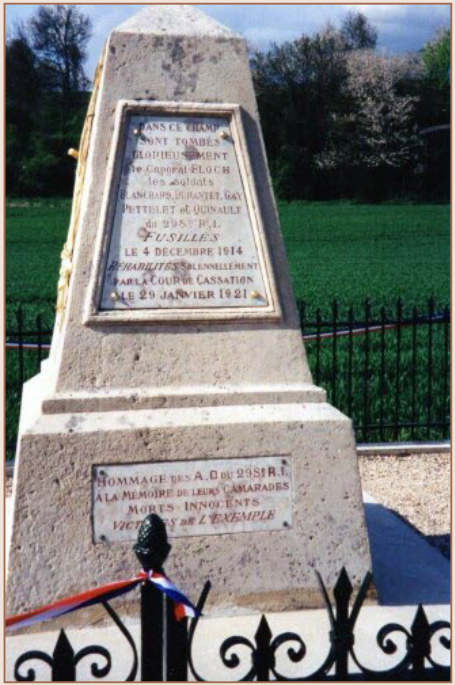
Vingré - Novembre 2017
Monument commémoratif aux 6 fusillés de Vingré, inauguré en 1925 et édifié
sur le lieu de l’exécution durant laquelle Claude Pettelet a été tué.
▶ LÉONARD LEYMARIE
Léonard Leymarie, légèrement blessé* à l’index gauche pendant son service de guetteur dans une tranchée* de l’Aisne, est accusé d’automutilation par un médecin militaire.

Date et lieu inconnus
Léonard Leymarie
▶ JEAN-JULIEN CHAPELANT
Jean-Julien Chapelant, sous-lieutenant commandant la 3e section* de mitrailleuses* du 98e régiment d’infanterie, est capturé avec quelques survivants. Malgré ses blessures, il parvient à revenir aux lignes françaises, mais il est condamné à mort pour motif de capitulation en rase campagne. Le 11 octobre 1914 il est exécuté au Bois-des-Loges , adossé à un pommier.81 (Cf : mitrailleurs)
« J’allais me coucher lorsqu’arrive l’ordre d’aller aux Loges pour la 1ère heure car on doit fusiller le lieutenant* Chapelant. Je pars immédiatement (…) Je passe à Conchy chercher le Saint-Sacrement. (…) Nous arrivons vers 1h et 1/2, l’ordre d’exécution arrive qq instants après. (..). On le dépose sur un brancard, à terre, sous un arbre. Je le vois, lui donne le Saint-Sacrement. Il demande à écrire à sa famille, à voir son défenseur. On lui refuse tout. Il fait son sacrifice pour Dieu et pour la France. On lui prononce la sentence, on lui bande les yeux, on l’attache à son brancard et on le porte au lieu d’exécution dans le champ voisin de la 1ére maison des Loges à gauche. On appuie le brancard contre un arbre desséché et on fait feu … on l’achève d’un coup de revolver à la tempe… Son dernier baiser avait été pour le crucifix !! Je pars, éclatant en sanglots. Je quitte étole et surplis et je pars après avoir béni le corps dans la fosse. » — Témoignage de l’abbé Lestrade, prêtre et aumônier militaire pendant la Première Guerre mondiale, sur l’affaire Chapelant
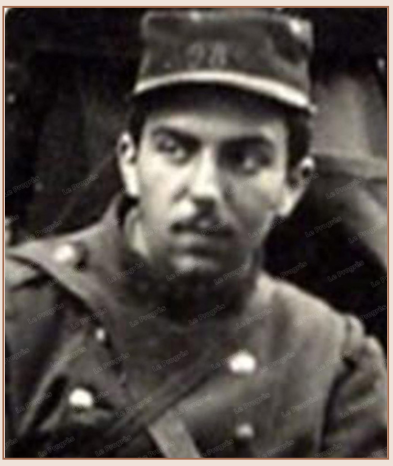
Date et lieu inconnus
Jean-Julien Chapelant
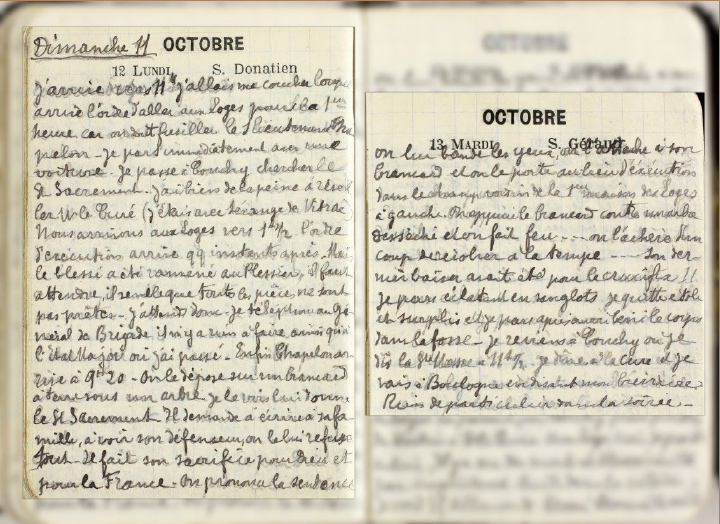
Bois-des-Loges - 11 octobre 1914
Notes de l’abbé Lestrade
▶ FRANÇOIS WATERLOO
Le 7 septembre 1914, le général* René Boutegourd ordonne, sans procès, l’exécution à titre “d’exemple» 10† de sept soldats du 327e Régiment d’Infanterie* accusés d’avoir quitté leurs positions lors d’une attaque à Essarts-lès-Sézanne, sur le front de la Marne.82
Il se justifie plus tard en insistant sur l’importance de la bataille de la Marne « de l’issue de laquelle dépendait le salut du pays. Ce n’était pas le moment de regarder en arrière, il fallait se faire tuer sur place plutôt que de reculer d’un pouce; les chefs devaient mettre toute leur énergie à maintenir les hommes dans le devoir. »11†
À 6h30 du matin, François Waterlot, Alfred Delsarte, Gaston Dufour, Gabriel Caffiaux, Palmyre Clément, Eugène Barbieux et Désiré Hubert sont placés devant une meule de paille pour être exécutés. Après le premier tir, trois des condamnés sont encore en vie. Un autre tir est ordonné, mais ils survivent à nouveau.83
« Le sous-officier* qui est là est venu nous achever en nous tirant dans la tête.
[…] Après avoir tiré sur les 2 premiers, il a dit au capitaine* en charge qu’il ne
pouvait pas continuer, que c’est trop douloureux pour lui. Le capitaine* lui a dit
de s’assurer que nous étions vraiment morts. […] Il a dit au capitaine* que nous
étions tous morts, et le capitaine* a emmené le peloton d’exécution. » — Lettre* de
François Waterlot, 11 août 1915, citée par le général* André Bach, « Fusillés pour l’exemple
1914-1915 », p. 247-248
Un des survivants, François Waterlot, se présente au commandant de bataillon* le lendemain et demande à retourner au front. Sa demande est acceptée, il retourne au combat et meurt au front en 1915.
Les sept soldats condamnés, quant à eux, sont réhabilités en 1926.84
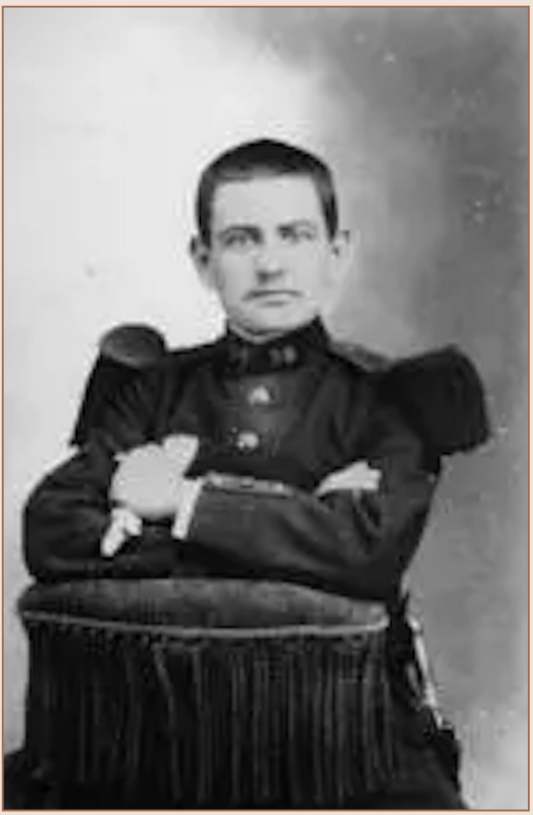
Date et lieu inconnus
François Waterloo
▶ EDWARD PILLET ET CAMILLE CHEMIN
Au printemps 1915, le 37e régiment d’infanterie coloniale (RIC) est engagé dans des combats à La Fontenelle sur le plateau du Ban-de Sapt. Plusieurs fois au cours des attaques, les sacs des soldats restés à l’arrière sont pillés, conduisant le capitaine Bastide à désigner Camille Chemin et Édouard Pillet pour les surveiller afin d’éviter de nouveaux vols. Cependant, au cours d’un assaut en juin 1915, les consignes ne sont pas correctement transmises entre l’ancien et le nouveau capitaine : les deux soldats restent auprès des sacs alors que le reste du régiment participe à l’attaque, conduisant le capitaine Quod à les considérer comme disparus au front. Lorsque le 37e RIC se déplace, Chemin et Pillet réintègrent le régiment, mais le colonel* les considère comme déserteurs en se basant sur le rapport du capitaine et signale leur absence. Plus d’un mois après le combat de la Fontenelle, le 28 juillet 1915, les deux soldats, qui venaient de se battre au Bois-Le-Prêtre◊, font l’objet d’une inculpation pour abandon de poste. Ils sont traduits en justice le 2 août devant un conseil de guerre. Dans leurs déclarations, ils expriment des regrets et font aveu de leur abandon de poste. Chemin évoque son état d’affolement face aux éclatements d’obus et son égarement, tandis que Pillet admet son manque de moral. Le 4 août, ils sont fusillés à Montauville, sans aucune audition de témoins et à l’unanimité des voix. Néanmoins, en janvier 1926, leur condamnation est réévaluée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. De nouveaux témoignages de soldats évoquent l’ordre du capitaine Bastide de garder les sacs, réfutant la théorie d’un abandon de poste. Mais l’instance refuse de revenir sur sa décision, arguant que cet élément n’a pas été mentionné lors du conseil de guerre et que Pillet et Chemin ont explicitement avoué leur crime. Toutefois, la demande de réexamen du dossier de Pillet par la mère d’Édouard donne lieu à une nouvelle séance le 17 février 1934. La cour spéciale de justice militaire revient sur sa décision et réhabilite les droits et la émoire des deux soldats, considérés pour la première fois comme « Morts pour la France » dix neuf ans après leur exécution.85
DÉFENSE PASSIVE
Pendant les années 1930, la situation internationale devient tendue et la France prend diverses mesures pour se préparer à se défendre en cas d’attaque. En parallèle des actions militaires, elle établit également des dispositions pour la défense passive: un ensemble de mesures non offensives visant à protéger la population civile et les infrastructures en cas d’attaque.
Le 8 avril 1935, une première loi crée une commission pour la défense passive. Celle-ci définit les rôles des représentants de l’État dans les départements et communes, alloue des fonds du budget de l’État pour des abris* et des systèmes de détection de gaz et organise des secours en cas de danger aéro-toxique.
De nombreux décrets d’application sont ensuite émis jusqu’en 1938 pour régir la fabrication et la vente d’équipements de protection, des règles s’appliquant aussi aux colonies* et territoires mandatés. En 1938, une nouvelle loi est adoptée pour organiser la nation en temps de guerre, couvrant divers domaines, dont la mobilisation des ressources nationales, les autorités publiques, la répartition des pouvoirs et la préparation de l’économie en temps de guerre.
Le contexte international stimule les préparatifs, entraînant la publication de plus de 35 textes concernant la défense passive contre les attaques aériennes dans le Journal Officiel en 1939.86
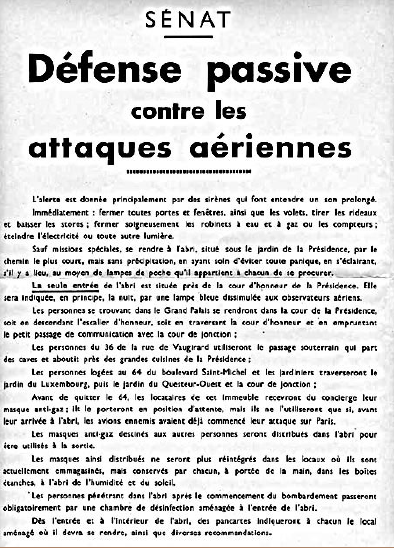
Exemple d’une affiche de la Défense passive
contre les attaques aériennes
Transcription
photo 94
SÉNAT
« DÉFENSE PASSIVE*
contre les
attaques aériennes »
« L’alerte est donnée principalement par des sirènes qui font entendre un son prolongé. »
« Immédiatement: fermer toutes portes et fenêtres, ainsi que les volets, tirer les rideaux et baisser les stores ; fermer soigneusement les robinets à eau et à gaz ou les compteurs ; éteindre l’électricité ou toute autre lumière.
Sauf missions spéciales, se rendre à l’abri, situé sous le jardin de la Présidence, par le chemin le plus court, mais sans précipitation, en ayant soin d’éviter toute panique, en s’éclairant, s’il y a lieu, au moyen de lampes de poche qu’il appartiendra à chacun de se procurer.
La seule entrée de l’abri est située près de la cour d’honneur de la Présidence. Elle sera indiquée, en principe, la nuit, par une lampe bleue dissimulée aux observateurs aériens.
Les personnes se trouvant dans le Grand Palais se rendront dans la cour de la Présidence, soit en descendant l’escalier d’honneur, soit en traversant la cour d’honneur et en empruntant le petit passage de communication avec la cour de jonction ;
Les personnes du 36 de la rue de Vaugirard utiliseront le passage souterrain qui part des caves et aboutit près des grandes cuisines de la Présidence ;
Les personnes logées au 64 du boulevard Saint-Michel et les jardiniers traverseront le jardin du Luxembourg, puis le jardin du Questeur-Ouest et la cour de jonction ;
Avant de quitter le 64, les locataires de cet immeuble recevront du concierge leur masque anti-gaz ; ils le porteront en position d’attente, mais ils ne l’utiliseront que si, avant leur arrivée à l’abri, les avions ennemis avaient déjà commencé leur attaque sur Paris.
Les masques anti-gaz destinés aux autres personnes seront distribués dans l’abri pour être utilisés à la sortie.
Les masques ainsi distribués ne seront plus réintégrés dans les locaux où ils sont actuellement emmagasinés, mais conservés par chacun, à portée de la main, dans les boîtes étanches, à l’abri de l’humidité et du soleil.
Les personnes pénétrant dans l’abri après le commencement du bombardement passeront obligatoirement par une chambre de désinfection immédiatement à l’entrée de l’abri.
Dès l’entrée et à l’intérieur de l’abri, des pancartes indiqueront le chemin à suivre et le local aménagé où il devra se rendre, ainsi que diverses recommandations. »
DIRIGEABLE
Les dirigeables, également appelés Zeppelins, émergent comme des aéronefs distincts avant la Première Guerre mondiale. Inspirés par les premiers vols en montgolfière des frères Montgolfier en 1783, les dirigeables sont des véhicules volants plus grands propulsés par des moteurs et dirigés par des hélices. Ils se distinguent par leurs enveloppes, qui peuvent être non rigides, semi-rigides ou rigides et qui s’étendent sur des longueurs impressionnantes de 180 à 210 mètres.
Leur capacité à planer au-dessus des lignes de front en font des outils idéaux pour la reconnaissance (Cf : Espion). Leur taille imposante leur permet de transporter des charges plus importantes, comme des mitrailleuses* et des bombes, en fournissant une plateforme mobile pour observer et documenter en profondeur le terrain. Les Zeppelins allemands, en particulier, sont utilisés de manière offensive, larguant des bombes sur des cibles au sol. Mais leur taille les rend vulnérables aux attaques aériennes et anti-aériennes.
Malgré leur efficacité dans la collecte de renseignements et leur capacité à rester en vol pendant de longues périodes, les dirigeables sont progressivement remplacés par des technologies aéronautiques plus avancées à la fin de la Première Guerre mondiale. La transition vers des avions plus rapides, manœuvrables et surtout discrets marque la fin de la popularité des dirigeables, signifiant la fin de leur ère dominante dans l’aérostation militaire.87

Pont-à-Mousson - 24 décembre 1914
Dirigeable* français en route vers Metz pour détruire les fortifications occupées par les Allemands.

Journal Le Miroir - 14 février 1915
Transcription
photo 95
« LES TENTATIVES DES ZEPPELINS ONT COUTÉ A L’ALLEMAGNE PLUS
QU’ELLES NE LUI ONT RAPPORTÉ »
« Cette carte établit nettement l’actif et le passif des grosses unités de la flotte aérienne allemande depuis sa création jusqu’au 1er février 1915 »
« Depuis la création de la flotte aérienne germanique, vingt zeppelins ont été
détruits: douze par accidents, du 5 août 1908 au 13 juin 1914, et huit par le fait
des armées alliées, du 6 août 1914 au 25 janvier 1915. Sur le front occidental,
jusqu’au 1er février 1915, ils ont procédé à six bombardements, au cours
desquels soixante-deux bombes furent lancées, tuant dix-neuf personnes et
en blessant onze. Le front oriental a subi trois bombardements qui tuèrent
cinquante et une personnes et en blessèrent cinquante-trois. Depuis la guerre,
les usines Zeppelin sortent en dirigeable* toutes les trois semaines environ.
A la date de la mobilisation* nos ennemis possédaient treize zeppelins. Ils
disposeraient aujourd’hui de vingt-deux types au moins. Huit furent détruits
depuis le début des hostilités. Il en reste donc une quinzaine, peut-être
un peu plus, car il se peut que la fabrication ait été accélérée. L’Allemagne
possède, en outre, des Parseval, des Grosse et des SchütteLanz† pour lesquels
elle a construit et construit encore, comme pour les zeppelins, des hangars
spéciaux, ou des hangars spéciaux, ou des hangars « passe-partout ». »
DISPONIBILITÉ
La disponibilité fait référence à l’état d’une personne qui est disponible et prête à être mobilisée pour des tâches militaires. Cela concerne principalement les militaires en service actif, mais peut également s’appliquer à la réserve militaire. La disponibilité militaire implique que les militaires soient prêts à répondre aux besoins opérationnels de leur unité ou de leur pays, que ce soit pour des missions de combat, de soutien logistique , ou d’autres tâches liées à la défense nationale.88
DIVISION DES CORPS DE L’ARMÉE EN 1914†
(Cf: Hiérarchie du corps armé français)
Le Grand Quartier Général
Le chef d’état-major commande les armées françaises et les troupes étrangères sous commandement français.
↓
Les armées
En août 1914, cinq armées sont créées. Elles se répartissent les vingt-et-un corps d’armée qui correspondent à des régions militaires de la France métropolitaine et de l’Algérien. Chacune est
commandée par un général* d’armée.
↓
Le corps d’armée
(40 000 hommes, 56 mitrailleuses*, 120 canons de 75)
Il comprend deux divisions d’active, un régiment* de réservistes, un régiment d’artillerie* (neuf batteries*), une artillerie* de corps (douze batteries*), un régiment* de cavalerie (six escadrons). Il
est commandé par un général* de corps d’armée.
↓
La division d’infanterie*
(15 000 hommes, 36 canons de 75)
Elle comprend deux brigades*. Elle est commandée par un général* de division*.
↓
La brigade* d’infanterie
Elle comprend deux régiments*. Elle est commandée par un général* de brigade*.
↓
Le régiment d’infanterie*
(120 officiers*, 3 250 hommes)
Il comprend trois bataillons*. Il est commandé par un colonel* ou un lieutenant*-colonel*.
↓
Le bataillon*
(1 000 hommes)
Il comprend une section* de mitrailleuses et quatre compagnies*. Il est commandé par un chef de bataillon*.
↓
La compagnie*
(250 hommes)
Elle est divisée en deux pelotons. Elle est commandée par un capitaine*.
↓
La section*
(60 hommes)
Elle se compose de deux demi-sections*. Elle est commandée par un sergent.
↓
L’escouade*
(15 hommes)
Elle est commandée par un caporal*.
DIVISION D’INFANTERIE
Pendant la Première Guerre mondiale, l’infanterie a dû faire face à d’énormes pertes, entraînant un affaiblissement du moral des soldats et compliquant la formation de spécialistes. Cette situation a exigé une profonde transformation de l’infanterie, nécessitant une réorganisation substantielle de ses effectifs.
La refonte de l’infanterie française durant cette période peut être décrite en trois phases principales.
Au début du conflit, les soldats s’adaptent en utilisant des équipements improvisés, en adoptant de nouveaux uniformes, des casques* d’acier et en apprenant des techniques novatrices telles que l’utilisation de pelles et de grenades à main. Ils s’initient également à la construction de tranchées* et de réseaux de communication souterrains (Cf : Boyau/ Sape).
Entre 1916 et 1917, l’armée introduisit des armes plus sophistiquées, y compris des fusils lance-grenades, des canons et des mitrailleuses*, augmentant significativement la puissance de feu de l’infanterie. Toutefois, la question de la mobilité restait problématique.
La troisième phase se caractérise par l’introduction de la motorisation, notamment avec les premiers chars d’assaut comme le Schneider et le Saint-Chamond , conçus pour franchir les obstacles les plus robustes. Malgré des débuts difficiles, ces engins deviennent des éléments essentiels sur le champ e bataille, offrant un soutien crucial à l’infanterie. (Cf : Batterie)
Au fil de leur évolution, les divisions, fortes d’un effectif d’environ 15 550 hommes, intègrent des éléments de diverses branches de l’armée (infanterie, artillerie*, aviation*, forces spéciales…) qui leur permettent d’agir de manière autonome sur un front de 2 à 5 kilomètres lors d’offensives et de couvrir un secteur deux fois plus large lors de missions défensives.89
(Cf : Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
ECAILLE
(Cf : Carapace)
EFFORT DE GUERRE
Au début de la Première Guerre mondiale, la transition vers une guerre de positions entraîne un allongement significatif de la durée des combats, avec des tirs d’artillerie pouvant se prolonger pendant plusieurs heures, voire jours. Cette nouvelle stratégie implique l’utilisation de batteries d’artillerie* moins mobiles et de plus en plus lourdes.
La consommation des cartouches d’artillerie* augmente de manière exponentielle. Cette demande accrue en munitions met une forte pression sur l’infrastructure logistique, nécessitant un approvisionnement massif pour soutenir les offensives militaires. Dans cet élan vers la victoire, de nombreuses entreprises françaises mobilisent leurs ressources dans un effort concerté.
(Cf : Casque Adrian)
L’industrie automobile, en particulier, assume un rôle crucial au sein de cet effort national. Face à l’urgence, tous les constructeurs automobiles se reconvertissent, partiellement, dans la production d’armement.
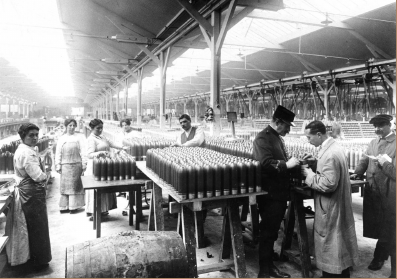
Usine Citroën - 28 septembre 1915
Grand atelier d’usinage et de montage
Dans le Puy-de-Dôme, l’usine Michelin aménage un atelier de chargement de munitions à Gravanches. Au milieu de l’année 1915, il produit deux à trois trains par jour de 5 à 10 000 munitions, contre 60 000 obus* journalier en 1916. La fabrique s’attèle également à la réparation de fusils pour atteindre une moyenne de 600 engins réparés par jour de mars 1917 jusqu’à la fin de la guerre.91
La demande croissante d’artillerie*, entraîne un agrandissement des entrepôts et une amélioration de la logistique existante. Des hangars et des voies ferrées sont construits pour permettre une connectivité avec les lieux de conflits, tandis que certains locaux de stockage se spécialisent. Héricy stocke, par exemple, des munitions de 75 et 105 mm, Cosne de l’artillerie* de tranchée* et Vincennes des obus*. Chacun de ces entrepôts est relié à une armée par au moins une ligne ferroviaire, avec au minimum quatre trains par jour.92
Mais les grands industriels ne sont pas les seuls à se mobiliser durant le conflit : l’effort de guerre concerne tous les citoyens français. Le départ des hommes pour le front soulève la question du remplacement dans des secteurs essentiels. Les femmes, déjà actives avant la guerre (Cf : Poste), deviennent des figures centrales, représentant jusqu’à 30% de la main-d’œuvre dans l’industrie lourde. La nécessité de remplacer les soldats conduit également à l’emploi d’une main-d’œuvre étrangère, notamment chinoise. Les usines adoptent le taylorisme† pour répondre à la demande croissante du front, entraînant des conditions de travail dégradées avec des semaines de 60 à 70 heures et des risques liés à la manipulation d’explosifs.
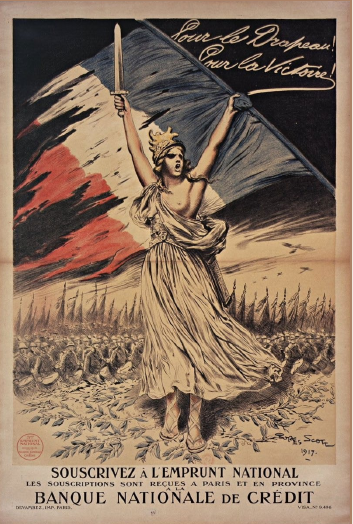
1917
Affiche pour le troisième emprunt national français de la
Banque Nationale de Crédit
ESCOUADE
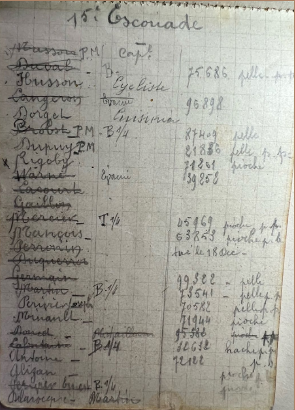
Notes de Jules Henri Colliot
Liste des soldats dans l’une des escouades* sous ses ordres
ESPION
Pendant l’hiver 1916, à Chantilly, au quartier du général Joffre**, le commandant Ladoux, responsable du contre-espionnage français, tire la sonnette d’alarme sur des concentrations ennemies près de Verdun◊. Malgré ses avertissements persistants, Joffre ne prend pas les mesures nécessaires pour renforcer les défenses du territoire menacé. Or l’offensive allemande massive, lancée le 21 février 1916, prend les Français au dépourvu, déclenchant l’une des batailles les plus meurtrières de la guerre avec 306 000 victimes du côté français.
Pendant la Première Guerre mondiale, les espions revêtent des profils diversifiés, des civils ordinaires aux militaires en mission secrète, ils sont des hommes et des femmes issus de différentes professions, tels que des braconniers, des commerçants, des artistes, des prostituées et même des déserteurs (Cf : Devoir). Les femmes participent largement à ces activités, en dépit d’une misogynie coriace au sein des services d’espionnage. Néanmoins, elles sont fréquemment impliquées dans des « missions horizontales », qui supposent l’entretien de relations intimes avec les enquêtés pour obtenir des informations.
Pour tous, le métier d’espion pendant cette période est périlleux. Les tribunaux militaires sont impitoyables et condamnent les accusés à l’exécution, aux travaux forcés ou à la prison*. Les services de renseignement, bien que sophistiqués, sont entravés par des rivalités internes et une désorganisation entre les différentes branches. Ladoux, malgré ses rapports alarmants, se heurte à l’incrédulité de Joffre, illustrant les préjugés de l’époque envers l’espionnage.
La France, malgré l’utilisation de moyens modernes tels que la communication sans fil, la cryptographie et l’espionnage aérien (Cf : Aviation), souffre de l’image négative associée aux espions, vus comme liés à la trahison nationale, la propagande de guerre ou encore les risques pour la sécurité du pays. La bataille de Verdun◊ révèle la tragique méconnaissance du renseignement, mais également son rôle crucial dans la guerre moderne. Condamnés par l’opinion populaire, les espions se révèlent toutefois essentiels pour obtenir des informations sur les positions ennemies, les approvisionnements et les mouvements de troupes.95
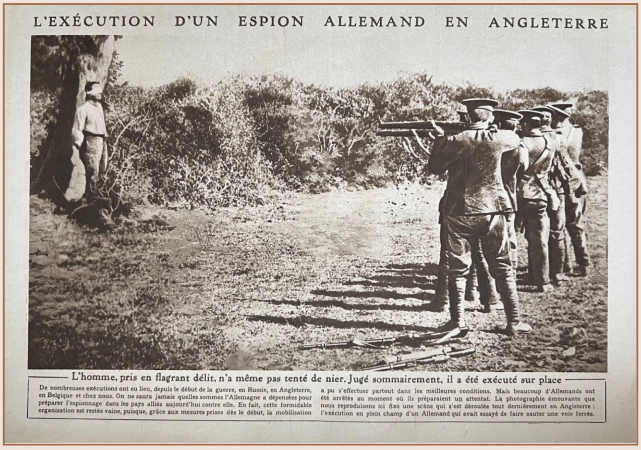
Le Miroir - 29 novembre 1914
Transcription
photo 99
« L’EXÉCUTION D’UN ESPION ALLEMAND EN ANGLETERRE »
« L’homme, pris en flagrant délit, n’a même pas tenté de nier. Jugé
sommairement, il a été exécuté sur place »
« De nombreuses exécutions ont eu lieu, depuis le début de la guerre, en
Russie, en Angleterre, en Belgique et chez nous. On ne saura jamais quelles
sommes l’Allemagne a dépensées pour préparer l’espionnage dans les pays
alliés aujourd’hui contre elle. En fait, cette formidable organisation est restée
vaine, puisque, grâce aux mesures prises dès le début, la mobilisation* a pu
s’effectuer partout dans les meilleures conditions. Mais beaucoup d’Allemands
ont été arrêtés au moment où ils préparaient un attentat. La photographie
émouvante que nous reproduisons ici fixe une scène qui s’est déroulée tout
dernièrement en Angleterre : l’exécution en plein champ d’un Allemand qui
avait essayé de faire sauter une voie ferrée. »
FACTION
Une faction correspond à chacune des trois tranches de huit heures au sein desquelles les trois équipes se relaient pour assurer un travail continu. Elle est synonyme de « quart* » ou « faire le quart ».96
FANTASSIN
Le terme fantassin désigne un soldat d’infanterie (Cf: Régiment d’Infanterie), c’est-à-dire un soldat combattant à pied, qui participe aux opérations militaires sur le champ de bataille.
Les fantassins sont les soldats les plus nombreux et constituent l’épinedorsale des armées engagées dans le conflit. Ils sont équipés d’armes légères, telles que des fusils, des baïonnettes* et des grenades*, et sont chargés de mener des attaques, de défendre des positions et d’occuper les tranchées*.97

Vanves - 28 décembre 1916 Tenue règlementaire du fantassin* français
FEUILLÉES/FEUILLE

Bielawina ( Pologne) - Fin 1917
La Fliegerabteilung 24 en poste à Bielawina à la fin de 1917. Les soldats de l'unité avaient
surnommé leur latrine rudimentaire « Der Abteilungs-Donnerbalken », littéralement la
« poutre du tonnerre », un terme humoristique qui faisait référence au bruit que
l'on entendait lorsqu'elle était utilisée.
FIÈVRE TYPHOÏDE
La fièvre typhoïde est une infection bactérienne grave causée par la bactérie Salmonella typhi. Elle se caractérise par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs abdominales et une forte fatigue.
La fièvre typhoïde se propage en raison de conditions d’hygiène précaires, transmises notamment par des mains sales et une eau contaminée. Elle se développe particulièrement chez des individus affaiblis par la fatigue et les carences alimentaires, situation de la plupart des soldats français.
A partir de l’été 1915, des campagnes de vaccination sont lancées. Malgré des effets secondaires indésirables (fièvres prolongées, vomissements, herpès, purpura, diarrhées…) la vaccination des troupes se révèle particulièrement efficace.99
Les résultats sont considérables : de 118 décès pour 100 000 hommes à la fin de l’année 1914, la mortalité par typhoïde est presque nulle en 1917. Le nombre de cas de typhoïde aurait dépassé le million en 1917 et celui des décès de plus de 150 000 en l’absence d’un vaccin.100
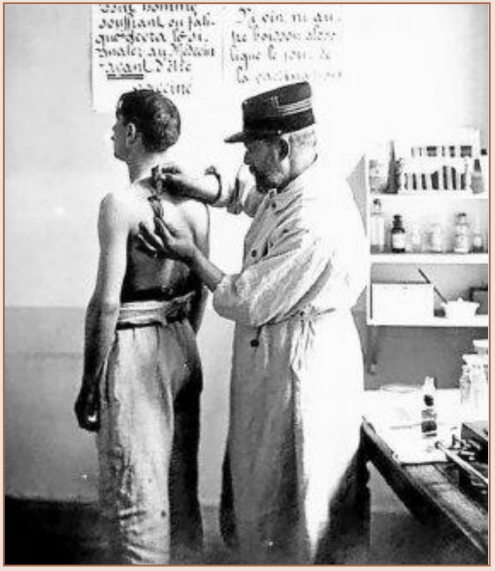
lieu inconnu - 1915
Campagne de vaccination contre la typhoïde
FLEURS À NOS FUSILS
L’expression « La Fleur à nos Fusils » fait référence aux militaires de la Première Guerre Mondiale qui ornent leurs canons de fleurs en partant au combat. Cet acte de départ célèbre, à l’allure de grande fête, cache une réalité bien plus nuancée.
Au moment de la mobilisation, le silence et la consternation prévalent, avec des pleurs, des prières et une gravité palpable. La période d’août complique les départs, car la moisson doit être terminée. Les réservistes se préparent donc à rejoindre leurs régiments* dans une atmosphère bien différente de celle imaginée.
C’est lors de leur départ effectif, après quelques jours de préparation, que l’ambiance change. Les attitudes des mobilisés français varient considérablement. Certains manifestent de l’enthousiasme, tandis que d’autres sont empreints de mélancolie. Néanmoins, la majorité des mobilisés adopte une attitude résolue, se sentant investis du devoir* de servir leur pays, même s’ils éprouvent de la douleur à l’idée de quitter leur famille et leur emploi.
La principale motivation sous-jacente à leur engagement est la défense de la France et non la reconquête de l’Alsace Lorraine, contrairement aux idées reçues.
En fin de compte, l’image de la fleur au fusil en tant que symbole du départ à la guerre est largement exagérée et légendaire, plutôt qu’une réalité vécue par tous les mobilisés.101
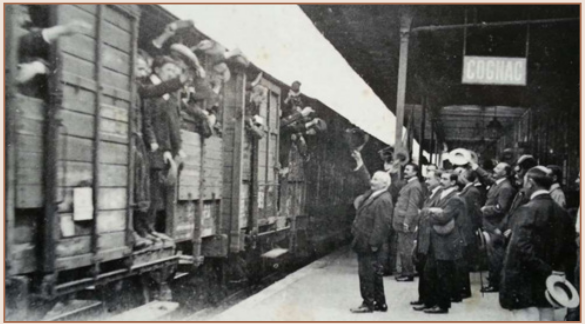
Mobilisation générale du 2 août 1914
Le départ des premiers mobilisés, aux accents de la « Marseillaise »,
du « Chant du Départ » et aux cris de « Vive la France »
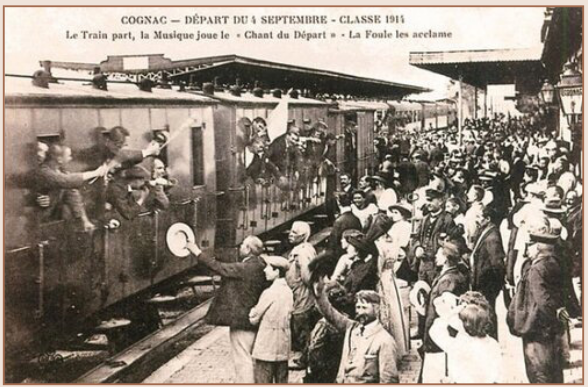
Transcription
Cognac - Départ du 4 Septembre - Classe 1914
Le Train part, la Musique joue le « Chant du Départ » - La Foule les acclame

Tours - 5 août 1914
Colonne de soldats - La fleur* aux fusils
FOOTBALL
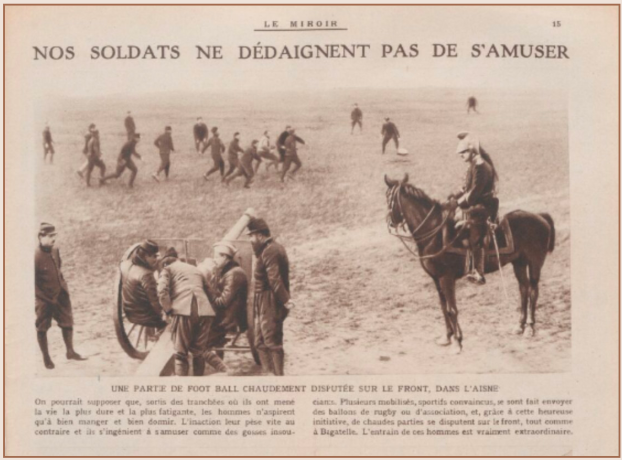
Journal Le Miroir - 21 février 1915
Transcription
« NOS SOLDATS NE DÉDAIGNENT PAS DE S’AMUSER »
« Une partie de foot ball chaudement disputée sur le front, dans l’Aisne »
« On pourrait supposer que, sortis des tranchées* où ils ont mené la vie la
plus dure et la plus fatigante, les hommes n’aspirent qu’à bien manger et bien
dormir. L’inaction leur pèse vite au contraire et ils s’ingénient à s’amuser
comme des gosses insouciants. Plusieurs mobilisés, sportifs convaincus,
se sont fait envoyer des ballons de rugby ou d’association, et, grâce à cette
heureuse initiative, de chaudes parties se disputent sur le front, tout comme à
Bagatelle. L’entrain des ces hommes est vraiment extraordinaire. »
FOUGASSE
La fougasse est l’ancêtre de la mine* anti-personnelle.
Souvent installée dans un trou conique d’une profondeur de 1 à 1,5 mètre creusé en oblique à environ 45 degrés, la fougasse est un dispositif explosif astucieusement camouflé. Un dispositif d’allumage électrique et une petite charge explosive sont placés au fond du trou, tandis que la charge principale est positionnée au-dessus. Pour accroître l’efficacité de l’explosion, la fougasse est entourée de pierres et de débris, puis l’ensemble est recouvert de terre afin de dissimuler l’installation.
Les fougasses sont généralement mises en place en face d’obstacles, de barricades, de chemins détournés ou parfois en formation devant les lignes de tir.
Différents modèles de fougasses sont pensés afin de répondre aux exigences stratégiques du conflit :
Fougasse Explosive: La fougasse explosive est une version rudimentaire d’une mine terrestre. Elle est composée d’un récipient rempli d’explosifs et d’un détonateur. Elle est enterrée dans le sol et peut être déclenchée à distance lorsque l’ennemi s’approche.
Fougasse à Clous: Cette variante de la fougasse explosive est remplie de clous, de boulons ou d’autres objets métalliques pointus.
Fougasse Incendiaire: La fougasse incendiaire est conçue pour déclencher un incendie lorsqu’elle explose. Elle contient des matériaux inflammables tels que l’essence ou le naphte, qui s’enflamment au moment de l’explosion.
Fougasse Fumigène : Cette fougasse produit un énorme nuage de fumée lorsqu’elle explose. Elle est utilisée pour créer une couverture fumigène qui obscurcit la vision de l’ennemi.103
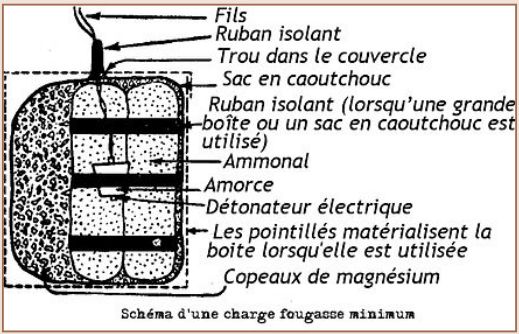
Schéma du fonctionnement d’une fougasse*

Bois-le-Prêtre◊ - 2023
Vestige de guerre - Fougasse*
FUSANT
Le fusant est un type d’obus* ayant la capacité d’exploser avec un retard. Pour cela, il est muni à son sommet d’une fusée* réglée pour déclencher l’explosion de l’obus* au bout d’un certain temps calculé à l’avance. Le fusant est composé d’explosifs et de billes de plomb ou d’acier appelées shrapnels*.104
FUSÉE
Une fusée d’artillerie* est un dispositif conçu pour déclencher la détonation de la charge interne des projectiles à un moment spécifique pendant le vol
ou à l’impact.
Ce rôle crucial fait de cette petite pièce un élément fondamental pour tester l’efficacité de tous les géants, canons et projectiles utilisés pendant la guerre
(Cf: Artillerie (Armes)).
Plusieurs types de fusées sont utilisés entre 1914 et 1918. Elles peuvent être catégorisés en fonction du moment où elles déclenchent l’explosion de la charge explosive dans l’obus*:
• Les fusées à impact sont déclenchées par l’impact de l’obus* sur sa cible, provoquant l‘explosion de la charge principale de l’obus*.
• Les fusées à impact différé sont des fusées à impact avec un retard d’une fraction de seconde, provoquant l’explosion de l’obus* après une pénétration dans le sol ou à travers la cible.
• Les fusées instantanées sont des fusées à impact déclenchées aussi rapidement que possible après l’impact, avant toute pénétration de l’obus* sous terre ou dans la cible.
• Les fusées à retardement sont déclenchées à un point spécifique de la trajectoire du projectile, en utilisant un système de synchronisation pyrotechnique ou un mécanisme horloger.
• Les fusées à double effet associent deux fonctionnalités distinctes. Elles combinent les effets des fusées à retardement et des fusées à impact et offrent la possibilité de choisir entre ces deux combinaisons. Les fusées à impact qui offrent la possibilité d’un retard sélectionnable, sont également considérées comme des fusées à double effet.
• Les fusées à effets multiples sont conçues en combinant plusieurs comportements différents. Elles peuvent, par exemple, combiner une fusée avec un court retard avec une autre à long retard et avec un système de retardement.
La fusée doit également posséder des caractéristiques de sécurité pour l’équipage du canon : il est essentiel d’éviter des explosions prématurées, responsables de dommages matériels et humains. Elles sont pensées pour résister à la fois à une manipulation brutale lors du transport, à des conditions de stockage imparfaites et au choc intense de la mise à feu depuis le tube. Cette spécification ajoute une difficulté supplémentaire à leur conception.

Bois-le-Prêtre◊ - 2023
Vestige de guerre - Fusée* allemande LKZ 16
(Fusée* détonateur percutante de 55mm pour canon de campagne)
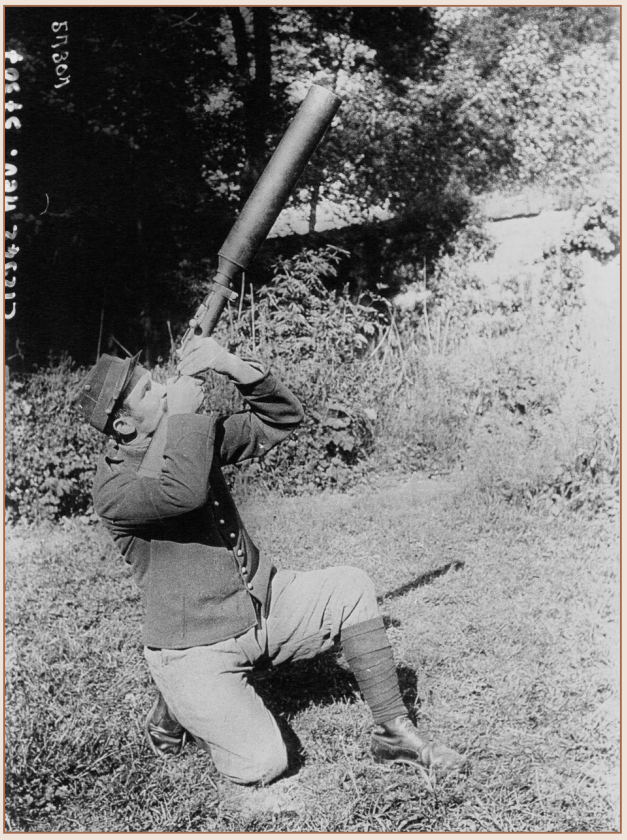
Meurisse - Novembre 1915
Un fusil lance une fusée* éclairante
GABARIT
Le terme gabarit est utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour désigner un modèle en bois ou en métal de la forme et de la taille d’une tranchée*. Le gabarit sert de guide pour les soldats lors de la construction de nouvelles tranchées* ou pour l’élargissement et l’amélioration des tranchées* existantes.106
GÉNÉRAL

Bois-le-Prêtre◊ - Env. juin 1915
Le président Poincaré** et le Général Riberpray**
, dirigeant de la brigade* active de Toul◊
GOURBI
Dans l’argot des combattants, le gourbi désigne un abri*. Le terme s’applique peu en première ligne : il est utilisé surtout à partir de la seconde ligne jusqu’au cantonnement*.108
GOUVERNEUR
Un gouverneur militaire est un officier* militaire ou un responsable désigné pour exercer le contrôle et l’autorité sur une région, une zone géographique ou une zone d’opérations spécifiques. Le poste* de gouverneur de Paris est notamment pourvu au général* Joseph Gallieni* durant la Première Guerre mondiale.109
GRADE
Le grade militaire est une classification hiérarchique attribuée aux membres des forces armées. Il permet de définir leur rang, leur autorité et leurs responsabilités au sein de l’armée.110 (Cf : Hiérarchie du corps armé français)
GRAND-GARDE
Le terme de Grand-garde est utilisé comme synonyme d’avant-poste*. Un avant-poste* désigne généralement un point de positionnement militaire avancé situé en première ligne, entre les tranchées* des forces opposées. Il s’agit d’une petite installation militaire fortifiée qui est utilisée pour surveiller et contrôler les mouvem nts de l’ennemi, recueillir des renseignements et servir de point de départ pour des attaques ou des patrouilles*.111 (Cf: Petit Poste / Section de Piquet)
GRENADES
La grenade est une arme de combat rapprochée composée d’une enveloppe en fonte remplie d’explosifs.
Lorsqu’elle est lancée à la main, son explosion projette des éclats de petite taille. Bien qu’ils ne soient pas toujours mortels, ils entraînent souvent une mise hors combat temporaire de ceux qui sont touchés.
Son utilisation ne fait qu’augmenter au cours de la guerre en raison de la spécialisation des sections* de grenadiers. Ils partent à l’assaut avec des sacs remplis de ces engins appelés «citrons» en raison de leur forme ovale et de leur apparence extérieure.112
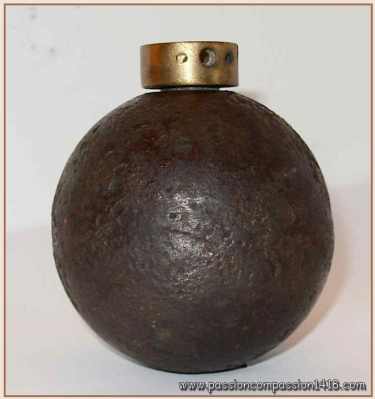
Grenade - Modèle 1914

Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Fusil lance-grenades* Guidetti (Légende d’origine)
GUEULES CASSÉES
Les soldats blessés* et gravement défigurés par les horreurs de la Première Guerre Mondiale sont surnommés les « gueules cassées ». En France, leur nombre s’élève à environ 15 000.113
Les mutilations faciales massives donnent lieu à de nombreuses recherches chirurgicales : des centres spécialisés en chirurgie maxillo faciale voient le jour à l’arrière du front pour tenter de reconstruire les visages de ces hommes et qu’ils retrouvent une vie normale.
La longévité et la complexité de ces opérations entraînent également des progrès notables de l’anesthésie. Des traitements prothétiques sont employés, avec des prothèses amovibles complètes ou partielles, des prothèses fixes et des couronnes et bridges métalliques pour restaurer les arcades dentaires.114
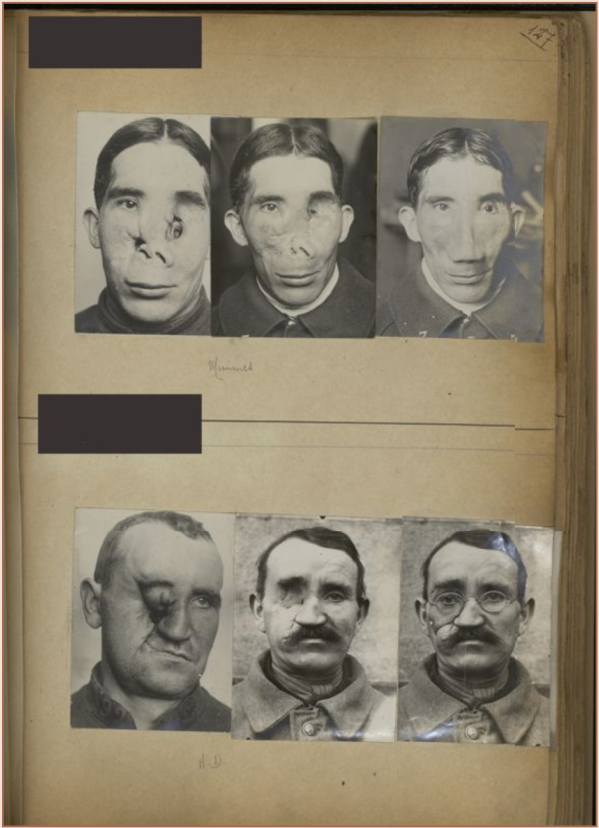
Paris - Date(s) inconnue(s)
Portraits de soldats ayant eu recours à une chirurgie maxillo-faciale
HIÉRARCHIE DU CORPS ARMÉ FRANÇAIS
(Cf: Division des corps d’armée en 1914)
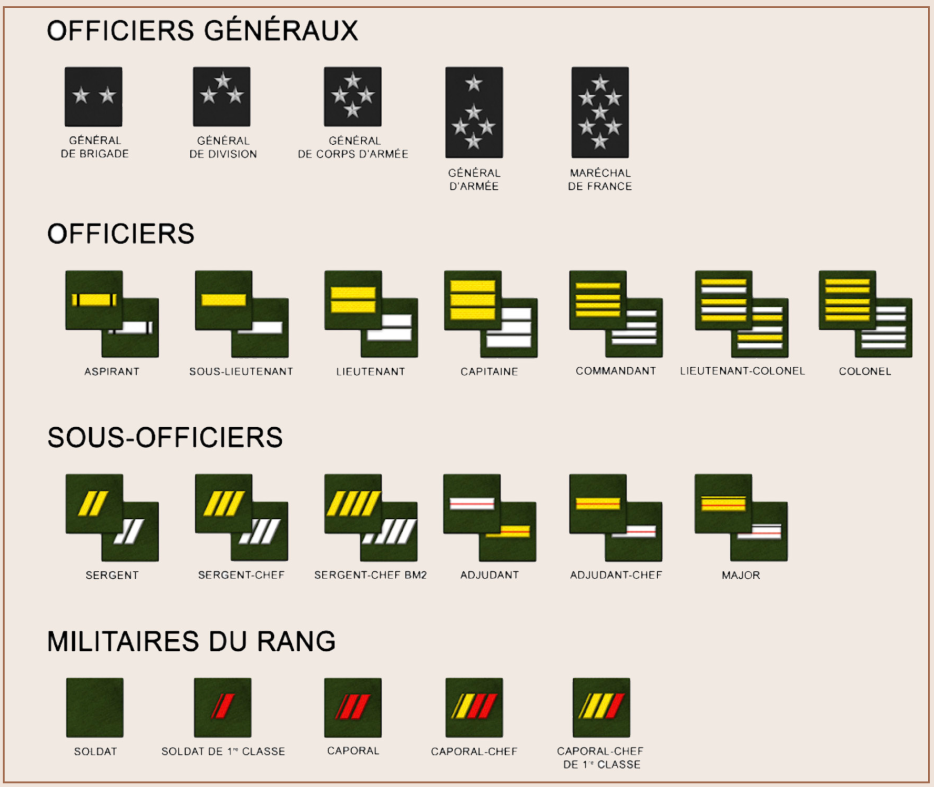
Les grades* dans l’armée de Terre
HR (HORS RANG)
(Cf: Cie ou Compagnie / Compagnie Hors Rang (CHR) our (HR))
INFANTERIE
Cf : Division d’Infanterie/ Régiment d’Infanterie
JEU
Au sein du tumulte, les soldats, confrontés aux horreurs du front, développent des stratégies créatives pour échapper à la brutalité quotidienne. Se distraire est une nécessité vitale et le temps libre prend une importance cruciale pour contrer la tristesse et la routine et ne pas succomber à la folie.
Des activités informelles, comme le football* les jeux de cartes, de dés ou encore l’artisanat*, sont popularisés comme moyen pour se détendre et se divertir. Certains transforment leurs abris* en les décorant, observent la nature, créent des herbiers, chassent et pêchent autant que possible et adoptent même des animaux domestiques.
L’importance de maintenir le lien avec l’arrière conduit également à une prolifération de correspondances. L’écriture de lettres*, la lecture et la tenue de journaux* de tranchées*, sont le seul moyen de rester connectés avec leurs proches et de partager leurs expériences au front.
Parallèlement, des loisirs officiels sont organisés par l’autorité militaire afin d’apporter plus de douceur au quotidien des soldats. Les revues, le théâtre et le cinéma, bien que teintés de propagande* offrent des moments de divertissement bienvenus. Des initiatives locales sont également entreprises pour maintenir le moral des populations. Des kermesses, marchés et spectacles voient le jour, parfois à seulement quelques kilomètres du champ de bataille.
A Commercy, un parc d’attractions spécialement dédié aux soldats voit le jour en 1914. Le « Poilu’s Park », inauguré dans le vélodrome de la commune, INFANTERIEest un véritable parc d’attractions : il propose des spectacles, des courses de cyclisme mais aussi des matchs de boxe, accueillis avec enthousiasme par le public.115
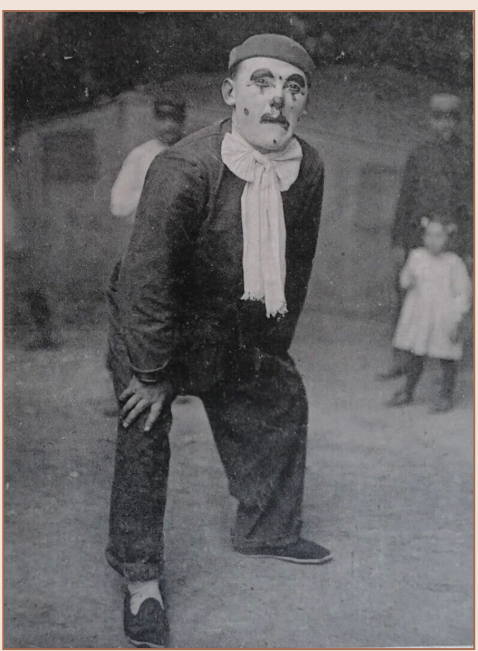
Vélodrome de Commercy - 1914-1915
Au Poilu’s Park : Le célèbre clown Gugusse † (Légende d’origine)
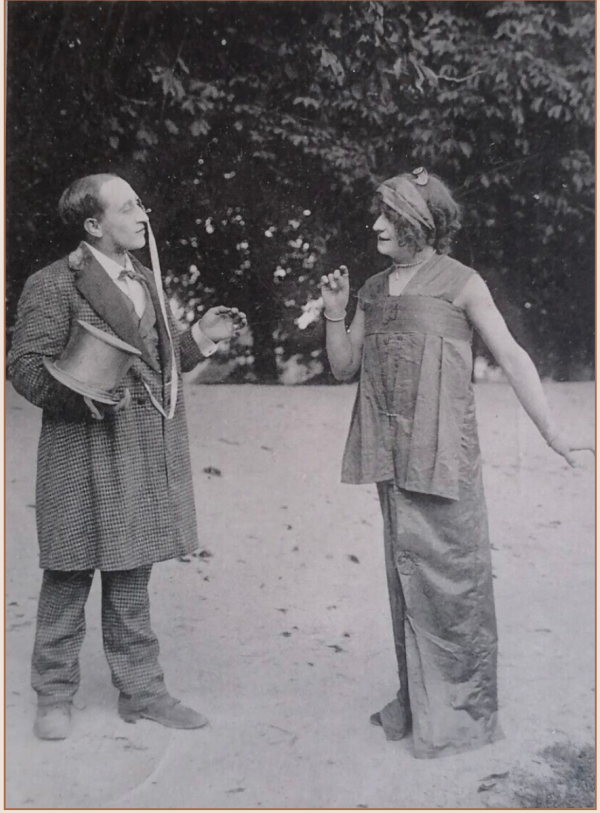
Vélodrome de Commercy - 1914-1915
Au Poilu’s* Park : Les poilus* Bert-Gyll et Mézy , duettistes à transformation.
(Légende d’origine)
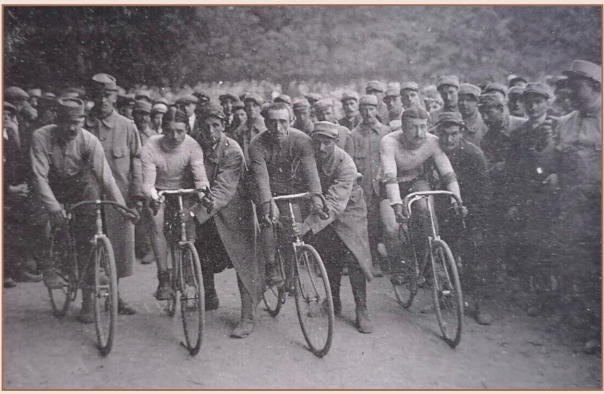
Vélodrome de Commercy - 1914-1915
Au Poilu’s* Park : Départ de course cycliste (Légende d’origine)
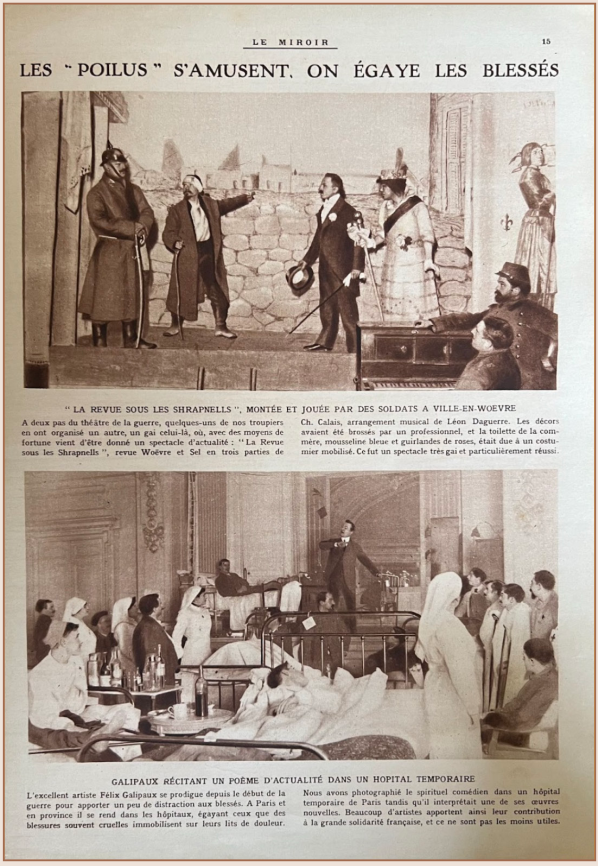
Journal Le Miroir - 14 mars 1915
Transcription
(de gauche à droite, de haut en bas)
photo 120
« LES « POILUS » S’AMUSENT, ON ÉGAYE LES BLESSÉS* »
« « La revue sous les shrapnells »,
montée et jouée par des soldats a ville-en-woevre »
« A deux pas du théâtre de la guerre, quelques uns de nos troupiers en ont
organisé un autre, un gai celui-là, où, avec des moyens de fortune vient
d’être donné un spectacle d’actualité : « La Revue sous les Shrapnells », revue
Woëvre et Sel en trois partie de Ch. Calais, arrangement musical de Léon
Daguerre. Les décors avaient été brossés par un professionnel, et la toilette de
la commère, mousseline bleue et guirlandes de roses, était due à un costumier
mobilisé. Ce fut un spectacle très gai et particulièrement réussi. »
« Galipaux récitant un poème d’actualité dans un hôpital temporaire »
« L’excellent artiste Félix Galipaux se prodigue depuis le début de la guerre
pour apporter un peu de distraction aux blessés*. A Paris et en province il
se rend dans les hôpitaux, égayant ceux que des blessures souvent cruelles
immobilisent sur leurs lits de douleur. Nous avons photographié le spirituel
comédien dans un hôpital temporaire de Paris tandis qu’il interprétait une des
ses œuvres nouvelles. Beaucoup d’artistes apportent ainsi leur contribution à la
grande solidarité française, et ce ne sont pas les moins utiles. »
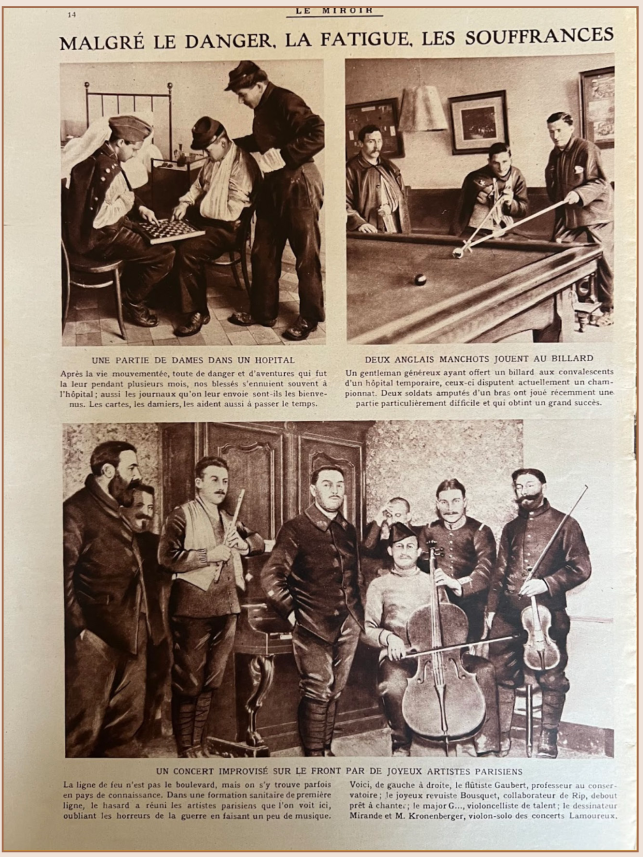
Journal Le Miroir - 21 février 1915
Transcription
(de gauche à droite, de haut en bas)
photo 121
« MALGRÉ LE DANGER, LA FATIGUE, LES SOUFFRANCES »
« Une partie de dames dans un hôpital »
« Après la vie mouvementée, toute de danger et d’aventure qui fut la leur
pendant plusieurs mois, nos blessés* s’ennuient souvent à l’hôpital : aussi les
journaux* qu’on leur envoie sont-ils les bienvenus. Les cartes, les damiers, les
aident aussi à passer le temps. »
« Deux Anglais manchots jouent au billard »
« Un gentleman généreux ayant offert un billard aux convalescents d’un
hôpital temporaire, ceux-ci disputent actuellement un championnat. Deux
soldats amputés d’un bras ont joué récemment une partie particulièrement
difficile et qui obtient un grand succès. »
« Un concert improvisé sur le front par des joyeux artistes parisiens. »
« La ligne de feu n’est pas le boulevard, mais on s’y trouve parfois en pays
de connaissance. Dans une formation sanitaire de première ligne, le
hasard a réuni les artistes parisiens que l’on voit ici, oubliant les horreurs
de la guerre en faisant un peu de musique. Voici, de gauche à droite, le
flûtiste Gaubert, professeur au conservatoire ; le joyeux revuiste Bousquet,
collaborateur de Rip, debout prêt à chanter ; le major G…, violoncelliste de
talent ; le dessinateur Mirande et M. Kronenberger, violon-solo des concerts
Lamoureux. »
JOURNAUX
Les journaux de tranchées* font leur apparition à la fin de l’année 1914, lorsque la guerre de position succède à la guerre de mouvement. Ces journaux sont rédigés par les soldats eux-mêmes, les poilus*, pendant les moments de répit sur le front stabilisé. Plus de la moitié d’entre eux sont écrits directement en première ligne, entre les attaques.
Leur nombre croît rapidement à partir de 1915. On évalue à environ cinq cents le nombre de titres sortis durant le conflit au sein de l’armée française. Rigolboche, L’Écho des Tranchées*, La Roulante, Le Poilu* déchaîné, le Canard du boyau, Le Mouchoir, L’Écho des gourbis*, Marmita, La Guerre joviale… les titres sont nombreux et nourrissent la presse* de l’époque. Certains journaux ont une durée de vie très courte et ne comptent que quelques numéros tandis que d’autres paraissent tout au long de la guerre.

Bois-le-Prêtre◊ - Novembre 1915
Les premiers numéros du journal, « Le Mouchoir », réalisés dans
le sous-sol de la maison forestière du Père Hilarion°, dans le Bois-le-Prêtre◊.
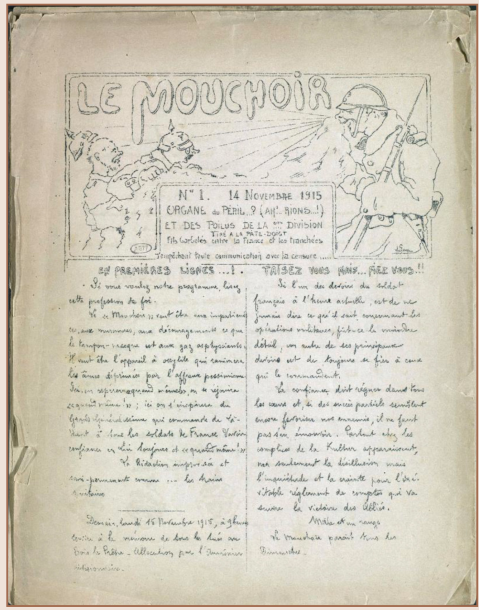
Bois-le-Prêtre◊ - Novembre 1915
1ére édition du Mouchoir
« Le Mouchoir », un journal des tranchées* fondé en 1915 par Joseph Lesage, l’abbé Ledain, et A. Bray, au ton humoristique. Joseph Lesage, artiste spécialisé en aquarelles et téléphoniste dans la 73ème Division* pendant la guerre, à contribué significativement à son élaboration.
Transcription
photo 123
« LE MOUCHOIR »
« N° 1. 14 NOVEMBRE 1915
ORGANE du PÉRIL… ? (AH !… RIONS… !)
ET DES POILUS DE LA …ème DIVISION
TIRÉ A LA P TE-DOIGT
fils barbelés entre la France et les tranchées empêchant tout communication
avec la censure… »
(à gauche) « EN PREMIÈRES LIGNES… ! »
« Si vous voulez notre programme, lisez cette profession de foi. Le « Mouchoir »
veut être aux impatiences, aux murmures, aux découragements ce que le
tampon-masque† est aux gaz asphyxiants. Il veut être l’appareil à oxylite qui
ranimera les âmes déprimées par l’affreux pessimisme. Ici, on espérera
« quand même ! », on se réjouira « quand même » ; ici on s’inspirera du Grand
Généralissime qui commande de là-haut à tous les soldats de France d’avoir
confiance en Lui toujours et « quand même ! » La Rédaction improvisée et
semi-permanente comme… les trains [militaires].
Demain, lundi 15 novembre 1915, à 9 heures, service à la mémoire de tous les
tués au Bois le Prêtre. Allocution par l’Aumônier divisionnaire. »
(à droite) « TAISEZ-VOUS… MAIS FIEZ-VOUS !!! »
« Si l’un des devoirs du soldat français à l’heure actuelle est de ne jamais
dire ce qu’il sait concernant les opérations militaires, fût-ce le moindre
détail, un autre de ses principaux devoirs est de toujours se fier à ceux qui le
commandent. La confiance doit régner dans tous les cœurs et, si des succès
partiels semblent encore favoriser nos ennemis, il ne faut pas s’en émouvoir.
Partout chez les complices de la Kultur‡ apparaissent non seulement la
désillusion mais l’inquiétude et la crainte pour l’inévitable règlement de
comptes qui va suivre la victoire des Alliés. Mille et un rangs
Le Mouchoir paraît tous les Dimanches. »
JUS
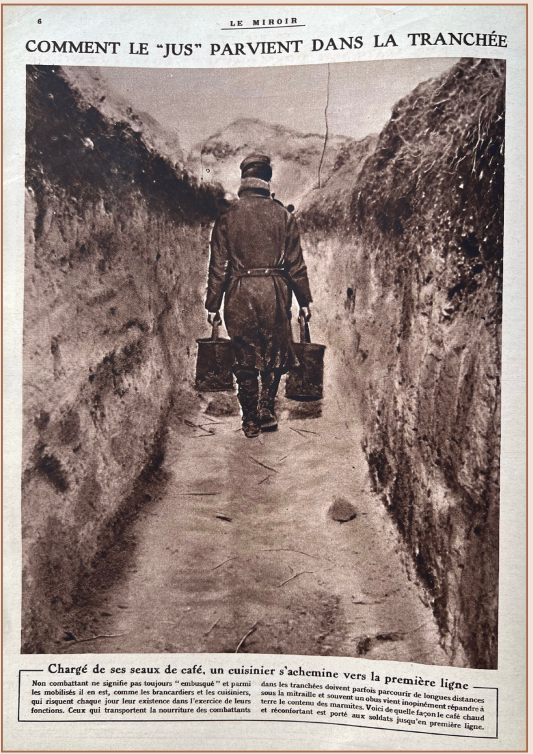
Journal Le Miroir - 21 mars 1915
Transcription
photo 124
« COMMENT LE « JUS » PARVIENT DANS LA TRANCHÉE* »
« Chargé de ses seaux de café, un cuisinier s’achemine vers la première ligne. »
« Non combattant ne signifie pas toujours « embusqué » et parmi les
mobilisés il en est, comme les brancardiers et les cuisiniers, qui risquent
chaque jour leur existence dans l’exercice de leurs fonctions. Ceux qui
transportent la nourriture des combattants dans les tranchées* doivent
parfois parcourir de longues distances sous la mitraille* et souvent un
obus* vient inopinément répandre à terre le contenu des marmites. Voici
de quelle façon le café chaud et réconfortant est porté aux soldats jusqu’en
première ligne. »
KÉPI
La coiffe typique du soldat français depuis 1852 est le képi. Adopté et décrit le 30 octobre 1884, il équipe l’infanterie métropolitaine en août 1914, à l’exception des chasseurs alpins.
Le 19 septembre 1914, un nouveau képi au design simplifié est adopté. Il laisse apparaître une bande frontale et un turban en une seule pièce, ainsi qu’une nouvelle teinte bleu-gris.
En décembre 1914, le fournisseur de casque* Adrian présente au général * Joffre* un crâne en métal à insérer sous le képi, destiné à protéger les soldats des éclats de projectiles.
En février 1915, une commande de 700 000 crânes en métal est passée. L’exemple ci contre, inspiré du modèle de 1884, témoigne de l’efficacité de ces crânes en métal. Le képi, particulièrement endommagé par un éclat d’obus*, sauve la vie du caporal* Marcel Delesques de la compagnie* du 319e régiment d’infanterie. Ce dernier est blessé le 31 mai 1915 lors de l’attaque du « Labyrinthe » : une position allemande au sud de Neuville-Saint Vaast, composée d’un dédale de tranchées* et de tunnels entourant des structures fortement fortifiées.118 (Cf : Tenue de Campagne)

Képi* modèle de 1884

Képi* avec crâne en métal, modèle 1914 du 319e régiment d’infanterie*

Képi* modèle de 1915
KOLOSSAL
Le terme Kolossal est la traduction allemande du mot Allemand « Colossal ». On qualifie de colossal un objet aux dimensions considérables, qui présente des proportions énormes.119
LÉGION D’HONNEUR
La Légion d’honneur est la plus haute distinction en France et est largement reconnue dans le monde.
La tradition de remise de la Légion d’honneur par le président de la République, pour récompenser les citoyens méritants dans tous les domaines, persiste depuis deux siècles. Toutefois, diverses autorités, telles que ministres, institutions et personnalités politiques, peuvent éventuellement la délivrer.
Initialement attribuée avec parcimonie afin de conserver son prestige et minimiser le nombre de rentes viagères distribuées aux légionnaires, la légion d’honneur se voit distribuée plus fréquemment durant la grande guerre. Il est nécessaire de reconnaître le mérite et l’héroïsme des soldats qui servent fidèlement leur nation.120
De plus, l’ordre de la Légion d’honneur doit s’adapter aux circonstances exceptionnelles du conflit. De nouveaux modes de reconnaissance sont instaurés pour saluer l’héroïsme des combattants et apporter un réconfort aux familles. Cela se concrétise par la création de nouvelles modalités de nomination, telles que des tableaux spéciaux, une législation pour les mutilés de guerre, ainsi que des titres honorifiques posthumes. 121 (Cf : Citation / Médaille Militaire/Croix de Guerre)

Toul◊ - 6 février 1916
Remise de décoration (grand cordon de la Légion d’honneur au général* Roques)
par le président Poincaré** et le général Joffre** dans la cour de la mairie.

Légion d’Honneur* III° République. Croix d’un module assez particulier
(environ 2/3 de la taille habituelle) avec centre en 3 parties.

Légion d’Honneur* III° République, avec centre en 3 parties.
Ruban mixte Légion d’Honneur / Croix de Guerre* 1914-1918.

Légion d’Honneur* III° République d’un modèle standard.
Ruban mixte Légion d’Honneur* / Médaille Militaire* / Croix de Guerre* 1914-1918.
LETTRES
Durant le conflit, la correspondance est un élément crucial pour maintenir le moral des soldats. Néanmoins, il n’est pas permis d’informer les civils des horreurs vécues au front pour éviter la panique générale. Dès le début de la guerre, des mesures de contrôle strictes sont instaurées pour censurer toute information pouvant révéler les conditions désastreuses dans lesquelles se trouvent les militaires.
L’administration militaire, gérant l’acheminement du courrier (Cf: Poste), filtre les courriers et n’hésite pas à détruire les plus incriminants. La censure est stricte, avec un contrôle minutieux des lettres et des cartes (Cf : Poste).
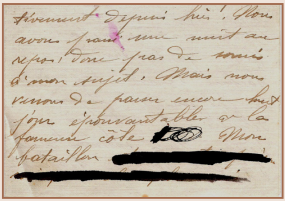
Extrait d’une lettre* censurée - 31 janvier 1917
Transcription
« (…) Nous avons passé une nuit au repos, donc pas de soucis à mon sujet.
Mais nous venons de passer encore huit jours épouvantables à la ferme côte
-censuré- Mon bataillon -censuré. »
LIEUTENANT
(Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
LOUPS DU BOIS-LE-PRÊTRE
La 73e Division d’Infanterie* est la division* de l’Armée française qui participe aux offensives menées à Bois le-Prêtre sous le commandement du général* Lebocq**.
Elle est composée de la brigade* mixte de Toul◊, devenue la brigade active de Toul° de septembre 1914 à juin 1915 et comprend, entre autres, le 167e régiment d’infanterie, le 168e régiment d’infanterie et le 169e régiment d’infanterie.
Plus de 3 500 soldats français sont tués lors des combats au Bois-le Prêtre◊. Mais leurs adversaires, ayant subi des pertes équivalentes, sont tellement impressionnés par leur combativité qu’ils les comparent à des loups. C’est de cette métaphore que naît le surnom des « Loups du Bois-le-Prêtre », qui devient leur titre de gloire.123
En juin 1915, la brigade* active de Toul évolue pour devenir la 128e division* d’infanterie en raison de l’intégration du 100e régiment d’infanterie*. Cette nouvelle unité se fait rapidement connaître sous le nom de la « Division* des Loups », en raison de l’exceptionnalité des actions menées à Bois-le-Prêtre.
En 1918, la 128e est une troupe d’une extrême solidité. Si bien que le général Duchene, commandant de la 6e armée, considère la division du général Lebocq** comme l’une de ses meilleures unités.124
Le profil de la tête de loup est rapidement adopté comme symbole. Aujourd’hui, ce symbole féroce orne divers monuments commémoratifs érigés dans les anciennes zones de combat.

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniévilleo - 2024
Insigne régimentaire du 169e régiment d’infanterie* de forteresse (1939).
La nécropole nationale de Montauville, communément appelée « Le Pétant », abrite les sépultures de 13 519 soldats français ayant donné leur vie au cours des deux guerres mondiales. Fondée en 1914, pendant les combats du Bois-le-Prêtre, elle est aménagée entre 1920 et 1936 pour accueillir les dépouilles d’autres combattants disséminés dans la région de Pont-à-Mousson.125
Les loups du Bois-le-Prêtre, trouvent aussi leur hommage au mémorial du cimetière de Choloy, érigé en 1958. Ce lieu recueille les corps de 308 combattants décédés dans les hôpitaux de Toul des suites de leurs blessures.126

Montauville◊ - 2024
Nécropole nationale du Pétant◊

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - date inconnue
Insignes des Loups* du Bois-le-Prêtre◊

Choloy-Ménillot - Date inconnue
Cimetière militaire de Choloy

Montauville◊ - Janvier 2023
Monument commémoratif
MARENNES
Les marennes sont des huîtres qui proviennent du bassin de Marennes en Charente Maritime.127
MARMITES
Les soldats français utilisaient le terme marmite pour désigner les projectiles allemands, notamment les Minenwerfer. Ce surnom est vraisemblablement en lien avec leur forme et leur poids.128 (Cf: Obus / Artillerie (Armes))
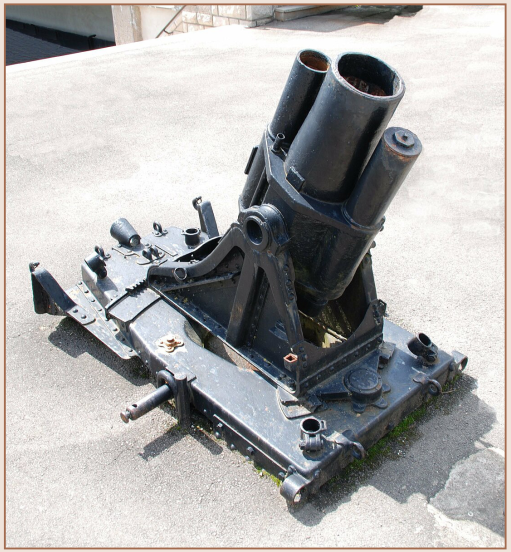
Mémorial de Verdun◊ - 2009
Minenwerfer Allemand
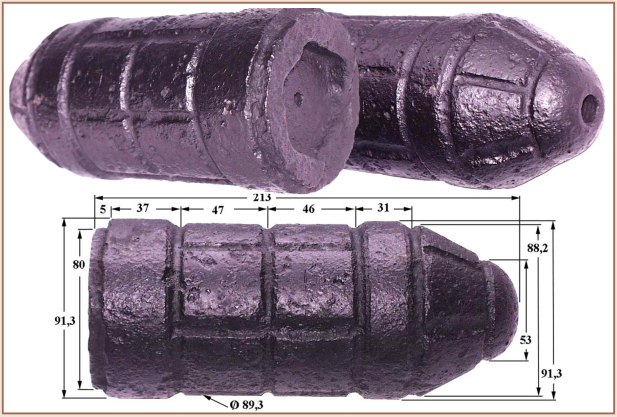
Projectile en fonte pour Minenwerfer allemand de 1915
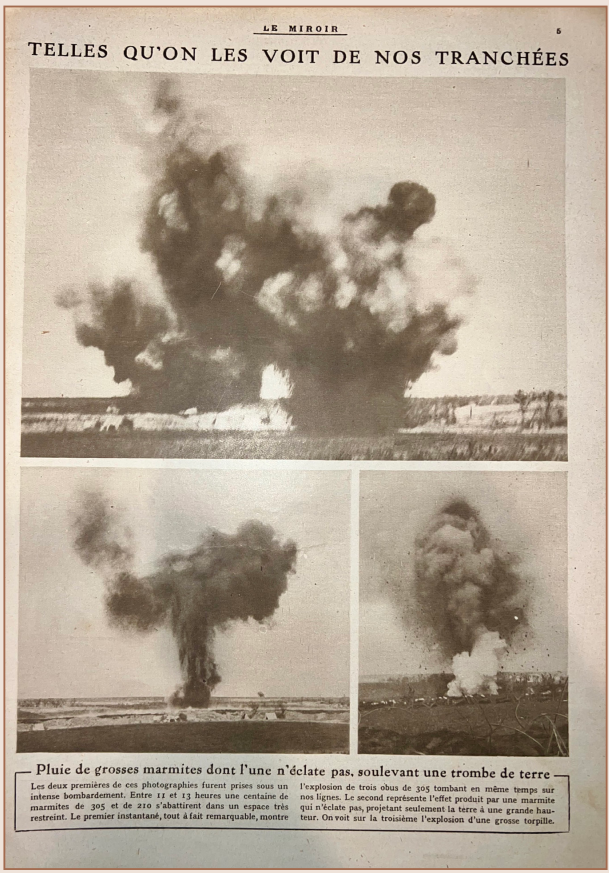
Journal Le Miroir - 29 août 1915
Transcription
photo 140
« TELLES QU’ON LES VOIT DE NOS TRANCHÉES* »
« Pluie de grosses marmites* dont l’une n’éclate pas,
soulevant une trombe de terre »
« Les deux premières de ces photographies furent prises sous un intense
bombardement. Entre 11 et 13 heures une centaine de marmites* de 305 et de
210 s’abattirent dans un espace très restreint. Le premier instantané, tout à
fait remarquable, montre l’explosion de trois obus* de 305 tombant en même
temps sur nos lignes. Le second représente l’effet produit par une marmite qui
n’éclate pas, projetant seulement la terre à une grande hauteur. On voit sur la
troisième l’explosion d’une grosse torpille*. »
MÉDAILLE MILITAIRE
La Médaille Militaire est considérée comme la plus haute distinction pour les sous-officiers* et les soldats au sein des forces armées françaises. Elle est souvent qualifiée de Légion d’honneur* du sous-officier* en raison de sa valeur symbolique.
L’histoire de la Médaille Militaire remonte à sa création par Napoléon III en 1852, 50 ans après la Légion d’honneur*. Elle forge sa réputation dans les grandes guerres du XXe siècle, honorant 950 000 médaillés de la Première Guerre mondiale, la plupart attribués à titre posthume.
Cette décoration occupe une place éminente dans l’ordre de préséance, se classant juste après l’ordre de la Légion d’honneur et l’ordre de la Libération. Elle récompense des individus pour des actes de bravoure exceptionnels, des exploits remarquables, ou pour leur dévouement et leur service exemplaire sous les drapeaux.
Les critères d’attribution de la Médaille Militaire sont exigeants: il faut être engagé sous les drapeaux pendant au moins huit ans, avoir été cité à l’ordre de l’armée, avoir été blessé* au combat ou en service commandé et s’être signalé par un acte de courage et de dévouement. Ces conditions strictes reflètent l’exigence inhérente à la reconnaissance étatique qu’incarne la Médaille Militaire.129
MESS
Un mess est une cantine pour la troupe, un restaurant militaire pour officiers* ou sous-officiers.*130 (Cf : Pitance)
MINES
Les mines sont des charges explosives amenées sous la tranchée ennemie dans le but de la faire exploser. Elles sont placées dans des galeries souterraines, spécialement creusées à cet effet par des troupes spécialisées appelées sapeurs (Cf: Sape / Soldats du Genie (Sapeurs)). Par extension, une mine désigne aussi l’ensemble du passage souterrain creusé par l’assaillant jusqu’à la position adverse afin d’y aménager une chambre de mines.131
MITRAILLE – VOIR BOÎTE À MITRAILLE
(Cf : Boîte à mitraille)
MITRAILLEURS
Les mitrailleurs sont responsables de l’opération de la mitrailleuse, ce qui inclut le chargement des munitions, le réglage de l’arme, la visée et le tir.
Les mitrailleuses sont des armes redoutables qui peuvent délivrer un volume de feu massif sur l’ennemi. Ces soldats sont souvent regroupés en équipes de mitrailleurs, travaillant ensemble pour fournir un appui-feu lors des assauts ou pour défendre des positions stratégiques.132

Fort de Douaumont (Verdun) - 1916
Soldats français, l’un derrière une mitrailleuse allemande Maxim MG 08
et le second tenant la bande chargeur.
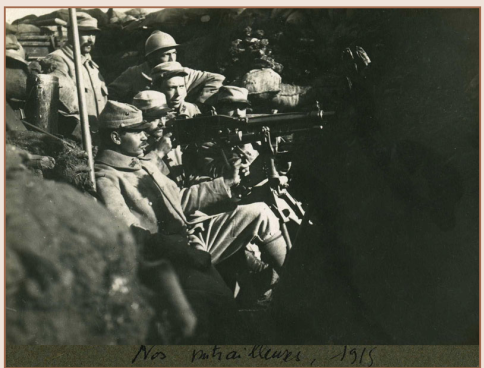
Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Nos Mitrailleurs (Légende d’origine)
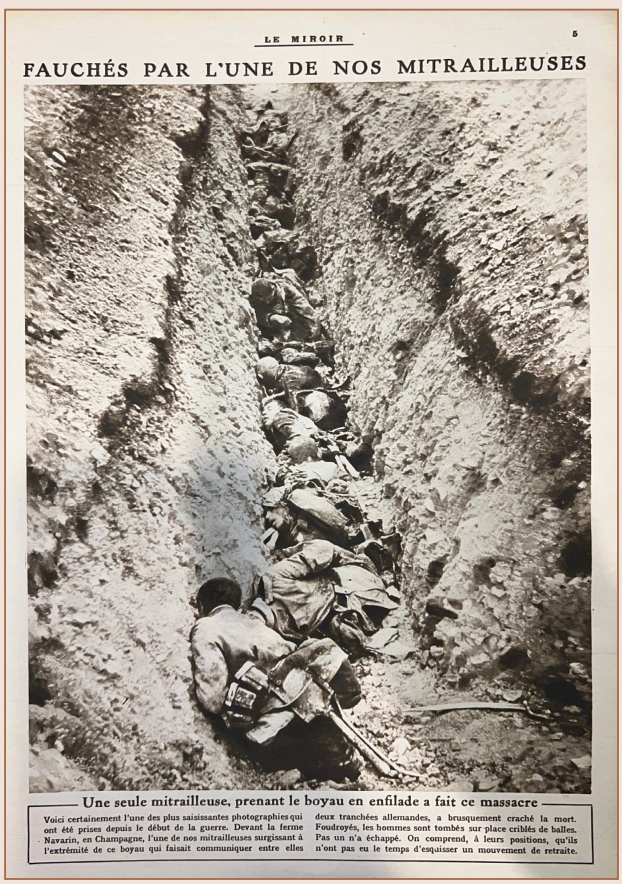
Journal Le Miroir - 7 novembre 1915
Transcription
photo 143
« FAUCHÉS PAR L’UNE DE NOS MITRAILLEUSES »
« Une seule mitrailleuse, prenant le boyau en enfilade a fait ce massacre »
« Voici certainement l’une des plus saisissantes photographies qui ont été
prises depuis le début de la guerre. Devant la ferme Navarin, en Champagne,
l’une de nos mitrailleuses surgissant à l’extrémité de ce boyau qui faisait
communiquer entre elles deux tranchées* allemandes, a brusquement craché
la mort. Foudroyés, les hommes sont tombés sur place criblés de balles. Pas
un n’a échappé. On comprend, à leurs positions, qu’ils n’ont pas eu le temps
d’esquisser un mouvement de retraite. »
MOBILISATION GÉNÉRALE
Au lendemain de la déclaration de la première guerre mondiale, le 1er août 1914, la mobilisation générale est déclarée dans l’ensemble du territoire français. La population masculine entre 20 et 48 ans est appelée aux quatre coins du pays dans un délai de 17 jours seulement. Ce mouvement de Mobilisation Générale est un franc succès: trois millions d’hommes viennent renforcer les rangs de l’armée active qui en comptait alors 880 000.133
La campagne se déroule sans signe d’opposition : les soldats adoptent de manière globale une attitude résignée et partent avec conviction défendre la France. Aucun plan de grève générale ou de manifestation pacifiste, pourtant nombreuses au cours du mois juillet, ne viennent perturber l’enrôlement des troupes (Cf : Fleurs au Fusil). L’esprit d’union sacrée*, adopté à la fois par le gouvernement et la population française, pousse chaque individu à s’impliquer consciencieusement dans l’effort de guerre* collectif.
Un des premiers secteurs réorientés pour satisfaire les besoins de la guerre est celui des transports. Autobus, tramways, camions, voitures et même chevaux sont réquisitionnés à des fins particulières. Le 2 août, 264 autobus parisiens sont déployés vers l’est pour transporter des troupes, tandis que 770 autres sont mobilisés pour le ravitaillement. Les tramways, quant à eux, sont adaptés en ambulances, assurant le transfert de blessés* dans plusieurs villes. Même les voitures, transformées en auto chirurgicales ou en taxi, sont intégrées à cet effort de guerre*.134
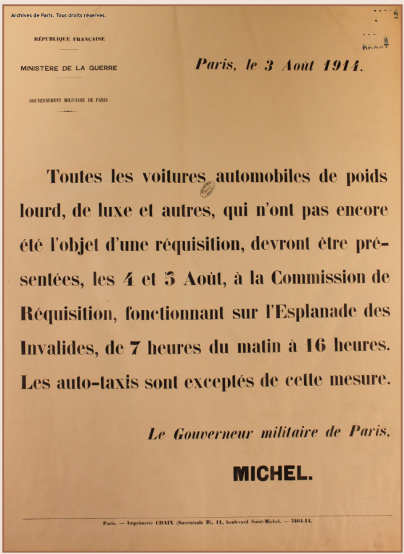
Paris - 3 août 1914
Ordre de réquisition des voitures automobiles par
le gouverneur* militaire de Paris, Victor Michel.
Transcription
« Paris, le 3 Août 1914 »
« Toutes les voitures automobiles de poids lourd, de luxe et autres, qui n’ont pas
encore été l’objet d’une réquisition, devront être présentées, les 4 et 5 Août, à
la commission de Réquisition, fonctionnant sur l’Esplanade des Invalides, de 7
heures du matin à 16 heures. Les auto-taxis sont exemptés de cette mesure. »
« Le Gouverneur militaire de Paris »
« MICHEL »
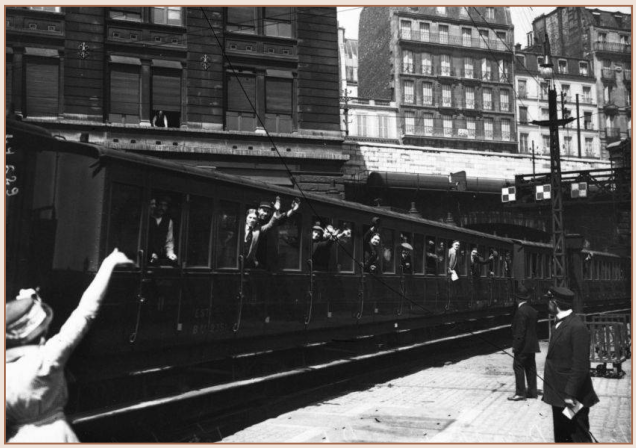
Paris - 2 août 1914
Premiers départs vers le front depuis la Gare de l’Est

Paris, Esplanade des Invalides - 1914
La Réquisition des automobiles
MUSETTE
La musette est un petit sac ou une poche portée en bandoulière ou attachée à l’uniforme militaire pour transporter des objets essentiels tels que des munitions, des fournitures médicales et d’autres équipements de terrain.

Musette* de 1879
NETTOYAGE DES TRANCHÉES
Le processus de nettoyage des tranchées* est une technique stratégique couramment utilisée par l’armée pendant la guerre.
Des soldats sont chargés de tuer les ennemis restés dans les tranchées tandis que les troupes d’assaut continuent à progresser. Cette stratégie est cruciale puisqu’elle garantit qu’aucun ennemi ne soit laissé derrière la ligne d’avancée.
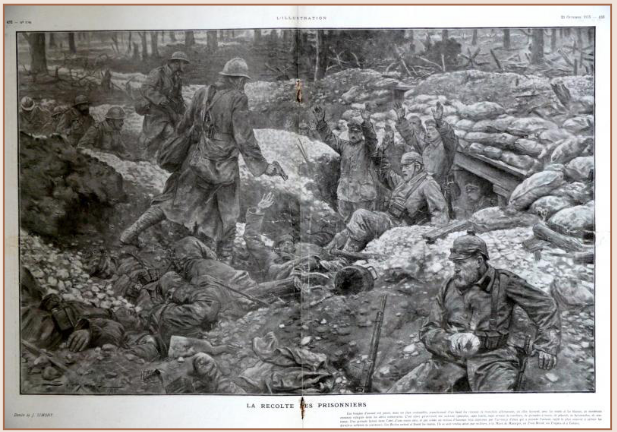
Illustration du samedi 23 octobre 1915
Transcription
« La récolte des prisonniers* »
« Les troupes d’assaut ont passé, dans un élan irrésistible, franchissant d’un
bon les réseaux de tranchées* allemandes, où elles laissent, avec les morts
et les blessés*, de nombreux ennemis réfugiés dans les abris souterrains.
C’est alors qu’arrivent des sections* spéciales, sans fusils, mais armées de
revolvers, de grenades* à main, de pétards, de baïonnettes*, de couteaux. Une
grenade* lancée dans l’abri d’une main sûre, et qui éclate au milieu d’hommes
déjà déprimés par l’arrosage d’obus* qui a précédé l’assaut, suffit le plus
souvent à calmer les dernières velléités de résistance. Les Boches* sortent et
lèvent les mains. Ils se sont rendus ainsi par milliers, à la Main de Massiges,
au Trou Bricot, au Trapèze et à Tahure »
OBSERVATOIRE
L’observatoire désigne une position élevée qui offre une vue dégagée sur le champ de bataille. Il est particulièrement utile pour effectuer les réglages d’artillerie* 137 (Cf: Grand-Garde / Petit Poste / Section de Piquets)
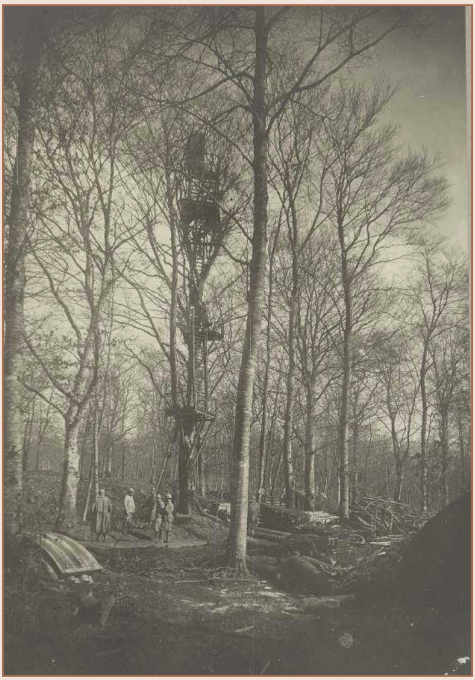
Bois-le-Prêtre◊ - 2 mars 1916
Observatoire* d’artillerie* (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 1914
Observatoire* (Légende d’origine)
OBUS
Un obus est un projectile d’artillerie* généralement cylindrique ou conique qui est tiré depuis un canon ou un mortier (Cf: Batterie). Les obus sont largement utilisés pendant la guerre pour causer des dégâts matériels, tuer des soldats ennemis et perturber les lignes de front. Ils sont souvent chargés d’explosifs ou de gaz toxiques et leur impact peut avoir des conséquences dévastatrices sur les soldats et les zones de combat (Cf: Gueules Cassées).138
Plusieurs types d’obus sont déployés lors des combats entre 1914 et 1918:
• Les obus éclairants, ou fusées* éclairantes, désignent un projectif explosif produisant une lumière de couleur. Ce signal lumineux correspond à un code spécifique et change régulièrement selon les périodes et les unités concernées. Les fusées* éclairantes sont principalement utilisées par l’infanterie pour communiquer avec l’artillerie* et constituent un élément essentiel de la coordination entre les branches militaires.
• Les obus à mitraille* équipent encore les canons de 80, 90, 95, 120 et 155 mm en 1916. Malgré une technologie avancée, les obus à mitraille* dispersent les projectiles avec une vitesse relativement faible et un nuage d’éclatement peu visible. Seule la bonne compacité de l’ensemble est un avantage, ce qui fait de ce projectile une arme convenable pour la destruction d’abris* non renforcés (Cf: Boîte à Mitraille).
Toutefois, certains de ces obus ne détonnent pas, explosent trop vite, ou, pire, au départ du coup. De plus, les éclatements de tube ne font qu’augmenter à partir de décembre 1914. Un rapport établit qu’il y en a six entre août et décembre, soit un éclatement pour 500 000 coups tirés, contre 236 entre le 20 décembre et le 20 mars 1915. Les procédures de contrôle de qualité et de tolérance lors du processus de fabrication des obus sont alors revues pour se rapprocher des standards du temps de paix.
Les éclatements deviennent plus rares, à raison d’un pour 11 000 coups au
printemps, puis d’un pour 50 000 à la fin de l’été 1915.139
(Cf : Percutant / Fusant)

Près de la gare du Quesnel - Août 1916
Convoi d'obus* de 220 mm. Chacun fait 100 kg. (Légende d’origine)

Musée la Baïonnette, Thiaucourt-Regniéville◊ - 2024
Culot d’un obus* à mitraille. Calibre approximatif de 120 mm
, avec des logements usinés pour balles. Rempli de balles en plomb.
OFFICIER
(Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
PARADOS
Le monticule situé de l’autre côté de la tranchée* est appelé le parados et protège la tranchée* des obus* tombant derrière elle.140 (Cf: Créneau / Casquette)
PARAPET

Septembre 1915
Parapet*
PATELIN
Le patelin est le synonyme d’un village, d’une localité.142 (Cf: Pays)
PATROUILLE
Une patrouille est une opération pratiquée par un petit groupe de combattants en avant des tranchées* de première ligne. Leur stratégie consiste à repérer et reconnaître les positions défensives de l’ennemi.143
PAYS
Un pays est un territoire délimité qui est perçu comme une unité distincte en raison de l’identité ou des intérêts communs partagés par ses habitants. Cette définition peut s’appliquer aussi bien à de petites entités telles que des villages qu’à des zones urbanisées plus vastes.144 (Cf: Patelin)
PERCUTANTS
Le percutant est un type d’obus* qui éclate lors du contact avec le sol.145 (Cf: Obus)
PERISCOPE
Le périscope est un instrument optique composé de miroirs obliques, conçu spécifiquement pour permettre l’observation de l’extérieur de la tranchée* en direction des lignes ennemies sans avoir à s’exposer aux tirs.146

Env.1915
Périscope* de tranchée*
PETIT POSTE
Le Petit Poste est un poste avancé situé devant la première ligne de tranchée*.
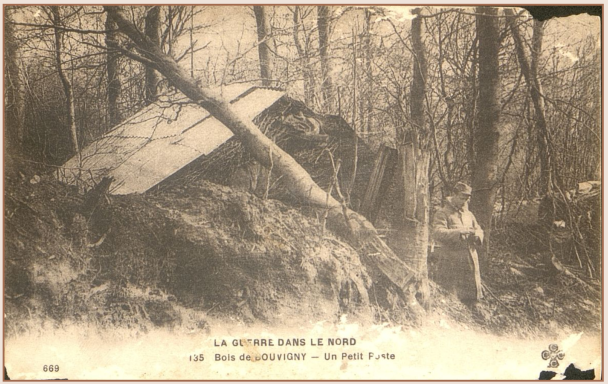
Bois de Bouvigny - 1915
La guerre dans le Nord - un petit poste* (Légende d’origine)
PIÈCES
Le mot pièce est synonyme de canon*, ou encore de pièces d’artillerie*.148 (Cf: Obus)
PIQUETS
Les piquets font référence aux poteaux en bois ou en métal qui sont utilisés sur les champs de batailles pour diverses fins: supports logistiques, rôle défensif, marquage des tranchées*.149 (Cf: Corvée de Piquets / Section de Piquets)

Bois-le-Prêtre◊ - 2024
Piquets* de tranchée* de la Première Guerre mondiale
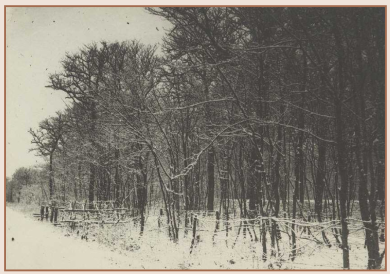
Bois-le-Prêtre◊ - Mars 1916
Fils de fer barbelés et piquets*
PITANCE
Les soldats dans les tranchées* sont confrontés à des conditions difficiles, y compris des pénuries alimentaires. En service, ils reçoivent des rations de base, souvent appelées pitances, pour subvenir à leurs besoins nutritionnels. (Cf : Rationnement)
Le poilu* en première ligne consomme entre 3000 et 4000 calories par jour. Sa musette* contient une ration de réserve essentielle pour plusieurs jours, comprenant généralement 300 g de biscuit, 300 g de viande en conserve, 80 g de sucre, 36 g de café, 50 g de potage, 6,25 cl d’eau-de-vie et à partir de février 1916, 125 g de chocolat. En partant au front, chaque soldat doit emporter suffisamment de provisions pour être autosuffisant pendant au moins 2 jours en l’absence de ravitaillement régulier.150
La viande est d’ailleurs introduite de manière systématique dans leur alimentation quotidienne à hauteur de 300 à 500 grammes par jour. Pour ce faire, des troupeaux sont amenés directement sur le front, où ils sont tués et découpés. Un régiment* de ravitaillement en viande est même créé pour soutenir cet effort. Les moyens de conservation étant limités, se répand la consommation de viande en conserve, appelée le singe*.
Le vin, quant à lui, constitue un élément essentiel de la ration quotidienne des poilus. C’est un des rares moyens de s’extraire de l’horreur du contexte de guerre. La quantité de vin consommée augmente d’ailleurs à mesure que le temps passe : d’un quart de rouge par jour en 1914 (25 cl), à une fillette en 1915 (37,5 cl), les poilus* consomment un demi-litre par jour en 1916, pour finalement atteindre un litre en 1918.

Steinbach - 2 mars 1916
Repas de soldats
Ce changement dans les habitudes alimentaires des soldats sur le front s’inscrit dans le contexte plus large des évolutions survenues pendant la Première Guerre mondiale.151
Le conflit est le moteur du développement de l’industrie de la mise en boîte, avec des entreprises telles que Lefèvre-Utile (LU), Cassegrain et Saupiquet. Les conserves contiennent non seulement de la viande, mais aussi du poisson, des légumes et même du pain de guerre sous forme de biscuits secs. Ces provisions sont essentielles pour assurer l’alimentation des soldats sur le front et garantir qu’ils disposent d’une source de nourriture durable et transportable.152 (Cf: Effort de guerre)
Pour livrer des aliments prêts à la consommation, un réseau de « stations magasins » est établi. Ce dernier est lié à chaque corps d’armée, stockant et traitant les denrées alimentaires. Chaque station fournit des rations pour les hommes et les chevaux, avec des installations de transformation et de préparation des aliments, tels que des abattoirs et des boulangeries.
La guerre de mouvement initiale oblige les fantassins* à apporter leurs propres vivres jusqu’en 1915, où des cuisines roulantes sont installées pour améliorer leur approvisionnement. Les cuisiniers improvisés, recrutés parmi les réservistes de l’armée territoriale, préparent des repas roboratifs mais peu variés. Les ravitailleurs* prennent le relais lorsque l’accès aux premières lignes est difficile : ils transportent du pain et des plats cuisinés dans des bouteillons. Au cantonnement*, les soldats peuvent profiter de repas plus festifs, parfois en chassant ou en pêchant pour diversifier leurs rations.
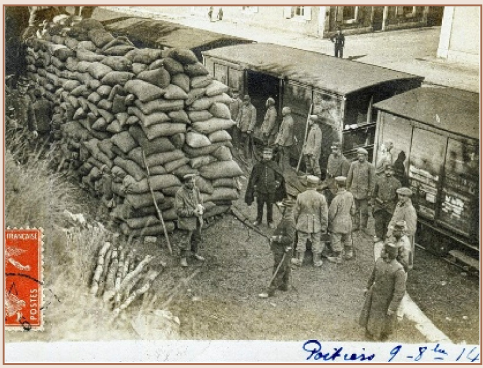
Poitiers - 9 octobre 1914
Gare des marchandises. Déchargement de denrées. (Légende d’origine)

Bois-le-Prêtre◊ - 1916
Corvée* de soupe

Lieu et date inconnus
Halte dans un bois. Cuisine roulante (Légende d’origine)
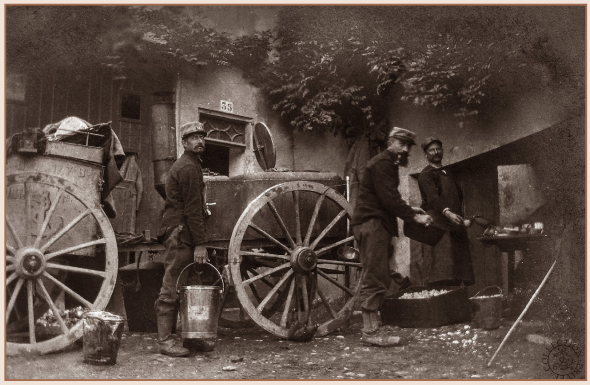
Maidières - 1915
La cuisine des brancardiers

Tranchée* de Fey, Bois-le-Prêtre◊ -1915 Corvée* de soupe.
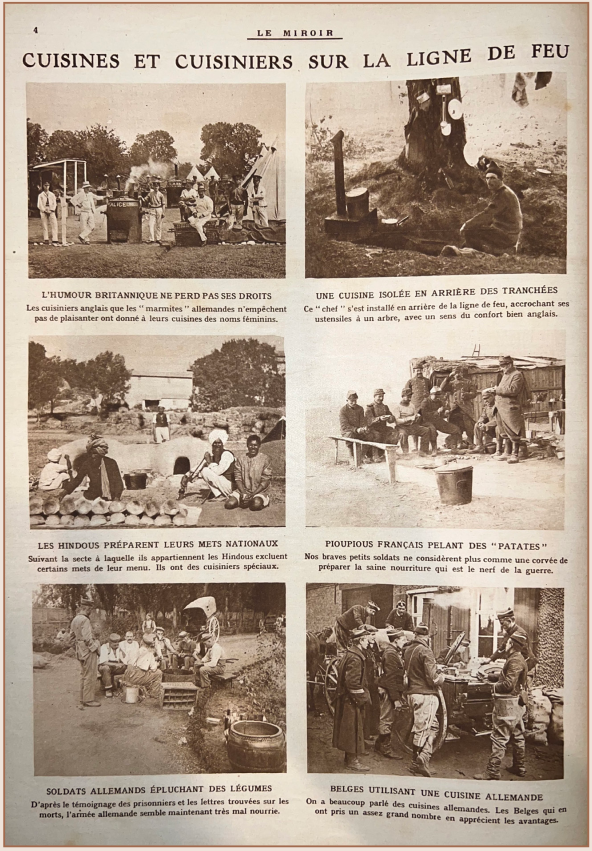
Journal Le Miroir - 22 novembre 1914
Transcription
photo 164
(de gauche à droite, de haut en bas)
« CUISINES ET CUISINIERS SUR LA LIGNE DE FEU »
« L’humour Britannique ne perd pas ses droits »
« Les cuisiniers anglais que les « marmites* » allemandes n’empêchent pas de
plaisanter ont donné à leur cuisines des noms féminins. »
« Une cuisine isolée en arrière des tranchées* »
« Ce « chef » s’est installé en arrière de la ligne de feu, accrochant ses
ustensiles à un arbre, avec un sens du confort bien anglais. »
« Les Hindous préparent leurs mets nationaux »
« Suivant la secte à laquelle ils appartiennent les Hindous excluent certains
mets de leur menu. Ils ont des cuisiniers spécieux. »
« Pioupious Francais pelant des “patates »
« Nos braves petits soldats ne considèrent plus comme une corvée* de
préparer la saine nourriture qui est le nerf de la guerre »
« Soldats Allemands épluchant des légumes »
« D’après le témoignage des prisonniers* et les lettres* trouvées sur les morts,
l’armée allemande semble maintenant très mal nourrie. »
« Belges utilisant une cuisine Allemande »
« On a beaucoup parlé des cuisines allemandes. Les Belges qui en ont pris un
assez grand nombre en apprécient les avantages. »
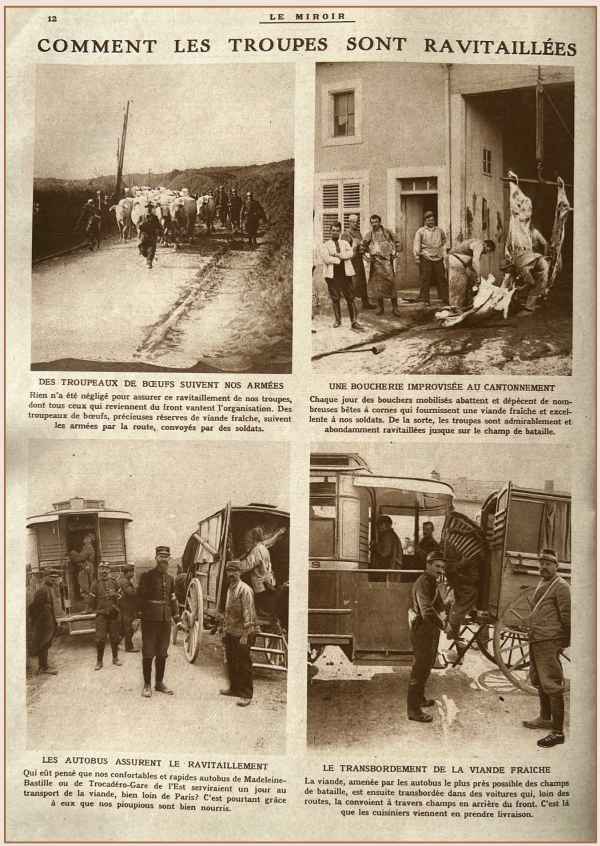
Journal Le Miroir - 4 octobre 1914
Transcription
photo 165
(de gauche à droite, de haut en bas)
« COMMENT LES TROUPES SONT RAVITAILLÉES »
« Des troupeaux de boeufs suivent nos armées »
« Rien n’a été négligé pour assurer ce ravitaillement de nos troupes, dont
tous ceux qui reviennent du front vantent l’organisation. Des troupeaux de
bœufs, précieuses réserves de viande fraîche, suivent les armées par la route,
convoyés par des soldats »
« Une boucherie improvisée au cantonnement* »
« Chaque jour des bouchers mobilisés abattent et dépècent de nombreuses
bêtes à cornes qui fournissent une viande fraîche et excellente à nos soldats.
De la sorte, les troupes sont admirablement et abondamment ravitaillées
jusque sur le champ de bataille. »
« Les autobus assurent le ravitaillement »
« Qui eût pensé que nos confortables et rapides autobus de Madeleine-Bastille
ou de Trocadéro-Gare de l’Est serviraient un jour au transport de la viande,
bien loin de Paris? C’est pourtant grâce à eux que nos pioupious sont bien
nourris. »
« Le transbordement de la viande fraîche »
« La viande, amenée par les autobus le plus près possible des champs de
bataille, est ensuite transbordée dans des voitures qui, loin des routes, la
convoient à travers champs en arrière du front. C’est là que les cuisiniers
viennent en prendre livraison. »
PLANTON
Le planton est un soldat chargé du service d’un officier* supérieur et se tenant à sa disposition pour porter ses ordres. Le terme fait aussi référence à une sentinelle fixe qui monte la garde.154
POILU
Le mot poilu est un surnom donné aux soldats de la Première Guerre mondiale. Il désigne à l’époque, dans le langage familier ou argotique, quelqu’un de courageux, de viril.
Ce terme, qui trouve ses origines chez Balzac†, est utilisé pour décrire la ténacité et la résistance physique des troupes du Génie en 1812. Il remplace progressivement le terme moustache, utilisé pour désigner les soldats aux XVIIIe et XIXe siècles. La symbolique sous-jacente reste la même : en France, les qualités d’un soldat sont intrinsèquement liées à son genre. Bravoure, courage, endurance… sont des mérites propres au sexe masculin et s’expriment par une caractéristique physique évidentes : les poils.155
POMPES
Dans les galeries souterraines des tunnels de sape*, les pompes sont utilisées pour éliminer l’eau qui s’infiltre. Étant donné leur proximité avec des nappes phréatiques, les tunnels de sapes* sont souvent exposés à des infiltrations d’eau importantes. (Cf: Soldats du génie (Sapeurs)
D’autant plus que les soldats sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes durant la Première Guerre mondiale: en 1915 et 1916, la pluviométrie atteint des niveaux exceptionnellement élevés, se classant parmi les années les plus humides depuis le début des relevés météorologiques (1877) par le Bureau Central de Météorologie de France.156
« Ce simple mot, la pluie, qui ne veut presque rien dire, pour le citadin, pour le civilisé, qui a construit une maison et un toit, afin d’être abrité des intempéries, ce mot contient toute l’horreur de la vie du soldat en campagne. » Blaise Cendrars†††
Les conditions météorologiques posent un défi important pour les soldats. La pluie constante et le manque d’imperméabilité des uniformes les exposent davantage à la boue, ce qui rend leur déplacement difficile et ralentit leur avancée. Il est courant qu’ils doivent s’entraider pour éviter de s’embourber.157
« Et puis il y a la boue, l’adversaire invincible des poilus*, l’eau stagnante dans les boyaux*, les tranchées* qui s’écroulent sous la pluie, ou plutôt qui fondent littéralement et qu’il faut étayer sans cesse. Parce que les bombardements ont remué la terre, il n’y a plus de végétation pour retenir cette mer de “mélasse” qui semble vouloir engloutir les hommes. On se croirait sur la Lune, mais comme le souligne Pierre Loti, ” dans la lune, au moins, il ne pleut pas. » Yves Le Naour††††
Les pompes sont donc essentielles pour permettre aux soldats de travailler dans des conditions relativement sèches et sûres. Ils recourent fréquemment à des pompes manuelles afin de vider l’eau des tunnels et des puits de ventilation. Parfois, elles sont alimentées en électricité ou en air comprimé pour une plus grande efficacité.158
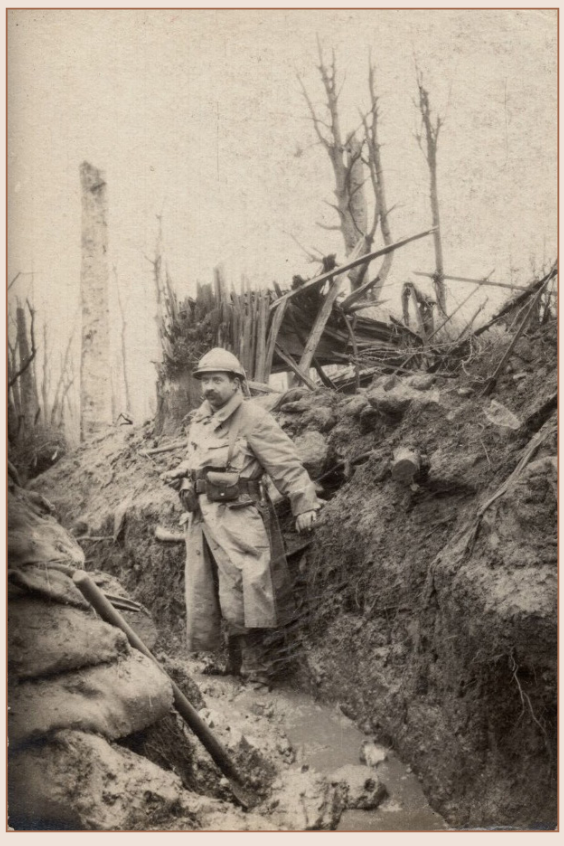
Bois-le-Prêtre◊ - Printemps 1916
Le sergent* Quarmon dans une tranchée envahie par l’eau et la boue

Four de Paris (Meuse) - 11 juillet 1917
Pompe de tranchée*
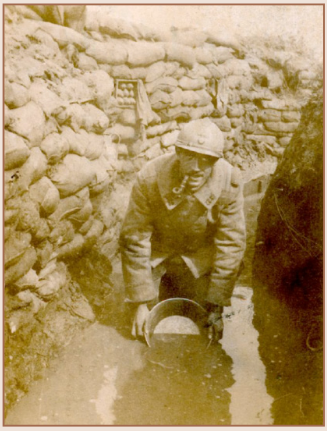
Lieu et date inconnus
Tranchée* inondée
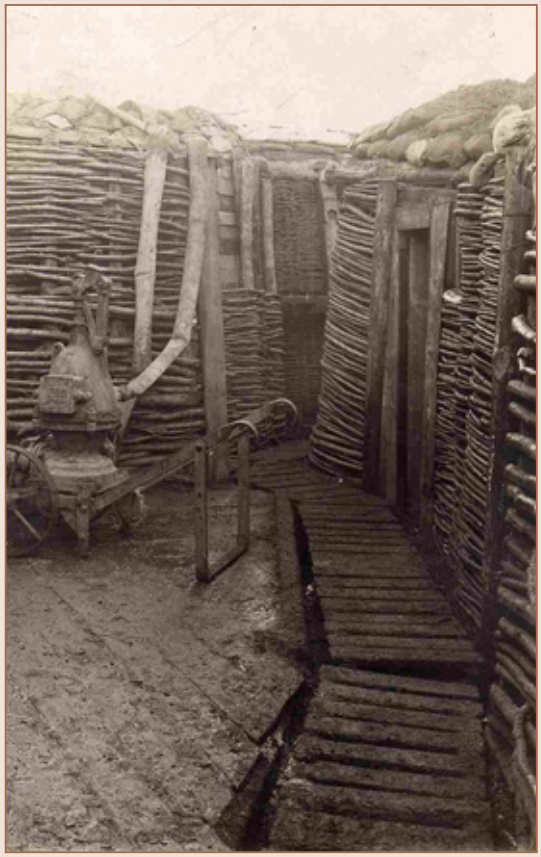
Meuse - 1915
Pompe de tranchée*
POMPIERS

Reims, Marne - 1917
Groupe de pompiers*
POSTE
En 1914, la Poste est une puissante administration, érigée au rang de secrétariat d’Etat des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT), sous l’égide du ministre de l’Industrie, du Commerce des Postes, Télégraphes et Téléphones. Elle possède un réseau étendu et varié et est présente dans le quotidien des Français.
Durant le conflit, on ne compte pas moins de 90 000 postiers pour un total de 120 000 agents des PTT dans l’Hexagone. Plus de 35 000 facteurs sillonnent 239les villes et campagnes d’un pays* balisé par 15 000 bureaux de poste de toutes catégories et 84 000 boîtes aux lettres* de rue.
À la fin de l’année 1913, le trafic annuel postal intérieur est de 3,3 milliards d’objets. A ce trafic civil en temps de paix, il faut ajouter le trafic généré par la guerre: en 1915, on l’estime à 2,4 milliards de correspondances reçues et expédiées par les troupes au front. Fin 1918, un rapport militaire indique que 8 milliards d’objets de correspondance auraient circulé en franchise en France.
La Poste civile doit traiter d’importantes quantités de courrier, allant de l’arrière-pays vers Paris, puis revenant de Paris vers l’arrière pays. Elle utilise le Bureau Central Militaire (BCM) comme point de liaison. En octobre 1914, 600 000 lettres* et 40 000 paquets vont vers le front chaque jour. En avril 1915, ce sont 4 millions de lettres* ordinaires, 150 000 paquets, 70 000 journaux et 15 000 mandats-cartes et mandats télégraphiques qui transitent vers le front chaque jour via le BCM à Paris et la Poste civile.
Grâce à la réquisition des trains et des véhicules automobiles, la mise en place de bureaux de Poste aux armées et d’un personnel mobilisé issu de l’administration des Postes, l’acheminement s’organise durant le conflit. À la fin de l’année 1915, le temps d’acheminement des correspondances se fait entre deux et cinq jours, au lieu des 15 jours, voire trois semaines au début de la guerre
Sur 120 000 fonctionnaires des PTT, 25 000 sont mobilisés dès le début des combats, dont 18 000 pour la seule branche postale (Cf: Effort de Guerre). Trois quarts des effectifs masculins fonctionnaires des PTT sont au front en septembre 1917, soit 70 à 75 000 hommes. Pour combler le déficit de postes, sont recrutés plus de 2 000 agents auxiliaires dans les premiers mois de guerre. Le personnel est essentiellement féminin et affecté au tri du courrier. 10 000 à 12 000 femmes sont recrutées comme auxiliaires entre septembre 1915 et 1919, dont 3 500 veuves de guerre. Jusqu’en 1923, environ 10 000 mutilés de guerre (Cf: Gueules cassées) sont employés par La Poste pour combler le déficit et les réintégrer dans la vie active après la Première Guerre mondiale. Cette décision à un double impact: elle contribue à la reconstruction nationale et augmente le nombre des effectifs.160 (Cf : Gueules cassées)

Paris, 10e arrondissement - Juin 1917
Factrices et facteurs au départ de tournée. (Légende d’origine)
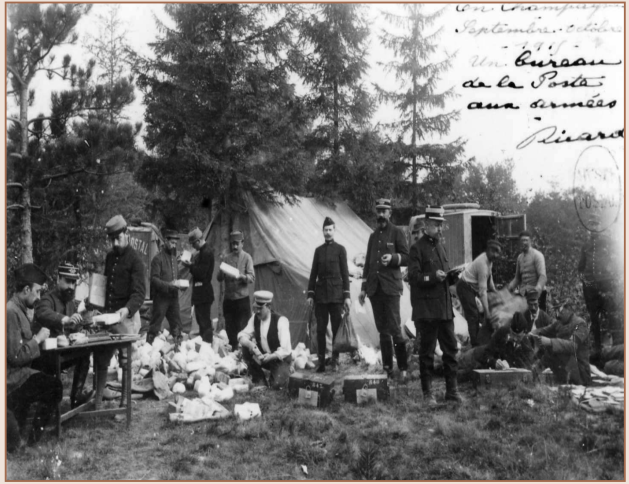
Champagne - Octobre 1915
Dépôt de colis et de paquets au bureau de la Poste* aux Armées sur le front (Légende d’origine)
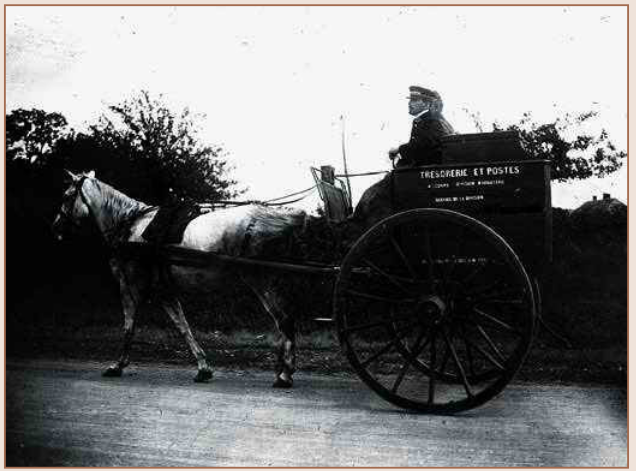
Lieu et dates inconnues
Tilbury de la Poste* aux armées. (Légende d’origine)
Transcription
« Trésorerie et Postes* / 4e corps, 7e division* d’infanterie / Service de la division »
« 4e escadron du train des Équipages Militaires »
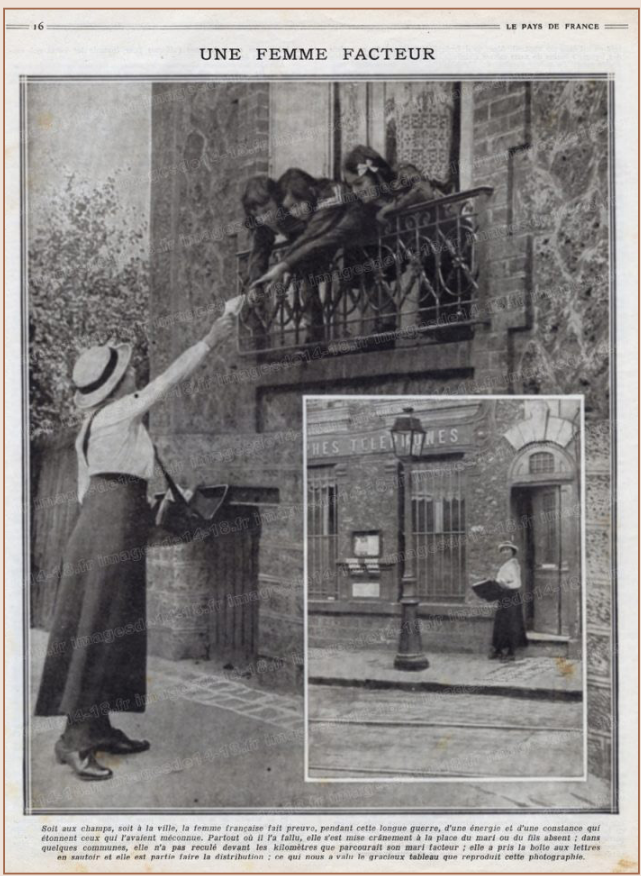
Journal Le Pays de France - 1915
Transcription
photo 174
« UNE FEMME FACTEUR »
« Soit aux champs, soit à la ville, la femme française fait preuve, pendant
cette longue guerre, d’une énergie et d’une constance qui étonnent ceux
qui l’avaient méconnue. Partout où il l’a fallu, elle s’est mise crânement à la
place du mari ou du fils absent ; dans quelques communes, elle n’a pas reculé
devant les kilomètres que parcourait son mari facteur ; elle a pris la boite aux
lettres* en sautoir et elle est partie faire la distribution ; ce qui nous a valu le
gracieux tableau que reproduit cette photographie. »
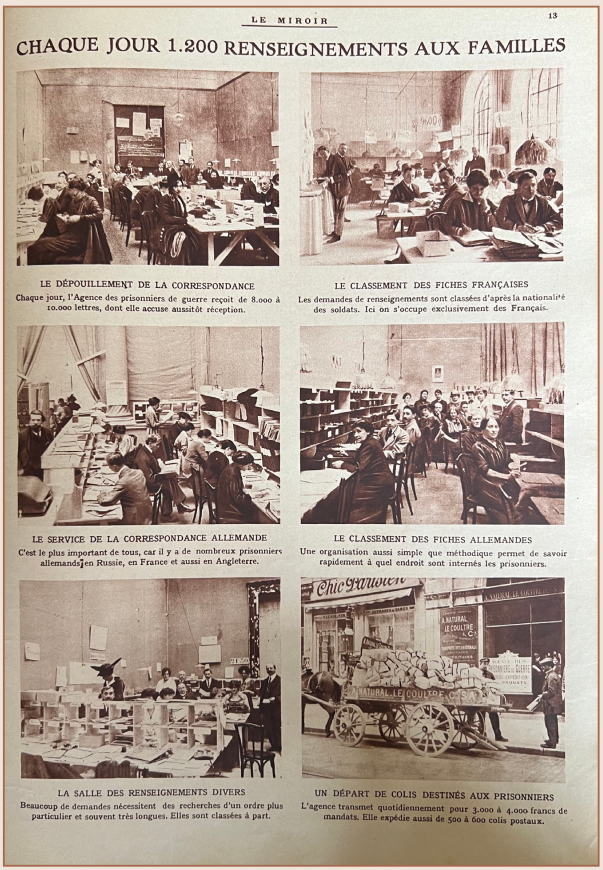
Journal Le Miroir - 7 mars 1915
Transcription
(de gauche à droite, de haut en bas)
photo 175
« CHAQUE JOUR 1.200 RENSEIGNEMENTS AUX FAMILLES »
« Le dépouillement de la correspondance »
« Chaque jour, l’Agence des prisonniers* de guerre reçoit de 8.000 à 10.000
lettres*, dont elle accuse aussitôt réception. »
« Le classement des fiches françaises »
« Les demandes de renseignements sont classées d’après la nationalité des
soldats. Ici on s’occupe exclusivement des Français. »
« Le service de la correspondance allemande »
« C’est le plus important de tous, car il a de nombreux prisonniers* allemands
en Russie, en France et aussi en Angleterre. »
« Le classement des fiches allemandes »
« Une organisation aussi simple que méthodique permet de savoir
rapidement à quel endroit sont internés les prisonniers*. »
« La salle des renseignements divers »
« Beaucoup de demandes nécessitent des recherches d’un ordre plus
particulier et souvent très longues. Elles sont classées à part. »
« Un départ de colis destinés aux prisonniers »
« L’agence transmet quotidiennement pour 3.000 à 4.000 francs de mandats.
Elle expédie aussi de 500 à 600 colis postaux. »
PRESSE
La presse française, qui avait joui d’une totale liberté depuis 1881, se trouve pour la première fois confrontée aux restrictions liées à la guerre, marquée par le rétablissement de la censure.
Dès le 30 juillet 1914, la censure des dépêches télégraphiques est instaurée à l’anticipation du déclenchement du conflit. Cette mesure vise à contrôler les informations qui pourraient compromettre la sécurité nationale.
Le 2 août, l’état de siège est proclamé sur l’ensemble du territoire français, conférant aux autorités militaires le pouvoir de suspendre toute publication périodique si elle est jugée préjudiciable à l’effort de guerre*.
Le 3 août, un bureau de la presse est créé au ministère de la Guerre. Il est chargé de filtrer et de contrôler les informations militaires avant leur publication, afin d’éviter la divulgation de détails tactiques ou stratégiques sensibles.
Le 5 août, une loi est promulguée précisant les interdictions et les sanctions applicables aux journaux* : elle interdit strictement la publication de nouvelles militaires non officielles, dans le but de préserver les secrets de l’armée.
Enfin, le 14 août, une commission de la presse française est établie pour servir d’interlocuteur entre le gouvernement et les directeurs de journaux* afin de faire respecter les directives gouvernementales et réguler la presse en temps de guerre.
L’objectif global de ces mesures est de maintenir l’ordre public, de préserver les informations militaires stratégiques et de garantir la cohésion nationale en période de crise (Cf: Propagande). 161
Cependant, en dépit de la censure, des journaux* critiques et pacifistes émergent, tels que « Le Canard Enchaîné », tiré à 40 000 exemplaires en 1917, ou encore « La Bataille », organe quotidien syndicaliste, œuvre de la CGT nettement pacifiste à l’automne 1917. Le tirage de ces titres augmente à mesure que le conflit s’éternise, suscitant l’inquiétude du haut commandement qui leur attribue une responsabilité dans les évènements des mutineries du Printemps de 1917 †.162
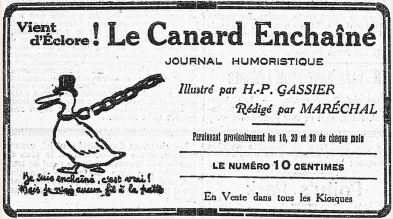
L'Humanité du 10 septembre 1915
PRISONNIERS
La Première Guerre mondiale engendre sept millions de prisonniers de guerre, dont environ 2 400 000 aux mains des forces allemandes. Les prisonniers français sont au nombre de 535 411 individus, soit 22% du total. La France quant à elle, compte près de 450 000 captifs, principalement d’origine allemande, soit cinq fois moins que son ennemie.163
Le IIe Reich n’est pas préparé à de tels flux; en 1914, c’est la désorganisation généralisée et la rareté des nouvelles qui donne libre cours à des rumeurs de mauvais traitements. Les prisonniers, envoyés dans des camps en wagons à bestiaux et abrités dans des forts, des casernes, des prisons, des granges et même des écoles, tous transformés en établissements pénitentiaires. De vastes camps de toile, particulièrement rudimentaires, sont édifiés à la hâte à la veille du rude hiver de 1914-1915. 164
Mais après 1915, le territoire allemand se couvre de plus de 300 camps principaux auxquels sont rattachés plus de 100 000 kommandos de travail†. Les prisonniers de guerre, astreints au travail, sont mis à dispositiond’employeurs par l’armée allemande. Les employeurs versent une redevance à l’armée, qui en retour alloue une indemnité pour les frais d’entretien des prisonniers.165
Chaque prisonnier reçoit un salaire appelé « lagergeld », qui équivaut à 60% du salaire d’un ouvrier allemand. Une partie de cette somme est déduite pour couvrir les frais de nourriture, de logement et de gestion du camp. Les conditions de détention sont extrêmement rudes, marquées par le froid, la faim, les maladies et le harcèlement (Cf : fièvre Typhoïde). Mais malgré tout, les prisonniers bénéficient d’un traitement humain : être interné signifie recevoir des soins minimums, une alimentation régulière et une prise en charge.166
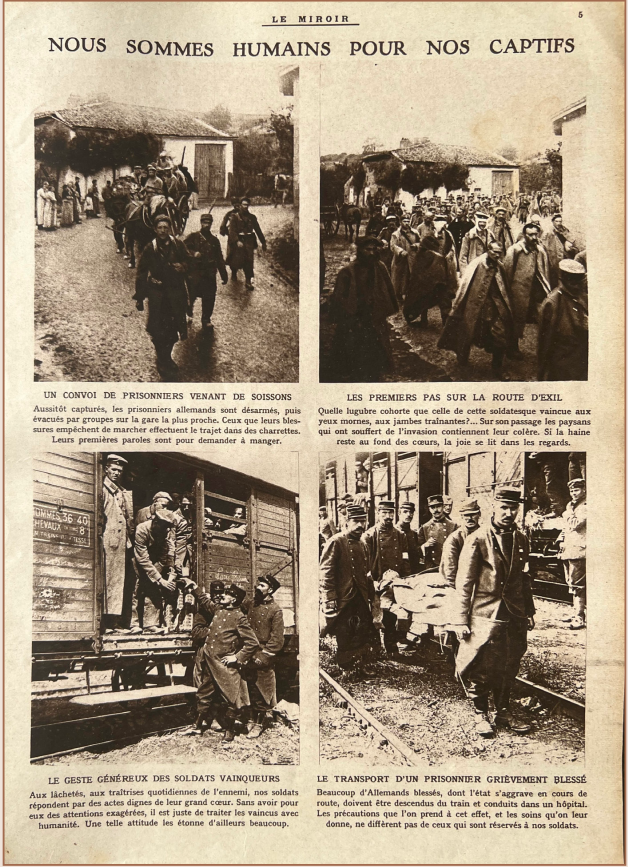
Journal Le Miroir - 27 septembre 1914
Transcription
photo 177
(de gauche à droit, de haut en bas)
« NOUS SOMMES HUMAINS POUR NOS CAPTIFS »
« Un convoi de prisonniers* venant de Soissons »
« Aussitôt capturés, les prisonniers* allemands sont désarmés, puis évacués
par groupes sur la gare la plus proche. Ceux que leurs blessures empêchent de
marcher effectuent le trajet dans des charrettes. Leurs premières paroles sont
pour demander à manger. »
« Les premiers pas sur la route d’exil »
« Quelle lugubre cohorte que celle de cette soldatesque vaincue aux yeux
mornes, aux jambes traînantes?… Sur son passage, les paysans qui ont
souffert de l’invasion contiennent leur colère. Si la haine reste au fond des
coeurs, la joie se lit dans les regards. »
« Le geste généreux des soldats vainqueurs »
« Aux lâchetés, aux traîtrises quotidiennes de l’ennemi, nos soldats répondent
par des actes dignes de leur grand cœur. Sans avoir pour eux des attentions
exagérées, il est juste de traiter les vaincus avec humanité. Une telle attitude
les étonne d’ailleurs beaucoup. »
« Le transport d’un prisonnier* grièvement blessé* »
« Beaucoup d’Allemands blessés*, dont l’état s’aggrave en cours de route,
doivent être descendus du train et conduits dans un hôpital. Les précautions
que l’on prend à cet effet, et les soins qu’on leur donne, ne diffèrent pas de
ceux qui sont réservés à nos soldats. »
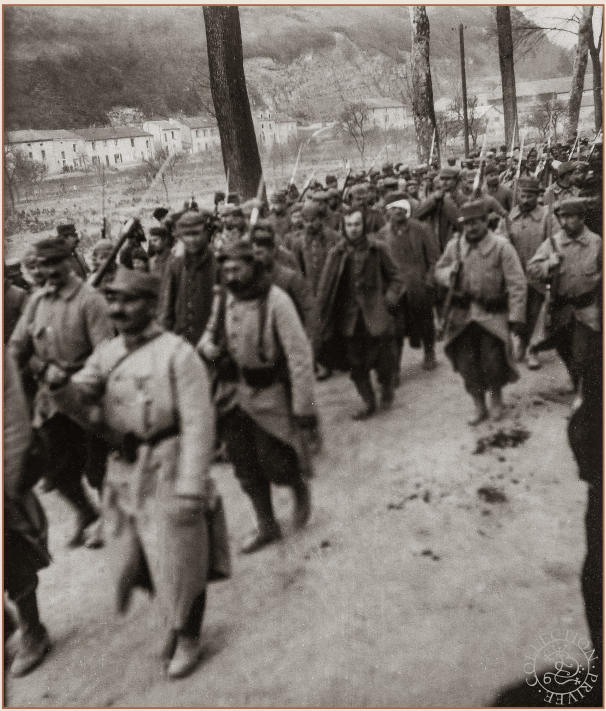
Dieulouard◊ - Hiver 1914/1915
450 boches* faits prisonniers au Bois-le-Prêtre défilent à Dieulouard. (Légende d’origine)

Marbache - 11 mars 1916
Prisonniers* allemands capturé au Bois-Le-Prêtre◊. (Légende d’origine)

Marbache - 11 mars 1916
Prisonniers* allemands capturés au Bois-Le-Prêtre◊. (Légende d’origine)
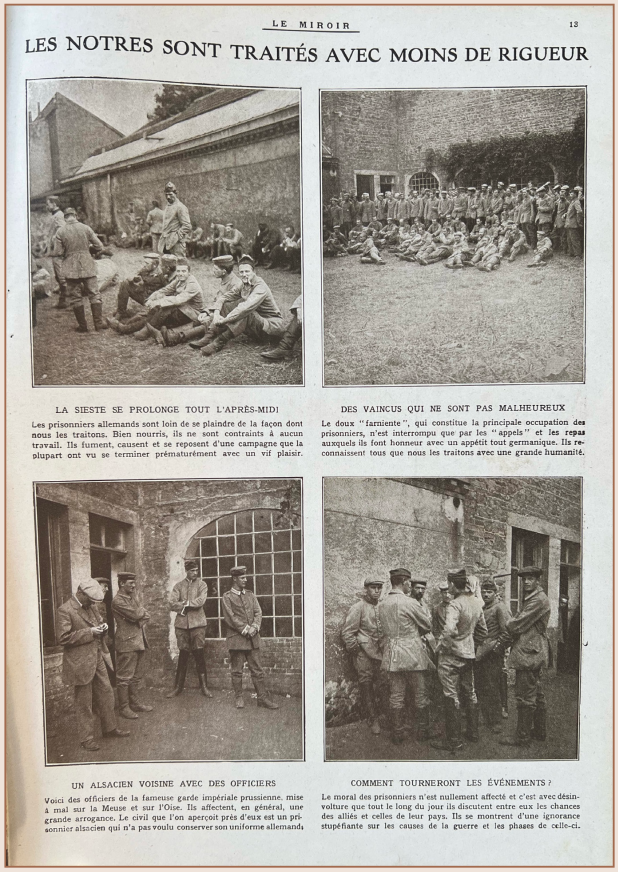
Journal Le Miroir - 27 septembre 1914
Transcription
photo 181
(de gauche à droit, de haut en bas)
« LES NÔTRES SONT TRAITÉS AVEC MOINS DE RIGUEUR »
« La sieste se prolonge tout l’après-midi »
« Les prisonniers* allemands sont loin de se plaindre de la façon dont nous
les traitons. Bien nourris, ils ne sont contraints à aucun travail. Ils fument,
causent et se reposent d’une campagne que la plupart ont vu se terminer
prématurément avec un vif plaisir. »
« Des vaincus qui ne sont pas malheureux »
« Le doux « farniente », qui constitue la principale occupation, n’est
interrompu que par les “appels” et les repas auxquels ils font honneur avec
un appétit tout germanique. Ils reconnaissent tous que nous les traitons avec
grande humanité. »
« Un alsacien voisine avec des officiers* »
« Voici des officiers* de la fameuse garde impériale prussienne, mise à mal
sur la Meuse et sur l’oise. Ils affectent, en général, une grande arrogance. Le
civil que l’on aperçoit près d’eux est un prisonnier* alsacien qui n’a pas voulu
conserver son uniforme allemand. »
« Comment tourneront les événements? »
« Le moral des prisonniers* n’est nullement affecté et c’est avec désinvolture
que tout le long du jour ils discutent entre eux les chances des alliés et celle
de leur pays. Ils se montrent d’une ignorance stupéfiante sur les causes de la
guerre et les phases de celle-ci. »
PROPAGANDE
Dès le 5 août 1914, une loi réprimant les indiscrétions de la presse* interdit la publication d’informations non gouvernementales sur les opérations militaires. Les journalistes ne peuvent plus accéder au front, ce qui entraîne une pénurie d’informations objectives.
La presse propage, en conséquence, de la désinformation pour soutenir le moral. Les journaux* dépeignent les Allemands comme cruels et inefficaces, minimisent les défaites et exagèrent les succès, sans oublier que les articles décrivent régulièrement l’armée allemande comme retardataire.
Cette propagande est destinée à galvaniser l’opinion publique et à minimiser les revers réels, mais elle déforme la réalité.168

Le Petit Journal - dimanche 20 septembre 1914
Transcription
« SUS AU MONSTRE »

Journal Le Miroir - 23 août 1914
Transcription
« LES ALLEMANDS SE BATTENT SANS CONVICTION »
« Soldats de l’infanterie allemande en ligne de bataille »
« L’élan forcené des fameuses armées de fer allemandes s’est brisé sur la
frontière belge. Ces troupes allemandes auxquelles depuis tant d’années le bluff
germanique attribuait les plus belles qualités, se sont révélées mal équipées,
ignorantes, démoralisées. Pliés à une discipline très dure, les Allemands sont
désemparés, dès que leurs officiers* disparaissent. Ils n’ont ni l’ingéniosité, ni
l’agilité de nos hommes et combattent très mal à découvert. Voici des soldats
d’infanterie égaillés dans la campagne et avançant par bonds. »
PROVISION DE BOUCHE
L’expression inclut non seulement la nourriture, mais aussi d’autres articles liés à la préparation et à la consommation des repas, tels que les ustensiles de cuisine ou encore la vaisselle, fournis aux soldats pendant la Première Guerre mondiale.169 (Cf: Pitance)
QUART
Un quart est une période de temps pendant laquelle le soldat est assigné à une tâche de garde. Cela implique généralement une rotation pour assurer la surveillance pendant une fraction déterminée de la durée totale. 170 (Cf: Faction)
RAQUETTES
La raquette est une forme de grenade* artisanale fabriquée en utilisant un pétard contenant de l’explosif comme base. Ce pétard est inséré dans un tube de fer ordinaire et fixé à une longue planchette en bois à l’aide d’un fil de fer, ce qui permet d’augmenter sa portée de tir.171

Pétard raquette
RATIONNEMENT
Pendant la Première Guerre mondiale, la France est confrontée à un défi majeur: nourrir à la fois ses soldats et sa population civile.
Dans les zones occupées, les politiques de rationnement sont principalement déterminées par l’armée allemande, qui a un contrôle total sur la distribution et le rationnement de nourriture. En 1917, la ration alimentaire quotidienne d’un adulte est réduite à 300 g de pain, 30 g de graisse, 30 g de légumes secs, 10 g de sucre, 10 g de sel et de café, avec une diminution à 75 g de pain dans certaines régions en 1918. Les privations conduisent d’ailleurs à une perte de poids généralisée dans les zones occupées (Cf: Pitance/ Provision de bouche).
Les habitants des zones non occupées sont aussi soumis à des mesures de rationnement, bien qu’uniquement appliquées sur certaines denrées. En 1915, le gouvernement envisage de rationner le pain, craignant une disette généralisée. Mais la situation s’aggrave puisqu’en 1916, la France met en place des cartes de rationnement pour des produits essentiels tels que le beurre et le sucre dans l’ensemble du pays. Ces privations sont imposées par le gouvernement pour soutenir les besoins alimentaires massifs d’une armée prioritaire, en vue de la défense nationale.
Paradoxalement, la fin de la guerre n’entraîne pas une amélioration immédiate de l’approvisionnement alimentaire. Les pénuries persistent et ce n’est qu’en 1921 que certaines restrictions alimentaires, comme le rationnement du sucre, sont levées.172
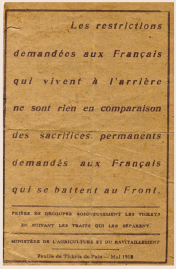
Mai 1918
Transcription
« Les restrictions demandées aux Français qui vivent à l’arrière ne sont rien
en comparaison des sacrifices permanents demandés aux Français qui se
battent au Front.
Prière de découper soigneusement les tickets en suivant
les traits qui les séparent.
Ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement
Feuille de Ticket de Pain – Mai 1918 »
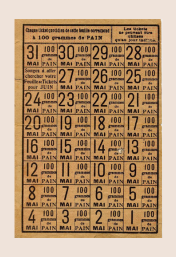
Mai 1918
Tickets alimentaires : 100 grammes de pain par jour et par personne
RAVITAILLEURS
Les ravitailleurs désignent les soldats principalement responsables de la fourniture de provisions et de matériel aux troupes sur le front. Ces soldats jouent un rôle crucial dans le maintien de l’efficacité opérationnelle des armées, en assurant un approvisionnement continu en nourriture, munitions, équipement médical, carburant, vêtements et autres fournitures essentielles 173 (Cf: Pitance / Provision de bouche / Jus).
RÉGIMENT D’INFANTERIE
Un régiment d’infanterie est une unité militaire composée de soldats formés pour combattre à pied. Les régiments d’infanterie forment l’épine dorsale des divisions d’infanterie* et sont déployés sur l’ensemble du front occidental.174

Toul◊ - 1914
167e régiment d’infanterie*
REMPILÉS
RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE
Le relevé ou lever topographique est une opération de cartographie qui consiste à réaliser, sur le terrain ou à partir de photographies aériennes, toutes les opérations géométriques nécessaires pour créer un plan ou une carte. Le résultat de ces opérations est le plan ou la carte finale.176
Initialement placée sous responsabilité civile avant la Révolution française, la cartographie est ensuite transférée au domaine militaire en raison de la demande croissante de production de nouvelles cartes. Les responsabilités de fabrication et de gestion des représentations cartographiques sont ainsi confiées au corps militaire jusqu’au 27 juin 1940. À cette date, afin d’éviter que des ressources stratégiques, comme les cartes et le matériel de levés, ne tombent aux mains des Allemands, le service géographique de l’armée est transformé en un organisme civil : l’Institut Géographique National, ou IGN.177
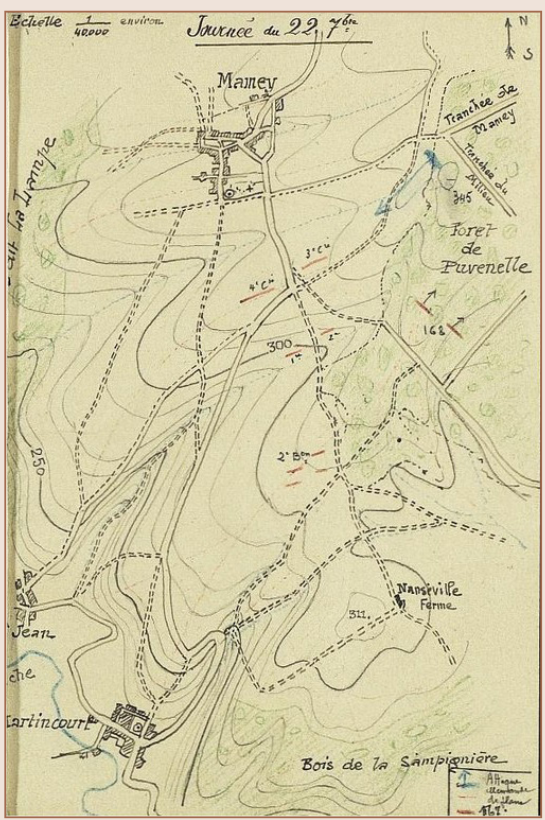
Mamey◊, Forêt de Puvenelle◊ - Septembre 1915
Relevé topographique* du JMO de la 73e division d’infanterie
RÉTROGRADATION
La rétrogradation consiste à être déclassé dans son grade* ou sa fonction au sein de l’armée. Cet acte peut résulter d’une demande du soldat concerné ou lui être imposé en cas de faute ou d’incompétence à l’exercice de ses fonctions.178
RIMAILHO
L’obusier de 155 mm CTR modèle 1904, également connu sous le nom de 155 mm Rimailho, est un canon développé par Émile Rimailho et adopté par l’artillerie* de l’armée française en 1905.
Ces obusiers, produits à l’Arsenal de Bourges, sont largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale. En août 1914, il y a 104 pièces* de 155 CTR affectées aux cinq régiments d’artillerie* lourde, avec un approvisionnement de 540 obus* par pièce.

Bois-le-Prêtre◊ - 14 décembre 1915
Pièce de 155 long en batterie* (Légende d’origine)
SAPE
Une sape est une tranchée* creusée en profondeur. Les soldats qui l’empruntent sont à l’abri des dangers potentiels et peuvent alors déposer des substances inflammables ou des charges explosives dans les rangs adverses afin de créer une brèche dans leurs défenses.180
Les sapes jouent également un rôle dans l’espionnage des lignes ennemies. Leur proximité avec les tranchées* adverses permet d’écouter le bruit de leurs activités, ce qui facilite la compréhension de leurs intentions, leur avancement, voire du moment où ils pourraient essayer d’attaquer (Cf : Espions).181
Ce sont les soldats du génie*, plus communément appelés sapeurs*, qui sont la plupart du temps chargés de construire ces sapes au cours du conflit. La Première Guerre mondiale est le dernier grand évènement au cours duquel les sapes sont largement utilisées.182
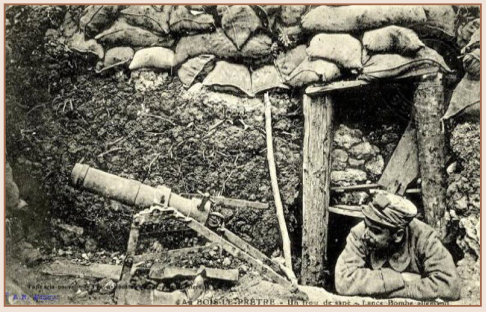
Bois-le-Prêtre◊ - 1915
Trou de sape* et lance bombe bombe allemand (Légende d’origine)
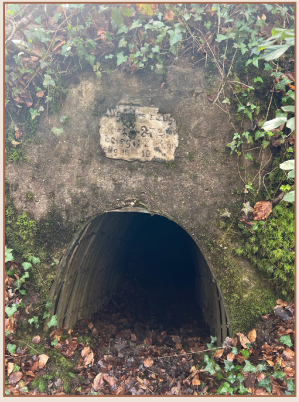
Bois-le-Prêtreo - Février 2024
Entrée d’une sape*
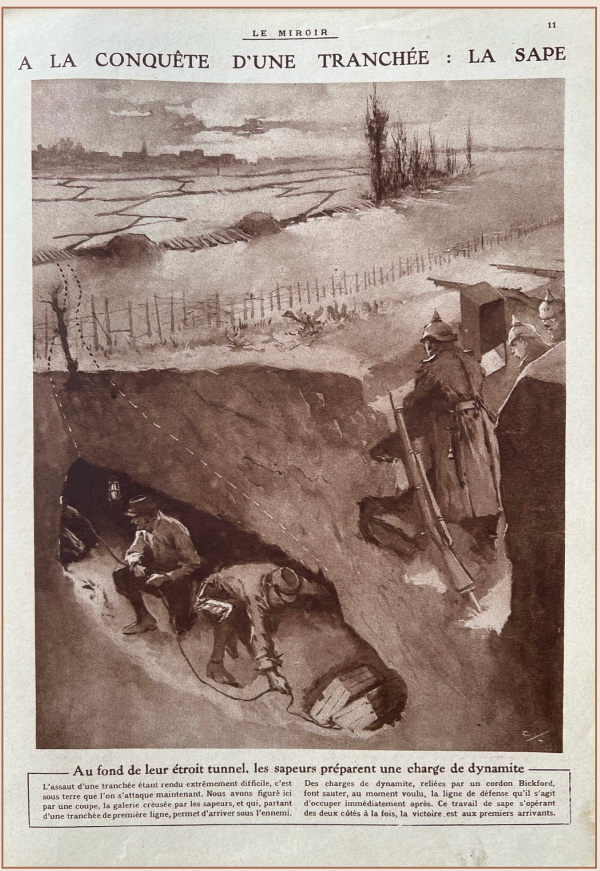
Journal Le Miroir - 17 janvier 1915
Transcription
photo 192
« A LA CONQUÊTE D’UNE TRANCHÉE*: LA SAPE* »
« Au fond de leur étroit tunnel, les sapeurs* préparent une charge de dynamite »
« L’assaut d’une tranchée* étant rendu extrêmement difficile, c’est sous terre
que l’on s’attaque maintenant. Nous avons figuré ici par une coupe, la galerie
creusée par les sapeurs*, et qui, partant d’une tranchée* de première ligne,
permet d’arriver sous l’ennemi. Des charges de dynamite, reliées par un
cordon Bickford, font sauter, au moment voulu, la ligne de défense qu’il s’agit
d’occuper immédiatement après. Ce travail de sape* s’opérant des deux côtés
à la fois, la victoire est aux premiers arrivants. »

Bois Brûlé◊ - 2007
Galerie de mine de l’abri* du Bois Brûlé◊. On peut observer au
second plan, accroché au madrier, un support de gaine d’aération.
SCHRAPNELL
Un Shrapnell désigne un obus* d’artillerie*, rempli de balles ou de fragments de métaux, qui projette ce qu’il contient au moment de son explosion.183
SCIEUR DE LONG
Le terme « scieur de long » fait référence aux soldats français ayant servi, pendant la Première Guerre mondiale, dans une unité de bûcherons appelée compagnie* de scieurs de long. Ces troupes son chargées de l’abattage des arbres et du débardage du bois, pour soutenir l’effort de guerre* français.
Les soldats qui servent dans ces unités sont des travailleurs forestiers expérimentés qui doivent avoir une grande force physique pour effectuer un travail particulièrement difficile. Les scieurs de long jouent un rôle crucial en fournissant du bois pour les tranchées*, les fortifications et les équipements militaires (Cf : Cantonnement).184
Les besoins en bois sont croissants pour la construction de tranchées*, de baraquements, de ponts temporaires et de supports pour les réseaux de communication. Environ 7 millions de mètres cubes de bois sont requis chaque année par les forces alliées pour répondre à ces demandes.185 A l’été 1914, 18 compagnies* de 150 à 250 chasseurs forestiers sont formées pour intégrer les différents corps d’armée.186

Saint-Léonard-de-Noblat - 1910
Scieurs de long. Le scieur d'en haut est appelé le « chevrier », tandis
que le scieur d'en bas est appelé le « renard ».
SECTION
La section est la subdivision de la compagnie* et comprend environ 65 hommes. Elle est généralement commandée par un sous lieutenant.*187 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
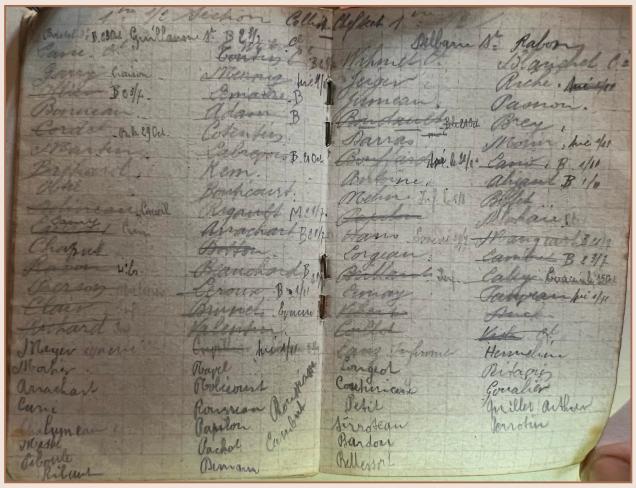
Notes de Jules Henri Colliot sur la demi section sous ses ordres
SECTION DE PIQUETS
Les sections de piquets, également connues sous le nom de postes* de garde avancés, sont des positions fortifiées tenues par des soldats pour protéger les tranchées* et les lignes de communication des attaques ennemies. Les sections de piquet sont la plupart du temps situées en première ligne, exposant les soldats à un risque élevé d’attaques.188
(Cf : Corvée de Piquets / Grand-Garde / Petit Poste)
SERGENT-CHEF (SERGENT)
Le sergent-chef est un sous-officier* placé immédiatement sous les ordres du sergent-major et aidant dans le service administratif de la compagnie*.189(Cf : Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
SERRE-FIL
Le singe désigne de manière péjorative la viande en conserve consommée par la majorité des soldats pendant le conflit. Cette appellation, introduite par les troupes coloniales qui auraient vu des Africains manger du singe boucané, marque un dégoût certain d’une viande industrialisée.191 (Cf : Colonies / Tirailleurs / Pitance)
SINGE
Le singe désigne de manière péjorative la viande en conserve consommée par la majorité des soldats pendant le conflit. Cette appellation, introduite par les troupes coloniales qui ont vu des Africains manger du singe boucané, marque un dégoût certain d’une viande industrialisée. 191 (Cf: Colonies / Tirailleurs / Pitance)

Conserverie alimentaire Raynal et Roquelaure à Capdenac (Lot) - juillet 1916
Les ouvrières mettent en boîte des rôtis. À l’arrière-plan, les sauteuses et un cuisinier.
(Légende d’origine)

Toul - 15 mai 1918
L’épicerie militaire présente un grand nombre de conserves de toutes sortes
. (Légende d’origine)
SOLDATS DU GÉNIE (SAPEURS)
Les soldats du génie, également appelés sapeurs ou pionniers, sont une composante importante des forces militaires pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont responsables des tâches liées à la construction, à la réparation et à la destruction d’infrastructures militaires et civiles, ainsi qu’à la mise en place d’installations et d’obstacles défensifs, en l’occurrence des sapes*. Leur insigne distinctif se constitue de deux haches en sautoir, cousues sur leur manche.192
SOUS-OFFICIERS
Les sous-officiers* sont des militaires au sein des forces armées et de la gendarmerie qui occupent des grades* intermédiaires, les plaçant en tant qu’auxiliaires des officiers* dans l’exercice du commandement. Ces grades* varient en fonction de la branche militaire, mais dans les armées de terre, de l’air et la gendarmerie, ils vont du grade* de sergent ou maréchal des logis au grade* de major.193 (Cf: Division des corps d’armée en 1914 / Hiérarchie du corps armé français)
ST CYRIEN
Un Saint Cyrien désigne un élève ou un ancien élève issu des rangs de l’École de Saint-Cyr. L’établissement militaire est une prestigieuse école française où les futurs officiers* reçoivent leur formation. Ils sont souvent considérés comme étant parmi les meilleurs et les plus dévoués et sont formés à assumer des responsabilités de commandement dans diverses branches de l’armée.194
STRATÉGIE
Le déroulement de la Première Guerre mondiale peut être divisé en trois phases distinctes, chacune marquée par des caractéristiques stratégiques et tactiques spécifiques. La première phase, qui se déroule à l’automne 1914, est une courte guerre de mouvement, les armées belligérantes cherchant à gagner du terrain à travers des manœuvres rapides et des offensives éclair. Cependant, elle conduit rapidement à un blocage du front dans le nord-est de la France et l’ouest de la Russie, créant une ligne de front figée. La deuxième phase s’étend de l’automne 1914 au printemps 1918. Elle est caractérisée par une guerre de positions sur les fronts principaux. Les adversaires creusent des tranchées*, donnant naissance à une forme de combat statique. Cette période est marquée par d’importantes batailles, telles que Verdun et la Somme en 1916, ainsi que le Chemin des Dames en 1917. Ces affrontements sont particulièrement meurtriers, avec des tentatives répétées de percer les lignes ennemies, souvent sans succès significatif. La troisième phase, à partir de mars 1918, voit une reprise de la guerre de mouvement à l’initiative de l’Allemagne. Cependant, cette tentative est contrecarrée par l’arrivée des américains et les contre-offensives victorieuses des Alliés.195
SUICIDE
Il y aurait eu entre 4 000 et 4 500 morts par suicide entre 1914 et 1918. Néanmoins, la détermination des intentions suicidaires s’avère complexe à déceler, car certains soldats se précipitent sur le champ de bataille par désespoir, sans être officiellement considérés comme suicidés. Les responsables militaires ont également tendance à cacher les suicides pour épargner les familles des soldats et éviter l’absence de pension et de décoration (Cf: Croix de guerre / Légion d’Honneur). Contrairement aux idées reçues, les suicides ne se limitent pas aux soldats en première ligne: certains se suicident à domicile, en cantonnement*, en permission ou dans les hôpitaux.196
TENUE DE CAMPAGNE
La tenue de combat des soldats français en août 1914 comprend encore les pantalons rouge garance: leur signe distinctif depuis 1829. Ils sont également parés d’une capote* de couleur gris fer bleuté, datant de l’année 1877 et fermée par deux rangées de boutons.
Pour transporter leur équipement, les combattants utilisent un havresac en toile cirée, renforcé par un cadre en bois. Il transporte plusieurs équipements collectifs et individuels et pèse entre 25 et 30 kg. Complétant leur attirail, une musette* en toile est également présente.
L’uniforme, très similaire à celui porté durant la guerre de 1870, se distingue par sa visibilité, à l’inverse de la plupart des grandes armées européennes. Les Britanniques, les Russes, les Italiens et les Allemands optent pour des couleurs plus discrètes dans leurs tenues de campagne.
Mais en août 1915, un nouvel uniforme est adopté. De couleur bleu clair, il est caractérisé par une capote* avec un boutonnage croisé qui offre une meilleure protection aux soldats (Cf : Képi / Baïonnette).197
La décision de changer l’uniforme français est prise par le ministre de la guerre, Adolphe Marie Messimy, par le biais d’un décret en date du 27 juillet 1914, soit un jour avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La nature de la guerre moderne exige l’adoption de couleurs plus discrètes sur le champ de bataille. Mais il est déjà trop tard pour équiper les troupes et les premiers combats sont menés avec l’ancienne tenue.
C’est suite à la victoire de la Marne que l’état-major décide d’adopter la couleur bleu horizon. L’uniforme se généralise progressivement dans les troupes à partir de l’automne 1915. Toutefois, l’armée française présente un aspect très hétéroclite jusqu’à la fin de l’année, en raison notamment des pénuries et de la lenteur des approvisionnements. La tenue est distribuée à toutes les troupes métropolitaines et coloniales, à l’exception des troupes de l’armée d’Afrique, qui reçoivent des tenues de couleur kaki, avec une nuance se rapprochant du jaune moutarde (Cf: Colonies).198
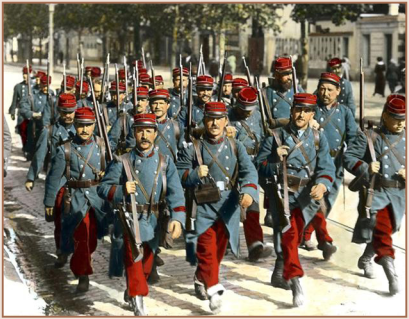
Paris - Août 1914
Soldats français lors de la mobilisation*

Uniforme Bleu Horizon
TIRAILLEURS
Les tirailleurs sont des unités de l’armée française composées principalement de soldats issus des colonies*. La compagnie* historique de cette époque est celle des tirailleurs sénégalais qui représentent près de 200 000 combattants. Parmi eux, environ 30 000 meurent sur le champ de bataille.199
Au total, entre 400 000 et 500 000 tirailleurs africains sont recrutés pour servir dans l’armée française pendant ce conflit, parmi lesquels figurent 172 000 Algériens.
La période 1915-1916 est marquée par une effervescence de nouvelles recrues, avec l’intégration de 60 000 soldats dans les rangs pour compenser les lourdes pertes subies par l’armée française.200
Les autorités militaires françaises ont tendance à traiter différemment les soldats coloniaux en fonction de leur origine ethnique, avec des stéréotypes influençant la manière dont ils sont utilisés. Certains groupes, comme les Africains de l’Ouest, sont considérés comme de meilleurs guerriers en raison de préjugés sur leur «sauvagerie primitive», tandis que d’autres, comme les Indochinois, sont jugés trop petits et efféminés. Mais les soldats africains ne sont pas tous placés en première ligne et les opinions divergent sur le traitement équitable des troupes coloniales, remettant en question l’idée qu’elles sont délibérément utilisées comme «chair à canon»†. Les accusations de mauvais traitements sont parfois amplifiées par l’ennemi, comme les efforts allemands pour convaincre les soldats musulmans français de rejoindre leurs rangs.
La complexité de l’histoire des troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale met en lumière une réalité nuancée: qualifier l’armée française de manière simpliste comme raciste ou, à contrario, non discriminatoire ne rend pas justice à la diversité d’expériences vécues par ces soldats.201
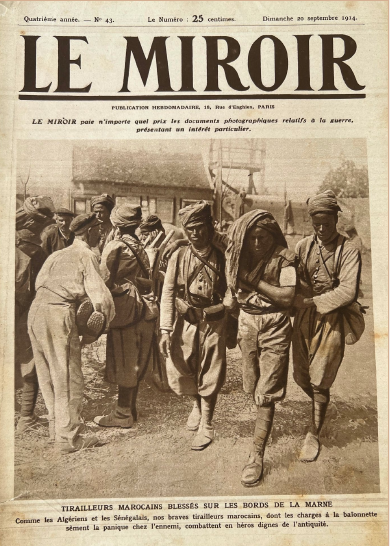
Journal Le Miroir - 20 septembre 1914
Transcription
photo 201
« TIRAILLEURS* MAROCAINS BLESSÉS* SUR LES BORDS DE LA MARNE »
« Comme les Algériens et les Sénégalais, nos braves tirailleurs* marocains,
dont les charges à la baïonnette* sèment la panique chez l’ennemi, combattent
en héros dignes de l’antiquité. »

Journal Le Miroir - 20 septembre 1914
Transcription
(de gauche à droite ; de bas en haut)
photo 202
« LES PRINCIPALES RACES PRÉSENTÉES DANS LES RANGS DES ALLIÉS »
« FANTASSIN* RUSSE, FANTASSIN* BELGE, FANTASSIN* ANGLAIS,
VOLONTAIRE IRLANDAIS, SIKH DE L’INDE, FANTASSIN* FRANÇAIS,
TIRAILLEUR* ALGÉRIEN, TIRAILLEUR* MAROCAIN, TIRAILLEUR* SÉNÉGALAIS,
FANTASSIN* JAPONAIS »
« Lorsque les Allemands nous ont déclaré la guerre, ils ne comptaient ni sur
l’intervention de la Belgique, ni sur celle de l’Angleterre. A plus forte raison ne
pensaient-ils pas avoir à combattre des Irlandais, des Hindous et des Canadiens.
Nous avons réuni ici quelques-uns des races qui sont représentées dans la grande
bataille ouverte contre le despotisme germanique. Si l’on songe que parmi les
volontaires étrangers se trouvent des Italiens, des Hollandais, des Scandinaves, des
Espagnols, des Hellènes, des Roumains, des Egyptiens, des Américains du Nord et
du Sud, on verra que les principales nations du monde entier sont représentées
dans les rangs des armées alliées. Un moine en 1600 n’annonçait-il pas déjà, pour
notre époque, une guerre universelle? »
TOPOGRAPHIE : (Cf : Relevé Topographique)
TORPILLE : (Cf : Obus)
TORTUE : (Cf : Carapace)
TRANCHÉES
Durant les premières phases de la guerre, la doctrine défensive préconise un réseau de tranchées comportant deux à trois lignes parallèles, reliées entre elles par des tranchées de communication.
La première ligne de tranchée est la plus exposée, car c’est la première à être attaquée par les fantassins* ennemis. Elle est équipée de postes* de tir et de quelques abris* rudimentaires.
70 mètres à l’arrière se trouve la deuxième ligne de tranchée, qui sert de position de repli en cas de bombardement de la première ligne ou de point de rassemblement lors d’une offensive. On y trouve des abris* plus profonds et des postes* médicaux.
Parfois, une troisième ligne de tranchée, appelée tranchée de réserve, est créée. Elle se situe à une distance de 150 à 2 000 mètres de la première ligne. Cette ligne sert de voie d’approvisionnement et de zone de stockage pour les munitions, les provisions et le matériel. Les soldats peuvent également y prendre un peu de repos.
Les points d’intersection entre les tranchées de communication et les lignes principales revêtent une importance vitale et sont solidement protégés. (Cf: Boyau)
La morphologie des tranchées peut varier considérablement en fonction des circonstances. Elles peuvent se réduire à de simples fosses ou, à contrario, être équipées d’abris souterrains en béton ou encore de toits en terre. Les tranchées ont généralement une profondeur de 3 mètres et ont la particularité d’être construites en zigzag pour éviter les tirs en enfilade et réduire l’effet des obus*. Cette particularité réduit le champ de vision du soldat à une portée de 9 mètres au maximum. Pour permettre aux soldats d’observer l’extérieur de la tranchée sans s’exposer, des créneaux* sont aménagés à l’aide de sacs de sable et parfois renforcés avec des plaques de métal. Une autre méthode consiste à utiliser des périscopes*.202
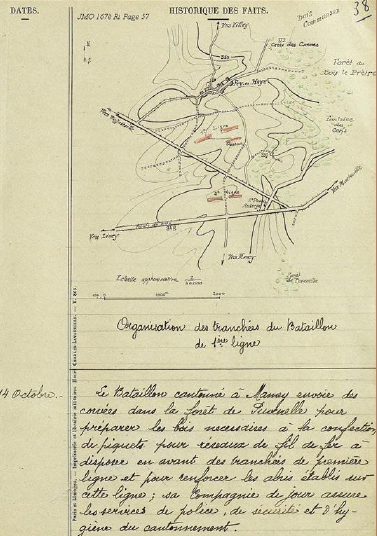
Bois-le-Prêtre◊ - 14 octobre 1914
JMO 167e RI
Transcription
photo 203
« Organisation des tranchées* du Bataillon* de 1ere ligne »
« Le Bataillon* cantonné à Mamey envoie des corvées* dans la forêt de
Puvenelle pour préparer les bois nécessaires à la confection de piquets* pour
réseaux de fil de fer à disposer en avant des tranchées* de première ligne et
pour renforcer les abris* établis sur cette ligne; sa compagnie* de jour assure
les services de police, de sécurité et d’hygiène du cantonment. »
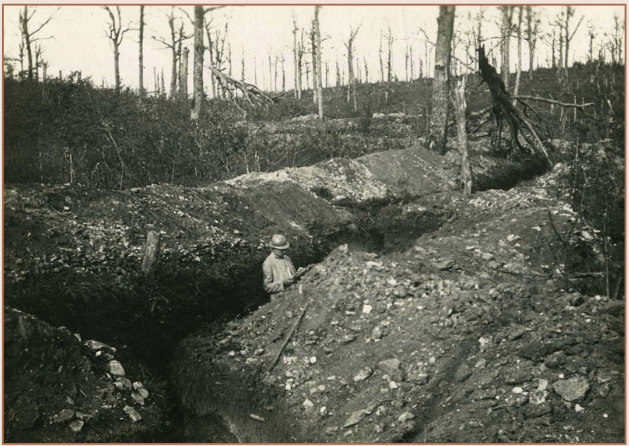
Bois-le-Prêtre◊ - 1915 Vue d’une tranchée

Bois-le-Prêtre◊ - Février 1916
Le Pillement - vue sur la tranchée* du Mouchoir (Légende d’origine)
TRANCHÉES DE FLANQUEMENT
Une tranchée* de flanquement est une structure défensive militaire positionnée en diagonale par rapport à la ligne de défense principale. Elle permet aux soldats de tirer sur les assaillants venant latéralement pour protéger le flanc de la position.203
TROUS DE LOUP
Les troups de loups sont des cratères, créés par les explosions d’obus*, qui cachent des pièges mortels. Dissimulés par la terre et l’herbe, ces pièges représentent un péril constant pour les troupes avançant sur le terrain.204
UNION SACRÉE
l’Union sacrée désigne une période de coopération politique exceptionnelle entre les différents partis et factions , à l’approche de la première guerre mondiale. Le 2 août 1914, l’état de siège est annoncé dans toute la France, suivi d’une convocation extraordinaire du parlement le 4 août par le président Raymond Poincaré. Dans son message lu par le chef du gouvernement René Viviani, Poincaré évoque l’Union sacrée, appelant à l’unité face à l’ennemi. Ce jour-là, le gouvernement propose 18 lois pour préparer le pays à la guerre. Sans débat, toutes sont unanimement adoptées à la Chambre et au Sénat. Cette décision s’explique en partie par la conviction qu’une guerre brève et victorieuse est à venir. L’appel à l’union nationale de la part du président guide la politique des groupes parlementaires jusqu’à l’été 1917. 205
† De nombreux doutes étaient émis en raison de son retard technique vis à vis du bombardement et de son apparente inefficacité sur le terrain.
†† Marie-Catherine Villatoux « Le fait aérien dans la Grande Guerre : révolution dans les affaires militaires » Défense Nationale 2018/9 pg.33-39
††† Avion de chasse biplane pensé par le Français Gustave Delage et mis en service en Mars 1916.
†††† Les deux millions de victimes mentionnées incluent uniquement les blessés de guerre à proprement parler, sans compter les gazés ni les victimes d’accidents qui élèvent le total à environ 3 millions.
††††† « Première mitrailleuse auto-alimentée, inventée par Sir Hiram Maxim en 1884 en Grande Bretagne. »
6† Opération qui consiste à pratiquer une ouverture dans un os et principalement dans la boîte crânienne afin d’agir sur le cerveau.
7† Être placé dans un cercueil en vue de l’inhumation
8† Loi du 8 avril 1915
9† Anne Paveau, Citations à l’ordre et croix de guerre. Fonction des sanctions positives dans la guerre de 1914-1918 Dans Cazals Rémy, Picard Emmanuelle, Rolland Denis, La Grande Guerre. Pratiques et expériences, Toulouse, Privat, 2005, pp. 247-257.
10† Jean Callot « Un sadique de la répression : le général Boutegourd », Le Progrès civique, 4 mars 1922, p. 309.
11† Journal de marche de la 51e DI, 7 septembre 1914, ordre de la division n° 8.